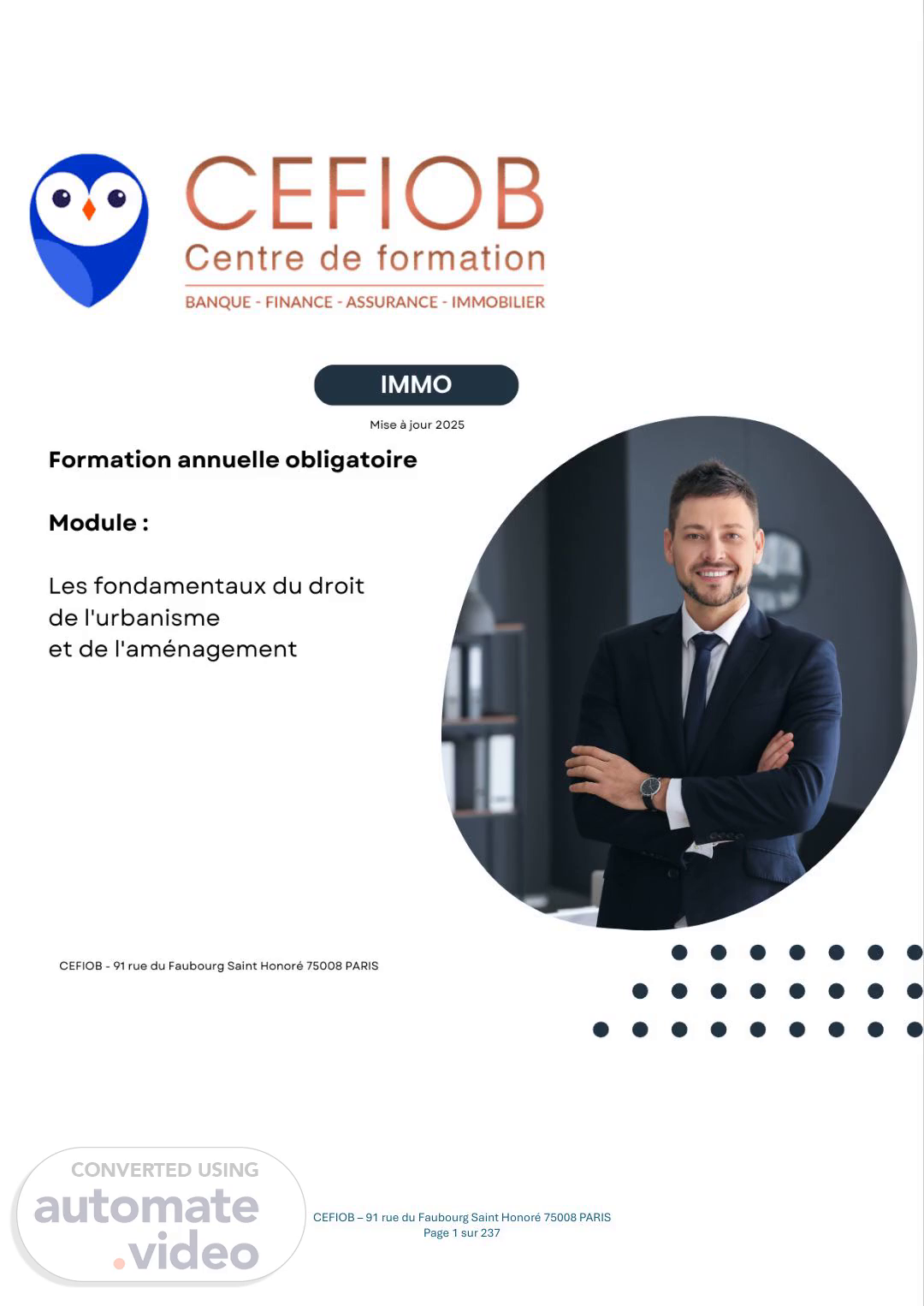Scene 1 (0s)
[Audio] CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 1 sur 237.
Scene 2 (9s)
[Audio] Table des matières INTRODUCTION GÉNÉRALE .................................................................................. 8 Contexte et enjeux du droit de l'urbanisme ................................................................... 8 Objectifs pédagogiques du cours .................................................................................. 9 Méthodologie et structure du cours ............................................................................ 10 PARTIE I : FONDEMENTS ET ÉVOLUTION DU DROIT DE L'URBANISME .................... 12 Chapitre 1 : Histoire et fondements du droit de l'urbanisme ......................................... 12 1. Les origines du droit de l'urbanisme ........................................................................................ 12 2. La naissance du droit de l'urbanisme moderne (1919-1943) ...................................................... 13 3. L'urbanisme de la reconstruction et des Trente Glorieuses (1945-1967) .................................... 15 4. La décentralisation et l'émergence des préoccupations environnementales (1975-2000) .......... 17 Conclusion du chapitre .............................................................................................................. 18 Chapitre 2 : Le cadre législatif actuel .......................................................................... 19 1. La loi SRU (2000) : fondement du droit de l'urbanisme contemporain ........................ 19 1.1 Contexte et objectifs de la loi SRU ......................................................................................... 19 1.2 Les principes fondamentaux ................................................................................................. 19 1.3 Les nouveaux documents d'urbanisme .................................................................................. 20 1.4 L'obligation de mixité sociale ................................................................................................. 20 2. Les lois Grenelle (2009-2010) : l'intégration des préoccupations environnementales . 22 2.1 Contexte et objectifs des lois Grenelle ................................................................................... 22 2.2 Les objectifs de développement durable ................................................................................ 22 2.3 La lutte contre l'étalement urbain .......................................................................................... 23 2.4 La trame verte et bleue ......................................................................................................... 23 3. La loi ALUR (2014) : renforcement de l'intercommunalité et lutte contre l'étalement urbain ........................................................................................................................ 24 3.1 Contexte et objectifs de la loi ALUR ....................................................................................... 24 3.2 Le transfert de la compétence PLU aux intercommunalités ..................................................... 24 3.3 La suppression du CoePicient d'Occupation des Sols (COS) ................................................... 24 3.4 La suppression de la superficie minimale des terrains constructibles ..................................... 24 3.5 La modernisation du droit de préemption .............................................................................. 25 4. La loi ELAN (2018) : simplification et accélération des procédures ............................ 26 4.1 Contexte et objectifs de la loi ELAN ....................................................................................... 26 4.2 Les Opérations d'Intérêt National (OIN) ................................................................................. 26 4.3 Les Grandes Opérations d'Urbanisme (GOU) ......................................................................... 26 4.4 Les Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT) ................................................................ 26 4.5 La simplification des procédures pour les ZAC ....................................................................... 27 4.6 La modification de la loi Littoral ............................................................................................. 27 5. La loi Climat et Résilience (2021) : lutte contre l'artificialisation des sols .................. 28 5.1 Contexte et objectifs de la loi Climat et Résilience ................................................................. 28 5.2 L'objectif "Zéro Artificialisation Nette" (ZAN) .......................................................................... 28 5.3 La définition légale de l'artificialisation des sols ..................................................................... 28 5.4 L'intégration dans les documents d'urbanisme ...................................................................... 29 5.5 L'encadrement de l'ouverture à l'urbanisation ........................................................................ 29 Conclusion du chapitre .............................................................................................. 30 PARTIE II : LES DOCUMENTS D'URBANISME ET LA PLANIFICATION ....................... 31 Chapitre 3 : La hiérarchie des normes en urbanisme .................................................... 31 1. Les principes généraux du droit de l'urbanisme ........................................................................ 31 CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 2 sur 237.
Scene 3 (3m 42s)
[Audio] 2. Les documents de planification supra-communaux ................................................................. 35 3. Les rapports entre les diPérentes normes ................................................................................ 37 Conclusion du chapitre .............................................................................................................. 38 Chapitre 4 : Les documents d'urbanisme locaux .......................................................... 40 1. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ............................................................................. 40 1.1 Contenu et élaboration ......................................................................................................... 40 1.2 Le rapport de présentation .................................................................................................... 42 1.3 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ............................................ 43 1.4 Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ................................................ 43 1.5 Le règlement et les documents graphiques ............................................................................ 44 1.6 Les annexes ......................................................................................................................... 46 2. Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) .................................................... 47 2.1 Spécificités du PLUi par rapport au PLU ................................................................................. 47 2.2 La gouvernance intercommunale .......................................................................................... 48 2.3 Les PLUi tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLH) et de Plan de Mobilité (PDM) ......... 49 3. La carte communale ............................................................................................... 50 3.1 Contenu et élaboration ......................................................................................................... 50 3.2 EPets juridiques ................................................................................................................... 51 4. Le Règlement National d'Urbanisme (RNU) .............................................................. 52 4.1 Champ d'application ............................................................................................................ 52 4.2 Principales règles ................................................................................................................. 52 Conclusion du chapitre .............................................................................................................. 53 Chapitre 5 : Les servitudes d'utilité publique et autres limitations ................................ 54 1. Les servitudes d'utilité publique ............................................................................. 54 1.1 Définition et caractéristiques ................................................................................................ 54 1.2 Typologie des servitudes ....................................................................................................... 55 1.3 EPets juridiques ................................................................................................................... 58 2. Les servitudes d'urbanisme .................................................................................... 59 2.1 Les emplacements réservés .................................................................................................. 59 2.2 Les espaces boisés classés .................................................................................................. 59 2.3 Les secteurs sauvegardés ..................................................................................................... 60 3. Les contraintes spécifiques .................................................................................... 62 3.1 La loi Littoral ......................................................................................................................... 62 3.2 La loi Montagne .................................................................................................................... 63 3.3 Les zones de protection du patrimoine .................................................................................. 64 Conclusion du chapitre .............................................................................................................. 65 PARTIE III : LES AUTORISATIONS D'URBANISME ................................................... 66 Chapitre 6 : Les diXérentes autorisations d'urbanisme ................................................ 66 1. Le certificat d'urbanisme ........................................................................................................ 66 2. La déclaration préalable ......................................................................................................... 69 3. Le permis de construire .......................................................................................................... 72 4. Le permis d'aménager ............................................................................................................ 75 5. Le permis de démolir .............................................................................................................. 79 Conclusion du chapitre .............................................................................................................. 82 Chapitre 7 : L'instruction des demandes d'autorisation ................................................ 83 1. Les autorités compétentes ..................................................................................... 83 1.1 Le maire ............................................................................................................................... 83 1.2 Le président de l'EPCI ........................................................................................................... 84 1.3 Le préfet ............................................................................................................................... 84 CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 3 sur 237.
Scene 4 (6m 27s)
[Audio] 2. La procédure d'instruction ...................................................................................... 86 2.1 Le dépôt de la demande ........................................................................................................ 86 2.2 La consultation des services ................................................................................................. 87 2.3 Les délais d'instruction ......................................................................................................... 89 2.4 La décision ........................................................................................................................... 91 3. La dématérialisation des demandes d'autorisation .................................................. 93 3.1 Le cadre juridique ................................................................................................................. 93 3.2 Les outils numériques ........................................................................................................... 94 3.3 Les implications pratiques .................................................................................................... 96 4. Les taxes et participations d'urbanisme .................................................................. 99 4.1 La taxe d'aménagement ........................................................................................................ 99 4.2 La participation pour le financement de l'assainissement collectif ........................................ 101 4.3 La redevance d'archéologie préventive ................................................................................ 102 Conclusion du chapitre ............................................................................................................ 104 Chapitre 8 : L'exécution des autorisations d'urbanisme ............................................. 105 1. La validité des autorisations ................................................................................. 105 1.1 Durée de validité ................................................................................................................. 105 1.2 Prorogation ........................................................................................................................ 106 1.3 Transfert ............................................................................................................................. 107 1.4 Modification ....................................................................................................................... 108 2. La conformité des travaux ..................................................................................... 110 2.1 La déclaration d'achèvement .............................................................................................. 110 2.2 Le contrôle de conformité ................................................................................................... 111 2.3 Les sanctions en cas de non-conformité .............................................................................. 112 3. Les infractions au droit de l'urbanisme .................................................................. 114 3.1 Les diPérents types d'infractions ......................................................................................... 114 3.2 La constatation des infractions ........................................................................................... 117 3.3 Les poursuites pénales ....................................................................................................... 118 3.4 La régularisation des infractions .......................................................................................... 119 4. Le contentieux de l'urbanisme .............................................................................. 122 4.1 Les recours administratifs ................................................................................................... 122 4.2 Le recours pour excès de pouvoir ........................................................................................ 123 4.3 Le référé-suspension .......................................................................................................... 125 4.4 Les recours indemnitaires ................................................................................................... 127 Conclusion du chapitre ............................................................................................................ 129 PARTIE IV : LES OUTILS NUMÉRIQUES ET RESSOURCES ...................................... 130 Chapitre 9 : Les outils numériques et plateformes oXicielles ..................................... 130 1. Le Géoportail de l'urbanisme ................................................................................................ 130 2. Le cadastre en ligne .............................................................................................................. 136 3. Les autres plateformes et outils ............................................................................................ 142 Conclusion du chapitre ............................................................................................................ 148 PARTIE V : APPLICATIONS SECTORIELLES DU DROIT DE L'URBANISME ................ 149 Chapitre 10 : Applications pour les agents immobiliers .............................................. 149 1. Le droit de l'urbanisme dans la transaction immobilière ......................................................... 149 2. Les vérifications préalables à la mise en vente ....................................................................... 155 3. La gestion des risques liés à l'urbanisme ............................................................................... 161 Conclusion du chapitre ............................................................................................................ 170 PARTIE V : APPLICATIONS SECTORIELLES DU DROIT DE L'URBANISME (SUITE) ..... 171 Chapitre 11 : Applications pour les courtiers et banquiers ......................................... 171 CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 4 sur 237.
Scene 5 (9m 15s)
[Audio] 1. Le droit de l'urbanisme dans le financement immobilier ......................................................... 171 2. L'articulation entre droit de l'urbanisme et droit bancaire ....................................................... 179 Conclusion du chapitre ............................................................................................................ 189 FICHES TECHNIQUES RÉCAPITULATIVES ........................................................... 191 Fiche technique n°1 : Les documents d'urbanisme .................................................... 191 Définition et hiérarchie ............................................................................................................. 191 Principaux documents locaux ................................................................................................... 191 Procédures d'élaboration et d'évolution .................................................................................... 191 Points de vigilance pour les professionnels ............................................................................... 192 Fiche technique n°2 : Les autorisations d'urbanisme ................................................. 193 Principaux types d'autorisations ............................................................................................... 193 Procédure d'instruction ............................................................................................................ 193 Exécution des autorisations ...................................................................................................... 193 Points de vigilance pour les professionnels ............................................................................... 194 Fiche technique n°3 : Les servitudes et limitations au droit de propriété ..................... 195 Servitudes d'utilité publique ..................................................................................................... 195 Limitations administratives au droit de propriété ....................................................................... 195 EPets juridiques et indemnisation ............................................................................................. 195 Points de vigilance pour les professionnels ............................................................................... 196 Fiche technique n°4 : Le contentieux de l'urbanisme ................................................. 197 Recours administratifs ............................................................................................................. 197 Recours contentieux ................................................................................................................ 197 Contentieux civil et pénal ......................................................................................................... 197 Sanctions administratives ........................................................................................................ 197 Points de vigilance pour les professionnels ............................................................................... 198 Fiche technique n°5 : Outils numériques et ressources en ligne ................................. 199 Plateformes oPicielles .............................................................................................................. 199 Outils de dématérialisation ...................................................................................................... 199 Ressources documentaires ...................................................................................................... 199 Points de vigilance pour les professionnels ............................................................................... 200 Fiche technique n°6 : Points de vigilance pour les agents immobiliers ........................ 201 Avant la mise en vente ou location ............................................................................................ 201 Lors de la commercialisation .................................................................................................... 201 Lors de la vente ........................................................................................................................ 201 Responsabilité professionnelle ................................................................................................. 202 Fiche technique n°7 : Points de vigilance pour les courtiers et banquiers .................... 203 Évaluation des risques urbanistiques ........................................................................................ 203 Financement des projets immobiliers ....................................................................................... 203 Sécurisation juridique des financements .................................................................................. 203 Suivi des opérations financées ................................................................................................. 204 Fiche technique n°8 : Points de vigilance pour les assureurs et CGP ........................... 205 Évaluation des risques liés à l'urbanisme .................................................................................. 205 Couverture assurantielle spécifique .......................................................................................... 205 Conseil en gestion de patrimoine immobilier ............................................................................. 205 Gestion des sinistres liés à l'urbanisme ..................................................................................... 206 COMPLEMENTS AU COURS DE DROIT DE L'URBANISME POUR LES PROFESSIONNELS ............................................................................................ 207 Étude de cas immobilier ........................................................................................................... 213 Étude de cas bancaire .............................................................................................................. 214 Étude de cas assurance ........................................................................................................... 214 CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 5 sur 237.
Scene 6 (11m 27s)
[Audio] Commentaires de jurisprudences majeures .............................................................. 215 CE, 26 juillet 2011, Commune de Ramatuelle ............................................................................ 215 CE, 15 avril 2016, SCI Fayolle .................................................................................................... 215 Cass. civ. 3e, 20 octobre 2021 ................................................................................................... 215 Référentiels et check-lists opérationnelles ............................................................................ 216 Check-list de conformité urbanistique avant achat immobilier ................................................... 216 Checklist de contrôle bancaire – Opération zone mixte .............................................................. 216 Grille d'éligibilité à l'urbanisation en ZAN ................................................................................... 216 Dossiers de veille juridique ou thématique ................................................................ 217 Dossier de veille ZAN – 2024-2027 ............................................................................................ 217 Fiche "Réformes à surveiller en 2025-2026" ............................................................................... 217 Tableau d'équivalence Loi / Code de l'urbanisme ....................................................................... 217 Chronologie des Événements Principaux .................................................................. 218 Lexique du droit de l'urbanisme ........................................................................ 220 Foire Aux Questions sur le Droit de l'Urbanisme en France ................................. 228 BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................ 231 Ouvrages généraux ................................................................................................... 231 Ouvrages spécialisés ............................................................................................... 232 Articles et revues spécialisées ................................................................................. 233 Ressources numériques ........................................................................................... 234 Codes et textes législatifs ........................................................................................ 235 Jurisprudence de référence ...................................................................................... 236 Rapports et études ................................................................................................... 237 CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 6 sur 237.
Scene 7 (12m 42s)
[Audio] CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 7 sur 237.
Scene 8 (12m 51s)
[Audio] INTRODUCTION GÉNÉRALE Contexte et enjeux du droit de l'urbanisme Le droit de l'urbanisme constitue un ensemble de règles et d'institutions qui régissent l'aménagement et l'utilisation des sols en France. Loin d'être une matière réservée aux seuls juristes spécialisés ou aux collectivités territoriales, il s'agit d'un corpus juridique qui impacte quotidiennement l'activité de nombreux professionnels, particulièrement dans les secteurs de l'immobilier, de la banque, de la finance et de l'assurance. Pour les agents immobiliers, les courtiers en crédits, les banquiers, les conseillers en gestion de patrimoine et les assureurs, la maîtrise des fondamentaux du droit de l'urbanisme est devenue une compétence indispensable. En eDet, les règles d'urbanisme déterminent ce qu'il est possible de construire, où et comment, influençant directement la valeur des biens immobiliers, leur finançabilité et les risques qui y sont associés. Dans un contexte marqué par des évolutions législatives constantes et une prise en compte croissante des enjeux environnementaux, la complexité du droit de l'urbanisme s'est considérablement accrue ces dernières années. La loi SRU de 2000, les lois Grenelle de 2009-2010, la loi ALUR de 2014, la loi ELAN de 2018 et plus récemment la loi Climat et Résilience de 2021 ont profondément modifié le cadre juridique de l'urbanisme en France, imposant aux professionnels une adaptation permanente de leurs pratiques. Par ailleurs, la transition numérique a transformé l'accès à l'information urbanistique, avec le développement de plateformes comme le Géoportail de l'Urbanisme ou la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. Ces évolutions oDrent de nouvelles opportunités mais exigent également l'acquisition de compétences spécifiques. Face à ces défis, ce cours se propose d'oDrir aux professionnels de l'immobilier, de la banque et de l'assurance une compréhension approfondie des fondamentaux du droit de l'urbanisme et de l'aménagement, adaptée à leurs besoins spécifiques et à leur pratique quotidienne. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 8 sur 237.
Scene 9 (15m 9s)
[Audio] Objectifs pédagogiques du cours Ce cours vise à permettre aux professionnels de : 1. Maîtriser les concepts fondamentaux du droit de l'urbanisme : comprendre l'organisation et la hiérarchie des normes d'urbanisme, identifier les diDérents documents d'urbanisme et leur portée juridique, connaître les principales procédures d'autorisation. 2. Appréhender les implications pratiques des règles d'urbanisme dans leur activité professionnelle : savoir vérifier la conformité d'un bien aux règles d'urbanisme, évaluer les risques juridiques liés à une opération immobilière, intégrer les contraintes d'urbanisme dans le montage financier d'un projet. 3. Développer une approche préventive des risques liés à l'urbanisme : identifier en amont les potentielles infractions aux règles d'urbanisme, sécuriser les transactions immobilières, anticiper les contentieux. 4. Utiliser eJicacement les outils numériques liés au droit de l'urbanisme : maîtriser les plateformes oDicielles de consultation des documents d'urbanisme, comprendre les procédures dématérialisées, exploiter les ressources en ligne. 5. Intégrer les évolutions récentes du droit de l'urbanisme, notamment celles liées à la transition écologique et à la lutte contre l'artificialisation des sols, dans leur pratique professionnelle. 6. Adapter leur conseil aux spécificités de chaque situation : développer une approche personnalisée en fonction du contexte local, du type de bien et du projet du client. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 9 sur 237.
Scene 10 (16m 46s)
[Audio] Méthodologie et structure du cours Ce cours adopte une approche à la fois théorique et pratique, permettant d'acquérir les connaissances fondamentales tout en développant des compétences directement applicables dans un contexte professionnel. La structure du cours est conçue pour permettre une progression pédagogique cohérente, partant des fondements historiques et théoriques pour aller vers des applications sectorielles spécifiques : La première partie présente les fondements et l'évolution du droit de l'urbanisme, oDrant une mise en perspective historique et une analyse du cadre législatif actuel. La deuxième partie détaille les documents d'urbanisme et la planification, expliquant la hiérarchie des normes et le contenu des diDérents documents. La troisième partie se concentre sur les autorisations d'urbanisme, leur instruction et leur exécution. La quatrième partie aborde le contentieux de l'urbanisme et les sanctions, présentant les recours possibles et les conséquences des infractions. La cinquième partie explore les outils numériques et plateformes oDicielles, essentiels à la pratique contemporaine du droit de l'urbanisme. La sixième partie analyse l'impact de la transition écologique sur le droit de l'urbanisme, un enjeu majeur pour les années à venir. La septième partie traite des risques et responsabilités liés au droit de l'urbanisme, avec une approche diDérenciée selon les métiers. Les huitième, neuvième et dixième parties proposent des applications sectorielles spécifiques, respectivement pour les agents immobiliers, les courtiers et banquiers, et les assureurs et CGP. La onzième partie présente des études de cas sectoriels croisés, illustrant la nécessaire collaboration entre les diDérents professionnels. Chaque partie est complétée par des fiches techniques récapitulatives, des exemples concrets et des modèles de documents, permettant une application immédiate des connaissances acquises. Le cours intègre également un lexique technique complet, une FAQ répondant aux questions fréquentes, et une bibliographie détaillée pour approfondir certains aspects. Cette structure répond aux besoins spécifiques des diDérents professionnels ciblés, avec une répartition proportionnelle du contenu : 60% pour les agents immobiliers, 20% CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 10 sur 237.
Scene 11 (19m 4s)
[Audio] pour les courtiers en crédits et banquiers, et 20% pour les courtiers en assurance, CGP et assureurs. À travers ce parcours pédagogique complet, ce cours ambitionne de devenir un véritable ouvrage de référence pour tous les professionnels confrontés aux enjeux du droit de l'urbanisme dans leur pratique quotidienne. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 11 sur 237.
Scene 12 (19m 29s)
[Audio] PARTIE I : FONDEMENTS ET ÉVOLUTION DU DROIT DE L'URBANISME Chapitre 1 : Histoire et fondements du droit de l'urbanisme 1. Les origines du droit de l'urbanisme 1.1 Les premières réflexions sur l'urbanisme L'organisation des villes et la réflexion sur leur aménagement ne sont pas des préoccupations récentes. Dès l'Antiquité, des penseurs comme Aristote, Platon ou Vitruve s'intéressaient déjà à l'organisation spatiale des cités. Vitruve, dans son traité "De Architectura" rédigé au Ier siècle avant J.-C., proposait déjà des principes d'aménagement urbain, tenant compte de l'orientation des rues, de la salubrité et de la défense de la cité. Au Moyen Âge, les villes se développent généralement de façon organique, autour d'un château, d'une église ou d'un monastère, sans véritable planification d'ensemble. Toutefois, certaines villes nouvelles, comme les bastides du Sud-Ouest de la France, témoignent d'une volonté de planification urbaine avec leur plan en damier caractéristique. La Renaissance marque un renouveau de l'intérêt pour l'urbanisme planifié, avec des architectes comme Alberti qui théorisent la "cité idéale". Cette période voit également l'émergence des premières réglementations urbaines modernes, principalement motivées par des préoccupations esthétiques et de sécurité. Cependant, pendant longtemps, le droit de l'urbanisme reste limité à des prescriptions locales imposées par les autorités aux propriétés privées, sans vision globale d'aménagement. La propriété privée, consacrée comme un droit "inviolable et sacré" par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, constitue un obstacle à l'émergence d'un véritable droit de l'urbanisme. 1.2 Les prémices du droit moderne de l'urbanisme (fin XIXe - début XXe siècle) C'est véritablement avec la révolution industrielle et l'exode rural massif qu'elle provoque que naît la nécessité d'un encadrement juridique de l'urbanisation. La croissance urbaine sans précédent du XIXe siècle engendre des problèmes majeurs d'insalubrité, de surpopulation et d'épidémies dans les villes. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 12 sur 237.
Scene 13 (21m 49s)
[Audio] En France, plusieurs textes législatifs posent les jalons de ce qui deviendra plus tard le droit de l'urbanisme : La loi du 13 avril 1850 sur l'assainissement des logements insalubres : première intervention significative de l'État dans le domaine de l'habitat, elle permet aux communes de créer des commissions chargées de rechercher et de faire supprimer les logements insalubres. La loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale : elle confie aux maires des pouvoirs de police en matière de construction, notamment pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues. La loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique : elle institue dans les grandes villes le premier permis de bâtir, pour des motifs de salubrité. Ce permis, ancêtre du permis de construire, n'est alors exigé que dans les villes de plus de 20 000 habitants. Ces premières législations sont essentiellement motivées par des préoccupations de santé publique et de sécurité, et non par une vision globale de l'aménagement urbain. Elles témoignent néanmoins d'une prise de conscience progressive de la nécessité d'encadrer le développement urbain. Parallèlement, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient l'émergence de réflexions théoriques sur l'urbanisme, avec des figures comme Ebenezer Howard et sa cité-jardin, ou Ildefons Cerdà qui utilise pour la première fois le terme "urbanisme" dans sa "Théorie générale de l'urbanisation" (1867). En France, le Musée social, fondé en 1894, joue un rôle important dans la diDusion des idées réformatrices en matière d'urbanisme. C'est au sein de cette institution qu'est créée en 1911 la Section d'hygiène urbaine et rurale, qui contribuera à l'élaboration de la première grande loi française d'urbanisme. 2. La naissance du droit de l'urbanisme moderne (1919-1943) 2.1 Les lois Cornudet (1919-1924) La Première Guerre mondiale, avec ses destructions massives, crée un contexte favorable à l'émergence d'une législation plus ambitieuse en matière d'urbanisme. La loi du 14 mars 1919, complétée par celle du 19 juillet 1924, dites "lois Cornudet" (du nom du député qui les a portées), marque véritablement la naissance du droit de l'urbanisme moderne en France. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 13 sur 237.
Scene 14 (24m 21s)
[Audio] Ces lois introduisent deux innovations majeures : Les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes : ces documents, ancêtres des plans d'urbanisme actuels, deviennent obligatoires pour les communes de plus de 10 000 habitants, celles du département de la Seine (Paris et sa proche banlieue), les stations balnéaires, thermales ou touristiques, ainsi que les agglomérations présentant un caractère pittoresque, artistique ou historique. Ces plans doivent prévoir "les créations ou transformations de voies publiques, les réserves pour jardins, terrains de jeux ou espaces libres, les emplacements destinés à des monuments ou services publics". La réglementation des lotissements : pour la première fois, la création de terrains destinés à être bâtis est soumise à autorisation administrative. Cette mesure vise à garantir aux acquéreurs de lots que leurs terrains seront convenablement viabilisés (adduction d'eau, réseaux d'égouts, alimentation électrique, chaussées pavées ou revêtues). Les lois Cornudet constituent une avancée considérable, mais leur mise en œuvre se heurte à de nombreuses diDicultés : manque de moyens techniques et financiers des communes, résistance des propriétaires fonciers, absence de sanctions eDicaces en cas de non-respect. En 1939, seuls 273 plans d'aménagement avaient été approuvés sur les 1 938 qui auraient dû être établis. 2.2 Les décrets-lois de 1935 Face aux diDicultés d'application des lois Cornudet et dans un contexte de crise économique, plusieurs décrets-lois sont adoptés en 1935 pour renforcer l'eDicacité du droit de l'urbanisme : Extension du champ d'application du permis de construire Élargissement des possibilités d'expropriation Introduction de la faculté de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation Création des groupements d'urbanisme, permettant d'élaborer des plans d'aménagement à l'échelle intercommunale Instauration des projets régionaux d'urbanisme, préfigurant les documents de planification à l'échelle régionale Ces décrets-lois enrichissent considérablement l'arsenal juridique de l'urbanisme, mais leur application reste limitée en raison du contexte politique et économique troublé de la fin des années 1930. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 14 sur 237.
Scene 15 (26m 40s)
[Audio] 2.3 La loi du 15 juin 1943 C'est paradoxalement sous le régime de Vichy que le droit de l'urbanisme connaît une avancée décisive avec l'acte dit Loi du 15 juin 1943. Cette loi, qui sera validée à la Libération par l'ordonnance du 27 octobre 1945, apporte plusieurs innovations majeures : Généralisation du permis de construire à l'ensemble du territoire national, alors qu'il n'était auparavant exigé que dans certaines zones Création d'une administration spécifique de l'urbanisme, avec des services départementaux placés sous l'autorité de l'État Renforcement des sanctions en cas d'infraction aux règles d'urbanisme Instauration des projets d'aménagement, documents plus précis et contraignants que les plans prévus par les lois Cornudet Cette loi marque une étape importante dans la centralisation et la systématisation du droit de l'urbanisme français. Elle pose les bases d'un contrôle administratif préalable des constructions qui perdure jusqu'à aujourd'hui. 3. L'urbanisme de la reconstruction et des Trente Glorieuses (1945-1967) 3.1 La reconstruction d'après-guerre La Seconde Guerre mondiale laisse la France face à un défi immense : reconstruire les villes détruites tout en faisant face à une crise du logement sans précédent, aggravée par l'exode rural, la croissance démographique et l'accueil de populations rapatriées. Pour répondre à ces défis, plusieurs dispositifs sont mis en place : Création du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) en 1944, qui deviendra plus tard le Ministère de l'Équipement Loi foncière du 6 août 1953 facilitant les expropriations pour cause d'utilité publique Décret n°58-1464 du 31 décembre 1958 créant les Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP), qui permettent la construction rapide de grands ensembles pour répondre à la crise du logement Cette période est marquée par une forte intervention de l'État dans l'aménagement du territoire, avec une vision fonctionnaliste de l'urbanisme inspirée par la Charte d'Athènes et les principes du mouvement moderne en architecture. Les grands ensembles qui caractérisent cette époque témoignent de cette approche : construction massive de logements standardisés, séparation des fonctions urbaines (habitat, travail, loisirs, circulation), importance accordée aux espaces verts. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 15 sur 237.
Scene 16 (29m 17s)
[Audio] Si cette politique permet de résorber en partie la crise du logement, elle engendre également des problèmes qui se révéleront plus tard : monotonie architecturale, manque d'équipements et de services, ségrégation sociale et spatiale. 3.2 La loi d'orientation foncière (LOF) de 1967 La loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 constitue une étape majeure dans l'évolution du droit de l'urbanisme français. Elle modernise en profondeur les outils de planification urbaine et introduit plusieurs innovations importantes : Création des Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) : documents de planification à l'échelle de l'agglomération, fixant les orientations fondamentales de l'aménagement Remplacement des plans d'urbanisme par les Plans d'Occupation des Sols (POS) : documents plus précis, établis à l'échelle communale, définissant les règles applicables à chaque parcelle Instauration de la taxe locale d'équipement, permettant aux communes de financer les équipements publics rendus nécessaires par l'urbanisation Création des Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), procédure plus souple que les ZUP pour réaliser des opérations d'aménagement Séparation claire entre les règles d'urbanisme et les règles de construction : les premières sont contrôlées par le permis de construire, les secondes relèvent d'une réglementation technique distincte La LOF marque également une évolution dans la conception même de l'urbanisme, qui n'est plus seulement envisagé comme un outil de reconstruction ou de production massive de logements, mais comme un moyen d'organiser de façon cohérente le développement urbain à diDérentes échelles. Cette loi pose les bases d'un système de planification à deux niveaux (intercommunal et communal) qui, malgré plusieurs réformes, structure encore aujourd'hui le droit de l'urbanisme français. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 16 sur 237.
Scene 17 (31m 18s)
[Audio] 4. La décentralisation et l'émergence des préoccupations environnementales (19752000) 4.1 Le renforcement des outils d'intervention foncière Les années 1970 voient le développement de nouveaux outils permettant aux collectivités d'intervenir sur le marché foncier : La loi n°75-1328 du 31 décembre 1975 crée les Zones d'Intervention Foncière (ZIF), qui donnent aux communes un droit de préemption dans les zones urbaines des POS La loi n°85-729 du 18 juillet 1985 institue le Droit de Préemption Urbain (DPU), qui remplace les ZIF et simplifie les procédures de préemption La loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 instaure le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé (ZAD) Ces outils permettent aux collectivités de constituer des réserves foncières et de mieux maîtriser le développement urbain, en acquérant des terrains stratégiques avant qu'ils ne fassent l'objet de spéculation. 4.2 Les lois de décentralisation Les lois de décentralisation du début des années 1980, et notamment la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, marquent un tournant majeur dans l'histoire du droit de l'urbanisme français. Jusqu'alors, l'urbanisme était largement une compétence de l'État. La décentralisation transfère aux communes l'élaboration des documents d'urbanisme (POS) et la délivrance des autorisations de construire, sous réserve d'être dotées d'un POS approuvé. Cette réforme répond à une aspiration démocratique : rapprocher les décisions d'urbanisme des citoyens et de leurs représentants élus. Elle reconnaît également la légitimité des communes à définir leur propre projet de développement urbain. Toutefois, l'État conserve un rôle important à travers : - Le contrôle de légalité des actes des collectivités - L'élaboration des règles nationales d'urbanisme - La définition des servitudes d'utilité publique - La possibilité de se substituer aux communes dans certains cas (projets d'intérêt général, opérations d'intérêt national) La décentralisation de l'urbanisme s'accompagne d'une responsabilisation accrue des communes, qui doivent désormais assumer les conséquences juridiques et financières de leurs décisions en matière d'aménagement. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 17 sur 237.
Scene 18 (34m 2s)
[Audio] 4.3 L'intégration des préoccupations environnementales À partir des années 1970, les préoccupations environnementales commencent à influencer le droit de l'urbanisme. Plusieurs lois témoignent de cette évolution : La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature introduit l'étude d'impact pour les projets d'aménagement La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (loi Montagne) vise à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques de la montagne La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (loi Littoral) limite l'urbanisation des espaces proches du rivage La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (loi Paysage) renforce la prise en compte des paysages dans les documents d'urbanisme Ces lois marquent une inflexion importante dans la conception de l'urbanisme : il ne s'agit plus seulement d'organiser le développement urbain, mais aussi de protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que les paysages. Cette période voit également émerger la notion de développement durable, qui sera consacrée par la loi SRU en 2000 comme un objectif fondamental du droit de l'urbanisme. Conclusion du chapitre L'histoire du droit de l'urbanisme en France reflète l'évolution des préoccupations de la société française : d'abord centré sur des questions de salubrité et de reconstruction, il s'est progressivement enrichi pour intégrer des dimensions de planification stratégique, de protection de l'environnement et de développement durable. Cette évolution historique a façonné le cadre juridique complexe qui régit aujourd'hui l'aménagement du territoire français, et qui continue d'évoluer pour répondre aux défis contemporains : étalement urbain, transition écologique, renouvellement urbain, mixité sociale. Pour les professionnels de l'immobilier, de la banque et de l'assurance, comprendre cette histoire est essentiel pour saisir la logique et les fondements du droit actuel de l'urbanisme, ainsi que pour anticiper ses évolutions futures. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 18 sur 237.
Scene 19 (36m 31s)
[Audio] Chapitre 2 : Le cadre législatif actuel 1. La loi SRU (2000) : fondement du droit de l'urbanisme contemporain 1.1 Contexte et objectifs de la loi SRU La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, communément appelée loi SRU, constitue une réforme majeure du droit de l'urbanisme français. Elle intervient dans un contexte marqué par plusieurs constats préoccupants : L'étalement urbain et la périurbanisation croissante, entraînant une consommation excessive d'espaces naturels et agricoles La ségrégation sociale et spatiale dans les agglomérations L'inadaptation des documents d'urbanisme existants face aux enjeux contemporains La nécessité d'intégrer les principes du développement durable dans la planification urbaine Face à ces défis, la loi SRU poursuit trois objectifs principaux : - Renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales - Assurer une plus grande mixité sociale dans l'habitat - Mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable 1.2 Les principes fondamentaux La loi SRU introduit à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme (devenu L.101-2) des principes fondamentaux que doivent respecter tous les documents d'urbanisme. Ces principes, qui constituent le socle du droit contemporain de l'urbanisme, sont : L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la préservation des espaces agricoles et naturels, et la protection des sites, des milieux et paysages La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction suffisantes pour satisfaire les besoins présents et futurs L'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement, la préservation de l'environnement et la prévention des risques Ces principes, qui s'imposent à tous les documents d'urbanisme, traduisent une vision renouvelée de l'aménagement du territoire, intégrant pleinement les préoccupations environnementales et sociales. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 19 sur 237.
Scene 20 (38m 58s)
[Audio] 1.3 Les nouveaux documents d'urbanisme La loi SRU réforme en profondeur les documents d'urbanisme, en remplaçant les outils existants par de nouveaux documents plus adaptés aux enjeux contemporains : Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) remplace le Schéma Directeur. Document stratégique de planification à l'échelle intercommunale, il définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire cohérent, généralement à l'échelle d'une aire urbaine ou d'un bassin de vie. Le SCoT doit notamment déterminer les conditions permettant d'assurer la cohérence entre urbanisation, préservation des espaces naturels et agricoles, et organisation des déplacements. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) succède au Plan d'Occupation des Sols (POS). Plus qu'un simple document réglementaire fixant les règles d'utilisation du sol, le PLU est un véritable projet urbain qui exprime le projet de développement durable de la commune. Il comprend notamment un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), innovation majeure qui oblige les communes à expliciter leur vision à long terme de l'aménagement de leur territoire. La carte communale est maintenue mais son régime juridique est précisé et renforcé. Elle devient un véritable document d'urbanisme, opposable aux tiers, qui délimite les secteurs constructibles et non constructibles de la commune. Ces nouveaux documents d'urbanisme se caractérisent par une approche plus stratégique et prospective, une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, et une articulation plus cohérente entre les diDérentes échelles territoriales. 1.4 L'obligation de mixité sociale L'article 55 de la loi SRU, probablement sa disposition la plus connue et la plus controversée, impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) situées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d'au moins 20% de logements sociaux dans leur parc de résidences principales. Les communes qui ne respectent pas ce seuil sont soumises à un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales, proportionnel au nombre de logements sociaux manquants. Elles doivent également s'engager dans un plan de rattrapage pour atteindre progressivement le quota requis. Cette disposition vise à lutter contre la ségrégation sociale et spatiale en assurant une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire. Elle a été renforcée par la loi du 18 janvier 2013 (loi Duflot), qui a porté le taux obligatoire à 25% dans certaines zones tendues et renforcé les sanctions en cas de non-respect. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 20 sur 237.
Scene 21 (41m 49s)
[Audio] Pour les professionnels de l'immobilier et de la banque, cette obligation a des implications concrètes : - Elle influence la programmation immobilière dans les communes concernées - Elle peut conditionner l'obtention de certaines autorisations d'urbanisme - Elle crée des opportunités pour les opérateurs spécialisés dans le logement social CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 21 sur 237.
Scene 22 (42m 16s)
[Audio] 2. Les lois Grenelle (2009-2010) : l'intégration des préoccupations environnementales 2.1 Contexte et objectifs des lois Grenelle Les lois Grenelle sont issues du "Grenelle de l'environnement", vaste consultation nationale lancée en 2007 réunissant l'État, les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises et les associations environnementales. Ce processus a abouti à deux lois : La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite "Grenelle I" La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle II" Ces lois visent à intégrer de façon plus ambitieuse les enjeux environnementaux dans les politiques publiques, notamment en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 2.2 Les objectifs de développement durable Les lois Grenelle renforcent considérablement la dimension environnementale du droit de l'urbanisme, en assignant aux documents d'urbanisme de nouveaux objectifs : La réduction des émissions de gaz à effet de serre La maîtrise de l'énergie et la production d'énergie à partir de sources renouvelables La préservation de la biodiversité, notamment par la conservation et la restauration des continuités écologiques L'amélioration des performances énergétiques des bâtiments La diminution des obligations de déplacement par une meilleure corrélation entre urbanisme et transports collectifs Ces objectifs doivent désormais être pris en compte dans l'élaboration de tous les documents d'urbanisme, qui deviennent ainsi des outils au service de la transition écologique. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 22 sur 237.
Scene 23 (44m 13s)
[Audio] 2.3 La lutte contre l'étalement urbain Les lois Grenelle renforcent les dispositifs de lutte contre l'étalement urbain, phénomène particulièrement consommateur d'espaces naturels et agricoles et générateur de déplacements motorisés : Les SCoT et les PLU doivent désormais présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédentes et fixer des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation Les SCoT peuvent désormais imposer des conditions à l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation, notamment en termes de desserte par les transports collectifs Les PLU peuvent fixer des densités minimales de construction dans certains secteurs, notamment à proximité des transports collectifs Ces dispositions visent à promouvoir un modèle de développement urbain plus compact et moins consommateur d'espace, privilégiant la densification et le renouvellement urbain plutôt que l'extension urbaine. 2.4 La trame verte et bleue L'une des innovations majeures des lois Grenelle est l'introduction de la notion de "trame verte et bleue", outil d'aménagement du territoire visant à préserver et restaurer les continuités écologiques : La "trame verte" correspond aux corridors écologiques terrestres : espaces naturels, corridors écologiques, zones tampon La "trame bleue" désigne le réseau aquatique et humide : cours d'eau, zones humides, etc. Les documents d'urbanisme doivent désormais prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), qui identifient et cartographient la trame verte et bleue à l'échelle régionale. Cette innovation marque une évolution importante dans la conception de la protection de l'environnement : il ne s'agit plus seulement de protéger des espaces remarquables isolés, mais de préserver et restaurer des continuités écologiques permettant aux espèces de circuler et d'accomplir leur cycle de vie. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 23 sur 237.
Scene 24 (46m 19s)
[Audio] 3. La loi ALUR (2014) : renforcement de l'intercommunalité et lutte contre l'étalement urbain 3.1 Contexte et objectifs de la loi ALUR La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, s'inscrit dans un contexte de crise du logement marqué par une hausse continue des prix, une pénurie de logements dans les zones tendues et des diDicultés d'accès au logement pour les ménages modestes. Cette loi poursuit trois objectifs principaux : - Favoriser l'accès au logement en régulant les marchés immobiliers - Lutter contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées - Promouvoir un urbanisme durable en luttant contre l'étalement urbain 3.2 Le transfert de la compétence PLU aux intercommunalités L'une des mesures phares de la loi ALUR est le transfert automatique de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU) aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, sauf opposition d'une minorité de blocage (25% des communes représentant au moins 20% de la population). Ce transfert vise à promouvoir une planification urbaine à l'échelle intercommunale, plus cohérente avec les bassins de vie et les enjeux contemporains (mobilité, environnement, développement économique). Il conduit à l'élaboration de Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux (PLUi), qui couvrent l'intégralité du territoire communautaire. Pour les professionnels de l'immobilier et de la banque, ce changement d'échelle a des implications importantes : - Une harmonisation progressive des règles d'urbanisme à l'échelle intercommunale - Une vision plus stratégique et cohérente du développement territorial - Une meilleure articulation entre urbanisme, habitat et déplacements 3.3 La suppression du CoeDicient d'Occupation des Sols (COS) La loi ALUR supprime le CoeDicient d'Occupation des Sols (COS), qui définissait la densité maximale de construction autorisée sur un terrain. Cet outil, jugé trop rigide et peu adapté aux objectifs de densification urbaine, est remplacé par d'autres règles permettant de déterminer la constructibilité des terrains : - L'emprise au sol des constructions - La hauteur des bâtiments - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les règles de prospect (distance entre les constructions) Cette suppression vise à favoriser la densification des zones déjà urbanisées, en permettant une utilisation plus optimale du foncier disponible, tout en préservant la qualité urbaine et paysagère. 3.4 La suppression de la superficie minimale des terrains constructibles Dans la même logique, la loi ALUR supprime la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans les PLU. Cette règle, souvent utilisée pour CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 24 sur 237.
Scene 25 (49m 28s)
[Audio] limiter la densification dans certains quartiers, est jugée contraire aux objectifs de mixité sociale et de lutte contre l'étalement urbain. Sa suppression permet notamment : - De faciliter la division parcellaire et la construction sur des petits terrains - De favoriser la densification douce des tissus pavillonnaires - De réduire les coûts d'accès au foncier 3.5 La modernisation du droit de préemption La loi ALUR renforce et modernise le droit de préemption urbain (DPU), outil stratégique permettant aux collectivités d'acquérir en priorité des biens mis en vente dans certaines zones : Extension du champ d'application du DPU aux aliénations à titre gratuit Possibilité de déléguer le DPU à des établissements publics fonciers Renforcement de l'obligation d'information des collectivités Allongement du délai de préemption à deux mois (contre un mois auparavant) Encadrement plus strict du prix de préemption Ces évolutions visent à faire du droit de préemption un outil plus eDicace au service des politiques foncières des collectivités, notamment pour la production de logements sociaux et la lutte contre la spéculation foncière. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 25 sur 237.
Scene 26 (50m 47s)
[Audio] 4. La loi ELAN (2018) : simplification et accélération des procédures 4.1 Contexte et objectifs de la loi ELAN La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, s'inscrit dans une volonté de simplification et d'accélération des procédures d'urbanisme et de construction, pour répondre à la crise du logement et dynamiser le secteur de la construction. Cette loi poursuit quatre objectifs principaux : - Construire plus, mieux et moins cher - Restructurer le secteur du logement social - Répondre aux besoins de tous et favoriser la mixité sociale - Améliorer le cadre de vie et renforcer la cohésion sociale 4.2 Les Opérations d'Intérêt National (OIN) La loi ELAN modernise le cadre des Opérations d'Intérêt National (OIN), procédure d'exception permettant à l'État de conserver la maîtrise de l'aménagement sur des territoires stratégiques. Elle pose notamment des critères d'éligibilité à cette catégorie : L'importance des enjeux et la dimension nationale de l'opération d'aménagement L'allocation de moyens particuliers à l'opération par l'État La loi autorise également, dans les OIN, les constructions en dehors des parties urbanisées de la commune, par dérogation au principe de constructibilité limitée. 4.3 Les Grandes Opérations d'Urbanisme (GOU) La loi ELAN crée un nouvel outil juridique, la Grande Opération d'Urbanisme (GOU), associée à un dispositif contractuel, le Projet Partenarial d'Aménagement (PPA). Cette innovation vise à faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement complexes nécessitant une forte coordination entre acteurs publics et privés. La GOU permet notamment : - De déroger à certaines règles d'urbanisme - De confier la réalisation d'équipements publics à l'intercommunalité - De rendre les documents d'urbanisme et les normes supérieures compatibles avec l'opération au moyen d'une procédure intégrée Cet outil vise à favoriser des projets urbains mieux partagés, à libérer le foncier constructible et à produire davantage de logements dans des quartiers de ville durable. 4.4 Les Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT) L'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) est un nouvel outil créé par la loi ELAN pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, en faveur des centres-villes. Elle vise leur requalification en facilitant la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 26 sur 237.
Scene 27 (53m 48s)
[Audio] L'ORT se matérialise par une convention signée entre l'intercommunalité, sa ville principale, d'autres communes-membres volontaires, l'État et ses établissements publics. Elle confère des avantages juridiques et fiscaux : - Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale - Éligibilité au dispositif de défiscalisation "Denormandie dans l'ancien" - Droit de préemption urbain renforcé - Procédure d'abandon manifeste facilitée Cet outil s'inscrit dans la continuité du plan "Action cœur de ville" lancé en 2018 pour revitaliser les centres des villes moyennes. 4.5 La simplification des procédures pour les ZAC La loi ELAN simplifie les procédures pour conduire les opérations d'aménagement, notamment en matière de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) : La délibération d'approbation du PLU contenant des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) peut désormais valoir acte de création de la ZAC La concertation (obligatoire) pour la création de la zone et la concertation (facultative) visant les projets situés dans cette zone peuvent être menées simultanément Ces simplifications visent à accélérer la réalisation des opérations d'aménagement et à réduire les délais de production de logements. 4.6 La modification de la loi Littoral La loi ELAN modifie pour la première fois depuis 1986 la loi Littoral, avec pour objectif principal de permettre l'urbanisation de certaines "dents creuses" par dérogation à la règle de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants. Cette possibilité est toutefois limitée aux "secteurs déjà urbanisés" (à distinguer des "zones d'urbanisation diDuses"), qui doivent être identifiés par le SCoT et délimités par le PLU. L'urbanisation de ces secteurs ne doit pas avoir pour eDet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Cette évolution vise à répondre aux diDicultés rencontrées dans l'application de la loi Littoral, tout en préservant ses principes fondamentaux de protection du littoral. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 27 sur 237.
Scene 28 (56m 8s)
[Audio] 5. La loi Climat et Résilience (2021) : lutte contre l'artificialisation des sols 5.1 Contexte et objectifs de la loi Climat et Résilience La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses eDets, dite loi Climat et Résilience, est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Elle vise à accélérer la transition écologique de la société et de l'économie françaises. En matière d'urbanisme, cette loi introduit des dispositions ambitieuses pour lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, phénomènes qui contribuent à la perte de biodiversité, à l'augmentation des émissions de gaz à eDet de serre et à la vulnérabilité face aux risques naturels. 5.2 L'objectif "Zéro Artificialisation Nette" (ZAN) La loi Climat et Résilience introduit dans le Code de l'urbanisme un objectif d'absence d'artificialisation nette des sols à terme, communément appelé "Zéro Artificialisation Nette" (ZAN). Pour atteindre progressivement cet objectif, la loi fixe un calendrier contraignant : Réduction de 50% du rythme d'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la loi (2021-2031) par rapport à la décennie précédente Poursuite de l'effort de réduction du rythme d'artificialisation pour atteindre l'objectif ZAN en 2050 Cet objectif s'impose à tous les documents de planification et d'urbanisme, qui doivent être mis en compatibilité dans des délais précis. 5.3 La définition légale de l'artificialisation des sols La loi Climat et Résilience introduit pour la première fois une définition légale de l'artificialisation des sols, qui est définie comme "l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La loi définit également la notion de "renaturation" (ou désartificialisation) comme des "actions ou opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour eDet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé". L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. Ces définitions sont essentielles pour la mise en œuvre opérationnelle de l'objectif ZAN, car elles permettent de mesurer et de suivre l'artificialisation des sols. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 28 sur 237.
Scene 29 (59m 7s)
[Audio] 5.4 L'intégration dans les documents d'urbanisme La loi Climat et Résilience impose l'intégration de l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols dans tous les documents de planification et d'urbanisme, selon une logique descendante : 1. Les Schémas Régionaux d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) doivent fixer une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence d'artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation 2. Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) doivent décliner ces objectifs entre les diDérentes parties du territoire qu'ils couvrent 3. Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) doivent intégrer ces objectifs et définir les conditions permettant de les atteindre Cette intégration en cascade vise à assurer une cohérence dans la mise en œuvre de l'objectif ZAN à toutes les échelles territoriales. 5.5 L'encadrement de l'ouverture à l'urbanisation La loi Climat et Résilience renforce considérablement l'encadrement de l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux espaces : Le PLU ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés Cette étude doit tenir compte de la capacité à mobiliser eDectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée du PLU Les SCoT peuvent subordonner l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs à des conditions plus strictes, comme la desserte par les transports collectifs ou la performance environnementale renforcée des constructions Ces dispositions visent à privilégier systématiquement la densification et le renouvellement urbain par rapport à l'extension urbaine, conformément à l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 29 sur 237.
Scene 30 (1h 1m 19s)
[Audio] Conclusion du chapitre Le cadre législatif actuel du droit de l'urbanisme en France est le fruit d'une évolution progressive, marquée par une prise en compte croissante des enjeux environnementaux et sociaux. De la loi SRU en 2000 à la loi Climat et Résilience en 2021, les grandes réformes législatives ont profondément modifié les objectifs, les outils et les procédures du droit de l'urbanisme. Ces évolutions traduisent un changement de paradigme dans la conception même de l'urbanisme : d'une approche essentiellement fonctionnelle et quantitative, centrée sur la production de logements et d'équipements, on est passé à une vision plus qualitative et durable, intégrant pleinement les dimensions environnementales, sociales et économiques du développement territorial. Pour les professionnels de l'immobilier, de la banque et de l'assurance, la maîtrise de ce cadre législatif est essentielle pour comprendre les contraintes et les opportunités qui s'oDrent à eux dans leurs activités respectives. Elle leur permet notamment : D'anticiper les évolutions futures du marché immobilier, notamment sous l'effet des contraintes croissantes en matière d'artificialisation des sols D'identifier les secteurs stratégiques pour le développement de projets immobiliers D'évaluer correctement les risques juridiques liés aux opérations immobilières De conseiller efficacement leurs clients sur les implications des règles d'urbanisme pour leurs projets Dans les chapitres suivants, nous examinerons plus en détail les documents d'urbanisme et les procédures qui découlent de ce cadre législatif, ainsi que leurs applications concrètes pour les diDérents professionnels concernés. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 30 sur 237.
Scene 31 (1h 3m 6s)
[Audio] PARTIE II : LES DOCUMENTS D'URBANISME ET LA PLANIFICATION Chapitre 3 : La hiérarchie des normes en urbanisme 1. Les principes généraux du droit de l'urbanisme 1.1 Les objectifs généraux définis par le Code de l'urbanisme Le Code de l'urbanisme, dans son article L.101-2, définit les objectifs généraux que doivent poursuivre les collectivités publiques en matière d'urbanisme. Ces objectifs constituent le socle fondamental du droit de l'urbanisme et s'imposent à tous les documents de planification et d'urbanisme. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 31 sur 237.
Scene 32 (1h 3m 48s)
[Audio] Ces objectifs sont regroupés en sept grandes catégories : 1. L'équilibre entre : 2. Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 3. Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la lutte contre l'étalement urbain 4. Une utilisation économe des espaces naturels et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 5. La protection des sites, des milieux et paysages naturels 6. La sauvegarde des ensembles urbains et la protection du patrimoine culturel 7. Les besoins en matière de mobilité 8. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 9. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suDisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général, ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial 10. La sécurité et la salubrité publiques 11. La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature 12. La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 13. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à eDet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, ainsi que la lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme Ces objectifs, qui ont été progressivement enrichis au fil des réformes législatives (loi SRU, lois Grenelle, loi ALUR, loi Climat et Résilience), reflètent l'évolution des préoccupations de la société française en matière d'aménagement du territoire et d'environnement. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 32 sur 237.
Scene 33 (1h 6m 23s)
[Audio] Pour les professionnels de l'immobilier, de la banque et de l'assurance, ces objectifs généraux constituent un cadre de référence essentiel pour comprendre l'esprit des règles d'urbanisme et anticiper leurs évolutions futures. 1.2 Le principe de constructibilité limitée Le principe de constructibilité limitée, introduit par la loi du 7 janvier 1983 et codifié à l'article L.111-3 du Code de l'urbanisme, vise à lutter contre le mitage des espaces naturels et agricoles en limitant les possibilités de construction en dehors des parties urbanisées des communes. Ce principe s'applique dans les communes qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme (PLU ou carte communale). Dans ces communes, soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU), les constructions ne sont autorisées que dans les parties urbanisées de la commune, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi : L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil pour les gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à la réalisation d'opérations d'intérêt national Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si l'intérêt de la commune le justifie, notamment pour éviter une diminution de la population communale Ce principe constitue une incitation forte pour les communes à se doter d'un document d'urbanisme, afin de maîtriser leur développement urbain. Il représente également une garantie contre l'urbanisation anarchique des territoires non couverts par un document d'urbanisme. Pour les professionnels de l'immobilier, ce principe a des implications concrètes sur la constructibilité des terrains situés dans les communes sans document d'urbanisme, et donc sur leur valeur et leur commercialisation. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 33 sur 237.
Scene 34 (1h 8m 33s)
[Audio] 1.3 Le principe de développement durable Le principe de développement durable est devenu un principe fondamental du droit de l'urbanisme, notamment depuis la loi SRU de 2000. Il est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En matière d'urbanisme, ce principe se traduit par plusieurs exigences : Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux La maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile La préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique La prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature Ce principe irrigue l'ensemble du droit de l'urbanisme et s'impose à tous les documents de planification et d'urbanisme. Il a conduit à une évolution profonde des pratiques d'aménagement, privilégiant désormais la densification urbaine, la mixité fonctionnelle, la préservation des espaces naturels et agricoles, et la promotion des mobilités douces. Pour les professionnels de l'immobilier et de la finance, ce principe a des implications concrètes sur la conception des projets immobiliers, leur localisation, leur performance environnementale et leur financement. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 34 sur 237.
Scene 35 (1h 10m 14s)
[Audio] 2. Les documents de planification supra-communaux 2.1 Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) est un document de planification stratégique à l'échelle régionale, créé par la loi NOTRe du 7 août 2015. Il remplace et intègre plusieurs schémas sectoriels antérieurs : schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT), schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), schéma régional de l'intermodalité (SRI), schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière : - D'équilibre et d'égalité des territoires - D'implantation des diDérentes infrastructures d'intérêt régional - De désenclavement des territoires ruraux - D'habitat - De gestion économe de l'espace - D'intermodalité et de développement des transports - De maîtrise et de valorisation de l'énergie - De lutte contre le changement climatique - De pollution de l'air - De protection et de restauration de la biodiversité - De prévention et de gestion des déchets Depuis la loi Climat et Résilience de 2021, le SRADDET doit également fixer une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence d'artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Le SRADDET est composé : - D'un rapport consacré aux objectifs du schéma - D'un fascicule regroupant les règles générales - De documents annexes Le SRADDET est élaboré par la région, en association avec les départements, les métropoles, les établissements publics porteurs de SCoT, les collectivités territoriales à statut particulier et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il est approuvé par arrêté du préfet de région. Le SRADDET s'impose aux documents d'urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU, cartes communales) dans un rapport de prise en compte pour les objectifs et de compatibilité pour les règles générales du fascicule. Pour les professionnels de l'immobilier et de la finance, le SRADDET constitue un document stratégique important, car il définit les grandes orientations régionales en matière d'aménagement et de développement durable, qui influenceront les documents d'urbanisme locaux et donc les possibilités de construction et d'aménagement. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 35 sur 237.
Scene 36 (1h 13m 10s)
[Audio] 2.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à l'échelle intercommunale, créé par la loi SRU de 2000. Il vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles en matière d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement et de paysage à l'échelle d'un large bassin de vie ou d'une aire urbaine. Le SCoT détermine les conditions d'un développement équilibré du territoire, respectant les principes du développement durable. Il constitue un cadre de référence pour les diDérentes politiques sectorielles et un document pivot entre les documents de planification supérieurs (SRADDET notamment) et les documents d'urbanisme communaux et intercommunaux (PLU, PLUi, cartes communales). Le SCoT comprend trois documents principaux : 1. Le rapport de présentation : il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs. Il s'appuie sur un diagnostic territorial et une évaluation environnementale. 2. Le projet d'aménagement stratégique (PAS) : il définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Il remplace, depuis l'ordonnance du 17 juin 2020, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 3. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) : il détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace, les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers, les conditions d'un développement urbain maîtrisé, les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, etc. C'est le document opposable du SCoT. Le SCoT est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou par un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma. Il est approuvé après enquête publique. Depuis la loi ALUR de 2014, le SCoT est devenu le document pivot de la planification territoriale. En l'absence de SCoT, les communes sont soumises au principe d'urbanisation limitée, qui restreint fortement les possibilités d'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones. Pour les professionnels de l'immobilier, de la banque et de l'assurance, le SCoT est un document essentiel à connaître, car il définit les grandes orientations d'aménagement du territoire qui s'imposeront aux PLU et donc aux projets immobiliers. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 36 sur 237.
Scene 37 (1h 16m 8s)
[Audio] 2.3 Les schémas de secteur Les schémas de secteur sont des documents qui peuvent préciser et détailler le contenu du SCoT sur certaines parties du territoire. Ils permettent d'adapter les orientations générales du SCoT aux spécificités de certains secteurs géographiques. Les schémas de secteur comprennent les mêmes documents que le SCoT (rapport de présentation, projet d'aménagement stratégique, document d'orientation et d'objectifs) et sont élaborés, révisés et modifiés selon les mêmes procédures. Ils doivent être compatibles avec le SCoT et ne peuvent pas en modifier l'économie générale. Ils constituent un outil de souplesse permettant d'adapter la planification territoriale aux réalités locales, tout en maintenant la cohérence d'ensemble assurée par le SCoT. Les schémas de secteur sont toutefois de moins en moins utilisés, la tendance étant plutôt à l'intégration directe des spécificités locales dans le SCoT, notamment à travers des orientations territorialisées dans le document d'orientation et d'objectifs. 3. Les rapports entre les diDérentes normes 3.1 La conformité La conformité est le rapport juridique le plus exigeant entre deux normes. Une norme est conforme à une norme supérieure lorsqu'elle respecte strictement les prescriptions de cette dernière, sans possibilité d'adaptation ou d'interprétation. En droit de l'urbanisme, le rapport de conformité s'applique principalement entre : - Les autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.) et les règles d'urbanisme qui leur sont applicables (PLU, RNU, etc.) - Les travaux réalisés et l'autorisation d'urbanisme délivrée Par exemple, un permis de construire doit être strictement conforme au règlement du PLU applicable à la zone concernée. De même, les travaux réalisés doivent être strictement conformes au permis de construire délivré. La non-conformité entraîne l'illégalité de l'acte ou de la construction et peut conduire à son annulation ou à sa démolition. 3.2 La compatibilité La compatibilité est un rapport juridique moins contraignant que la conformité. Une norme est compatible avec une norme supérieure lorsqu'elle n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de cette dernière et qu'elle contribue, même partiellement, à leur réalisation. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 37 sur 237.
Scene 38 (1h 18m 39s)
[Audio] La compatibilité implique une obligation de non-contrariété aux aspects essentiels de la norme supérieure : la norme inférieure ne doit pas avoir pour eDet ou pour objet d'empêcher ou de faire obstacle à l'application de la norme supérieure. En droit de l'urbanisme, le rapport de compatibilité s'applique principalement entre : - Le PLU et le SCoT - Le SCoT et les règles générales du SRADDET - Le PLU et les programmes locaux de l'habitat (PLH) - Le PLU et les plans de mobilité (PDM) Par exemple, un PLU est compatible avec un SCoT s'il ne contredit pas les orientations fondamentales de ce dernier, même s'il ne met pas en œuvre l'intégralité de ses prescriptions. La compatibilité laisse une marge d'appréciation aux auteurs des documents d'urbanisme, ce qui permet une adaptation aux spécificités locales. 3.3 La prise en compte La prise en compte est le rapport juridique le moins contraignant entre deux normes. Une norme prend en compte une norme supérieure lorsqu'elle ne l'ignore pas et ne s'écarte pas de ses orientations fondamentales, sauf pour un motif tiré de l'intérêt de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie. La prise en compte implique une obligation de ne pas ignorer la norme supérieure, mais permet de s'en écarter pour des motifs justifiés. En droit de l'urbanisme, le rapport de prise en compte s'applique principalement entre : - Le SCoT et les objectifs du SRADDET - Le PLU et certains plans et programmes, comme les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) Par exemple, un SCoT prend en compte les objectifs du SRADDET s'il ne les ignore pas et s'eDorce de les mettre en œuvre, même s'il peut s'en écarter pour des motifs justifiés par les spécificités du territoire. La prise en compte oDre une plus grande souplesse que la compatibilité, tout en assurant une certaine cohérence entre les diDérentes normes d'urbanisme. Conclusion du chapitre La hiérarchie des normes en urbanisme constitue un système complexe mais cohérent, qui vise à assurer l'articulation entre les diDérentes échelles de planification territoriale, de l'échelon national à l'échelon local. Cette hiérarchie repose sur trois types de rapports juridiques (conformité, compatibilité, prise en compte), qui définissent le degré de contrainte qu'une norme supérieure exerce sur une norme inférieure. Pour les professionnels de l'immobilier, de la banque et de l'assurance, la compréhension de cette hiérarchie est essentielle pour : - Évaluer correctement la constructibilité d'un terrain - Anticiper les évolutions possibles des règles d'urbanisme - Sécuriser CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 38 sur 237.
Scene 39 (1h 21m 30s)
[Audio] juridiquement les opérations immobilières - Conseiller eDicacement leurs clients sur les implications des règles d'urbanisme pour leurs projets Dans le chapitre suivant, nous examinerons plus en détail les documents d'urbanisme locaux (PLU, PLUi, carte communale) qui constituent le cadre réglementaire direct applicable aux projets immobiliers. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 39 sur 237.
Scene 40 (1h 21m 59s)
[Audio] Chapitre 4 : Les documents d'urbanisme locaux 1. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 1.1 Contenu et élaboration Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme à l'échelle communale. Créé par la loi SRU de 2000 en remplacement du Plan d'Occupation des Sols (POS), il définit les règles d'occupation et d'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire communal. Le PLU est bien plus qu'un simple document réglementaire : il exprime un véritable projet de territoire, en fixant les règles d'aménagement et d'utilisation des sols en cohérence avec les objectifs de développement durable. Le contenu du PLU est défini par les articles L.151-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Il comprend obligatoirement : Un rapport de présentation Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) Un règlement Des annexes CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 40 sur 237.
Scene 41 (1h 23m 19s)
[Audio] Le PLU peut également comporter des plans de secteurs qui précisent les orientations d'aménagement et les règles spécifiques à certains quartiers ou secteurs. L'élaboration du PLU est une procédure complexe qui comprend plusieurs étapes : 1. Prescription : délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent, qui fixe les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation 2. Élaboration du projet : diagnostic territorial, définition du PADD, élaboration des OAP et du règlement 3. Débat sur le PADD : au sein du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI, au moins deux mois avant l'arrêt du projet 4. Arrêt du projet : délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI 5. Consultation des personnes publiques associées (État, région, département, chambres consulaires, etc.) qui disposent de trois mois pour émettre un avis 6. Enquête publique : d'une durée minimale d'un mois, elle permet au public de consulter le projet et de formuler des observations 7. Approbation : délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI, qui peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations recueillis Le PLU est opposable aux tiers, ce qui signifie que toutes les utilisations du sol doivent être conformes à ses dispositions. Il s'impose notamment aux autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.). Pour les professionnels de l'immobilier, de la banque et de l'assurance, le PLU est un document essentiel à consulter avant toute opération immobilière, car il détermine les possibilités de construction et d'aménagement sur chaque parcelle. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 41 sur 237.
Scene 42 (1h 25m 15s)
[Audio] 1.2 Le rapport de présentation Le rapport de présentation est un document explicatif qui expose les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic territorial et une analyse de l'état initial de l'environnement. Selon l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme, le rapport de présentation : 1. Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement 2. S'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services 3. Analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis 4. Expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers 5. Justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le PADD 6. Établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités Le rapport de présentation comporte également une évaluation environnementale lorsque le PLU est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Bien que non opposable aux tiers, le rapport de présentation joue un rôle important dans l'interprétation des règles du PLU et dans l'appréciation de leur légalité par le juge administratif. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 42 sur 237.
Scene 43 (1h 27m 21s)
[Audio] 1.3 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la pièce maîtresse du PLU. Il exprime le projet politique de la commune ou de l'intercommunalité en matière d'aménagement et d'urbanisme pour les 10 à 15 années à venir. Selon l'article L.151-5 du Code de l'urbanisme, le PADD : 1. Définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 2. Définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs 3. Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain Le PADD n'est pas directement opposable aux tiers, mais il constitue le cadre de référence pour l'élaboration des OAP et du règlement, qui eux sont opposables. Toute évolution du PLU qui porterait atteinte à l'économie générale du PADD nécessite une révision complète du PLU, et non une simple modification. Le PADD fait l'objet d'un débat au sein du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI, au moins deux mois avant l'arrêt du projet de PLU. Ce débat permet de s'assurer que le projet politique est partagé par l'ensemble des élus. Pour les professionnels de l'immobilier et de la finance, le PADD est un document important à consulter, car il donne une vision prospective du développement de la commune et permet d'anticiper les évolutions futures du territoire. 1.4 Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sont des pièces opposables du PLU qui précisent les conditions d'aménagement de certains secteurs ou quartiers à enjeux. Elles constituent un outil de mise en œuvre opérationnelle du PADD. Selon l'article L.151-6 du Code de l'urbanisme, les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 43 sur 237.
Scene 44 (1h 29m 54s)
[Audio] Il existe trois types d'OAP : 1. Les OAP sectorielles : elles définissent les conditions d'aménagement de secteurs spécifiques, généralement des zones à urbaniser (AU) ou des secteurs de renouvellement urbain. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 2. Les OAP de secteurs d'aménagement : introduites par le décret du 28 décembre 2015, elles permettent, dans les zones U et AU, de concevoir des OAP qui s'appliquent seules, en l'absence de règlement sur le secteur concerné. 3. Les OAP thématiques : elles peuvent porter sur des thématiques spécifiques comme l'habitat, les transports et les déplacements, la mise en valeur de l'environnement, etc. Les OAP sont opposables aux autorisations d'urbanisme dans un rapport de compatibilité, ce qui signifie que les projets ne doivent pas être contraires à leurs orientations fondamentales, mais peuvent s'adapter à leurs prescriptions. Les OAP peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Pour les professionnels de l'immobilier, les OAP sont des documents essentiels à consulter avant tout projet d'aménagement ou de construction, car elles définissent les conditions d'aménagement que les projets devront respecter. 1.5 Le règlement et les documents graphiques Le règlement et les documents graphiques constituent la partie normative du PLU, directement opposable aux tiers dans un rapport de conformité. Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. Il délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 44 sur 237.
Scene 45 (1h 32m 11s)
[Audio] Selon l'article L.151-9 du Code de l'urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1. L'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées 2. La destination des constructions 3. Les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4. L'équipement des zones (desserte par les voies et réseaux) 5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques 6. Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol 7. Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants Les documents graphiques du règlement, communément appelés "plans de zonage", délimitent spatialement les diDérentes zones et secteurs du PLU. Ils font apparaître, le cas échéant : - Les espaces boisés classés - Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol - Les emplacements réservés - Les zones soumises à des risques naturels ou technologiques - Les éléments de paysage et les quartiers à protéger - Les secteurs où des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées - Les secteurs dans lesquels des programmes de logements comportant une proportion de logements sociaux sont imposés Le règlement et les documents graphiques sont les documents du PLU les plus directement utilisés par les professionnels de l'immobilier, car ils déterminent précisément ce qu'il est possible de construire sur chaque parcelle. CEFIOB – 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Page 45 sur 237.