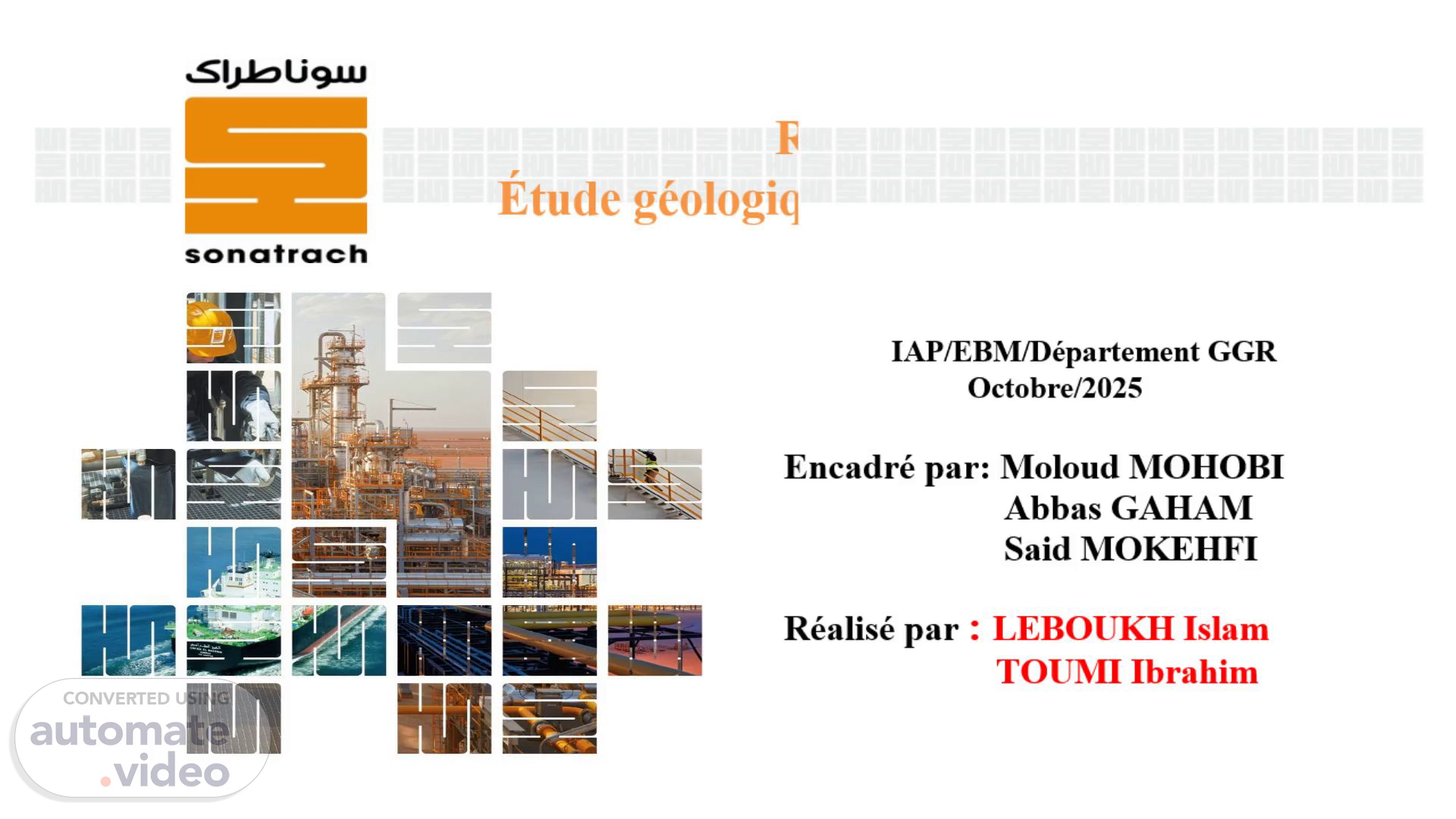Scene 1 (0s)
nn. Rapport de stage Étude géologique de la région de Bou Saâda.
Scene 2 (13s)
Introduction. L’orogenèse alpine est une grande phase de formation de chaînes de montagnes, survenue entre le Crétacé supérieur et le Tertiaire (environ entre 100 et 20 millions d’années). Elle résulte de la collision entre la plaque africaine et la plaque eurasienne, faisant suite à la fermeture progressive de l’océan Téthys. Cette collision a conduit à la formation des domaines internes et domaines externes des chaînes alpines. La géologie de Bou Saâda se caractérise par des affleurements massifs du Crétacé. Cette période est subdivisée en plusieurs séries correspondant à des âges géologiques distincts, chacun étant associé à des lithologies indépendantes et à des environnements de dépôt variés (marins, lagunaires ou continentaux selon les niveaux stratigraphiques)..
Scene 3 (42s)
Objectifs. Identifier les principales formations géologiques présentes dans la région de Bou Saâda, en distinguant les différentes unités litho stratigraphiques (Crétacé inférieur, Crétacé supérieur, etc.) Observer les contacts entre les différentes couches géologiques afin de reconnaître ( les discordances, failles, plis… ) S’exercer à la lecture de la carte géologique de Bou Saâda et à la réalisation des coupes géologiques. Apprendre à mesurer le pendage et la direction des couches à l’aide d’une boussole géologique. Relier les observations de terrain aux processus géologiques qui les expliquent :( sédimentation,déformation,érosion ). Élaborer une interprétation de l’histoire géologique de la région de Bou Saâda..
Scene 4 (1m 9s)
Situation géographique. La ville de Bou Saâda est située à environ 234 km au sud-est d’Alger. Elle se trouve à environ 13 km au sud-est du Chott El Hodna, dans la partie sud de la wilaya de M’Sila. Ses coordonnées géographiques sont approximativement 35°13’ de latitude Nord et 4°10’ de longitude Est. Bou Saâda est limitée : au nord par la ville de M’Sila, au sud-est par la wilaya de Biskra, au sud-ouest par la wilaya de Djelfa..
Scene 5 (1m 33s)
Contexte géologique régional. AMMAL ( 10:00 h ) L’ensemble géologique de la zone interne du domaine tellien est caractérisé par l’affleurement d’un socle métamorphique kabyle, d’âge Précambrien, constitué essentiellement de gneiss, micaschistes et quartzites. Ce socle est surmonté par une chaîne de formations calcaires d’âge mésozoïque à cénozoïque, très étroite (ne dépassant pas quelques kilomètres de largeur). On observe un contact anormal entre l’OMK (Oligo-Miocène kabyle) et le socle kabyle. Ce contact correspond à une faille inverse, indiquant que les couches sédimentaires oligo-miocènes ont été chevauchées ou plaquées contre le socle métamorphique lors des mouvements compressifs liés à l’orogenèse alpine..
Scene 6 (2m 0s)
Les flyschs :. Le domaine des flyschs est constitué de succession de couches alternées de grès, calcaires, marnes et argiles, déposées dans un milieu marin profond (bassin de flyschs). On distingue trois grands ensembles de flyschs dans la région: Flyschs mauritaniens : dépôts proximaux, constitués d’éléments grossiers (conglomérats, grès, argiles et calcaires). Flyschs massyliens : dépôts distaux, formés d’alternances de grès et d’argiles, traduisant un environnement plus profond et plus calme. Flyschs numidiens : caractérisés par des alternances régulières de grès quartzitiques et d’argiles, témoignant d’une sédimentation turbiditique bien organisée dans un bassin marin profond..
Scene 7 (2m 27s)
La nappe de charriage. Une nappe de charriage correspond à un ensemble de couches géologiques déplacées sur une grande distance, souvent de plusieurs kilomètres, le long d’une surface de décollement. Cette surface de décollement se situe fréquemment au niveau d’une couche évaporitique (constituée de gypse, de sel gemme, ou d’autres minéraux similaires), car ces roches sont plastiques et favorisent le glissement des terrains sus-jacents. Lors d’un charriage, on distingue deux types de terrains : Le terrain allochtone : ce sont les couches déplacées par le charriage. Le terrain autochtone : ce sont les couches restées en place, sous la nappe..
Scene 8 (2m 55s)
Djebel Kerdada (Sud de Bou Saâda). Le Djebel Kerdada est situé au sud de la ville de Bou Saâda, dans la région des monts des Hodna . Sur le plan structural, les couches géologiques y sont subverticales, orientées N40° avec un pendage de 70° vers le Nord-Ouest (NW). Il est caractérisé par la présence des séries géologiques suivantes : Néocomien : Épaisseur : environ 250 à 300 m Lithologie : série de barres massives métriques à décimétriques composées de calcaires dolomitiques compacts, présentant un aspect de “peau d’éléphant” typique. Observation : ces calcaires sont durs, homogènes et bien stratifiés, traduisant un dépôt en milieu de plate-forme carbonatée peu profonde, soumis à une dolomitisation secondaire. 2. Barrémo–Aptien inférieur : Épaisseur : environ 1000 m Lithologie : cet étage se compose : D’une barre décimétrique de calcaire oolitique d’environ 100 m d’épaisseur, formant un repère stratigraphique net dans le paysage. D’une série d’alternances lithologiques, typiques de la région de Bou Saâda, constituées de grès, marnes, calcaires et argiles. Des calcaires marneux lithophages avec des fissures remplies de calcites. Des calcaires bioclastiques durs tres riches en debris de coquilles comme gasteropodes. Des calcaires noduleux fissures remplies de calcite contenants des debrits d’huitres Argiles versicolores (rouges,verts).
Scene 9 (3m 47s)
Coupe géologique de djebel Kerdada. 9. Néocomien Dolooies BarrémoÄptien inférieur Calcair• Oolitbiqoe Gre i Cakaire Huitre Terrasse Ill ei IV Calcairr Bioclastique Leutieulaåe Gre Tin i Moyen Route Oued Bou Saada Rouges errier M •roes Verie Calcair•.
Scene 10 (4m 16s)
10. Observation structurale. L'observation de terrain menée à l'ouest du Djebel Freytas a permis d'identifier une faille normale. Cet accident tectonique est caractérisé par : Un rejet (déplacement vertical) estimé entre 15 et 20 cm. Une direction (orientation de la faille) mesurée à N120°. Un pendage (inclinaison) de 15° vers le Sud-Ouest (SW). Une corrélation a été établie avec le Djebel Dahla, où les strates (couches) présentent des orientations et des pendages identiques. Par conséquent, il est possible de conclure que les deux djebels constituent un bloc unique, fracturé et affecté par une faille résultant un décrochement dextre et un affaissement entre djebel Louiza et djebel Araar..
Scene 11 (4m 45s)
Djebel Louiza. Le Djebel Louiza présente des affleurements couvrant la période de l'Aptien supérieur à l'Albien supérieur. 1. Aptien supérieur À la base : L'étage débute par des marnes vertes riches en Orbitolines (un type de foraminifère), intercalées avec des bancs de calcaires marneux. Au sommet : La fin de l'Aptien est marquée par la présence d'évaporites (une formation gypsifère). 2. Albien inférieur Début (transition Aptien-Albien) : L'Albien inférieur commence par des grès calcaires qui se présentent sous forme de barre. Ces grès sont caractérisés par un ciment sidéritique (riche en fer). Fin de l'étage : Cette période se termine par des dépôts d'argiles versicolores (de couleurs variées) et de marnes à huîtres. 3. Albien supérieur Base de l'étage : Il est caractérisé par des calcaires noduleux qui sont riches en fossiles, notamment des Strombus (un genre de gastéropode). Sommet (fin de l'étage) : La série se termine par une épaisse formation (environ 250 mètres) de calcaires bioclastiques (formés de débris d'organismes vivants)..
Scene 12 (5m 27s)
Coupe géologique de Djebel Aouidja. Le Djebel Aouidja se caractérise par une structure anticlinale (un pli en forme de dôme) dont le cœur est daté de l'Aptien inférieur. Cette structure est fortement affectée par l'érosion. Les couches géologiques de cet anticlinal présentent les caractéristiques suivantes : Direction moyenne : N40° (Nord 40° Est). Pendage (inclinaison) : Les couches plongent vers le Sud-Est (SE) avec un angle qui diminue de 30° jusqu'à 15°. Cette formation géologique est délimitée par la grande faille nord-atlasique..
Scene 13 (5m 52s)
13. Dome triasique. Mzaret Zerigat limitée au nord par l’oued Bou Saâda , à l’est par le Djebel Kerdada et au sud par le Djebel Maalag, dans cette zone, on observe une aire de couleur violacée qui affleure des matériaux variés, incluant : Des argiles versicolores (de couleurs variées). Des marnocalcaires. Des affleurements de gypse. L'ensemble de ces matériaux remonte à des couches géologiques triasiques. Leur présence et leur disposition s'expliquent par la remontée en surface des sels triasiques qui, en traversant les différentes strates supérieures, ont formé une structure caractéristique : un dôme triasique (ou diapir salifère)..
Scene 14 (6m 19s)
14. Djebel El Hamel. La zone étudiée présente une structure géologique distincte de celles observées aux Djebels Kerdada et Aouidja, puisqu'il s'agit ici d'un synclinal perché (un pli concave dont le centre est plus bas que les bords). Les couches dans cette région sont caractérisées par : Direction : N45° (Nord 45° Est). Pendage : 30° WNW (30 degrés vers l'Ouest-Nord-Ouest). Par la suite, les séries sédimentaires des étages du Cénomanien et du Turonien ont été identifiées (ou reconnues) au niveau du Djebel El Hamel..
Scene 15 (6m 43s)
15. Aspect structural. ةوةوةوةوة. L'affleurement rocheux visible au niveau de l'Oued Logman présente un intérêt particulier, car il combine des éléments stratigraphiques et pétroliers. Nature de la Roche : Il s'agit d'une roche mère calcaire. Âge : Cette formation est datée de l'Éocène. Marqueurs : On y observe deux types de marqueurs importants : Des fossiles de Nummulites (caractérisant l'âge Éocène). Des caractéristiques ou marqueurs visibles (tels que des odeurs, des suintements ou des taches) qui sont liés à la présence d'hydrocarbures. En résumé, la formation est identifiée comme une roche mère calcaire éocène, contenant à la fois des restes fossiles de Nummulites et des indices d'hydrocarbures..
Scene 16 (7m 12s)
Conclusion. La géologie de Bou Saâda illustre parfaitement la transition entre le Tell plissé et le Sahara stable, et témoigne de la complexe histoire tectonique et sédimentaire liée à l’orogenèse alpine. Le relief de Bou Saâda est structuré par des plis et des failles orientés globalement NE–SW, témoins de la tectonique alpine qui a affecté la région au Cénozoïque. On y observe des anticlinaux érodés (comme le Djebel Aouidja) ainsi que des failles inverses ou directionnelles (telle que la faille du Djebel Fraïtes), qui ont modelé la morphologie actuelle. Sur le plan stratigraphique, l’affleurement le plus remarquable correspond au Crétacé, représenté par ses différents étages allant du Néocomien jusqu’au Turonien..
Scene 17 (7m 43s)
MERCI DE VOTRE ATTENTION.