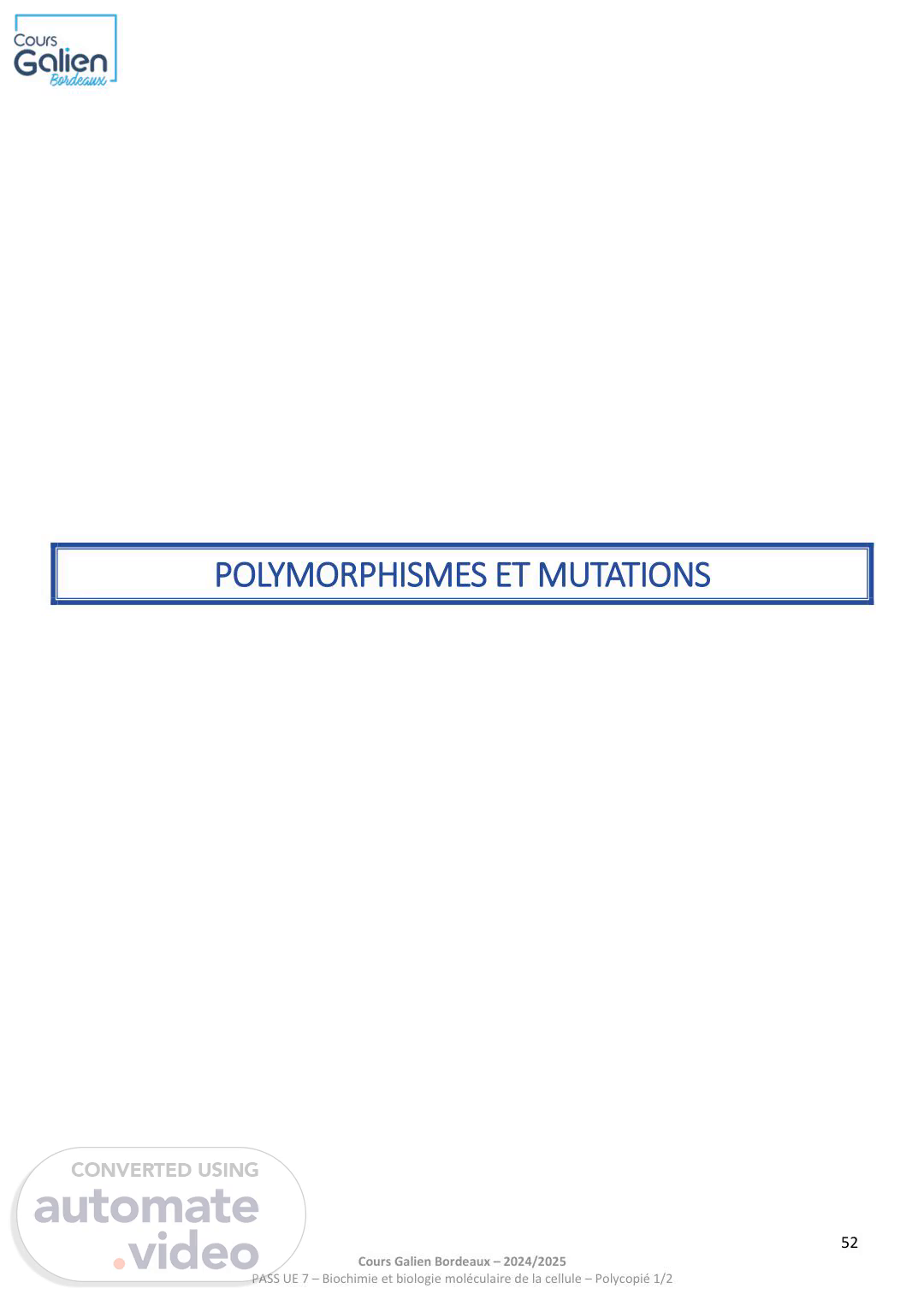Scene 1 (0s)
[Audio] POLYMORPHISMES ET MUTATIONS 52 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 2 (18s)
[Audio] I. DÉFINITIONS A. GÉNOME HUMAIN ET GENOTYPE L'ensemble des variations individuelles dans la séquence d'ADN génomique est appelé le génotype. Chaque individu possède un génotype différent qui varie en certains points. Si on prend l'ADN dans sa totalité (3 milliards de nucléotides), on aura approximativement 1,5 (millions de variations entre 2 individus. B. VARIATIONS NUCLÉOTIDIQUES DU GÉNOME HUMAIN 1. Définition moléculaire Les variations nucléotidiques sont définies comme toute modification aléatoire affectant soit (parfois les 2) : Une séquence d'acides nucléiques avec des variations ponctuelles (généralement de 1 à quelques nucléotides) L'agencement ou le nombre de plusieurs gènes, il s'agit alors de remaniements chromosomiques ou de modifications de la ploïdie (nombre de chromosomes ou nombre de compléments haploïdes ou demi- génomes). En effet, nous sommes des individus diploïdes (tous nos chromosomes sont en 2 exemplaires similaires en dehors des variations nucléotidiques), constitués de 2 génomes haploïdes (un provenant du père et l'autre de la mère) qui s'associent pour former un génome diploïde. En général, ces variations sont classées en 2 grandes catégories : le polymorphisme génétique et les mutations. 53 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 3 (1m 48s)
[Audio] 2. Polymorphisme génétique Le phénotype de chaque individu est sous-tendu par des variations individuelles, dont l'ensemble est appelé génotype. Certaines variations résultent de mutations très anciennes, fixées dans une population donnée, qui se transmettent dans cette population. Ces mutations n'ont pas d'impact pathologique (ne concours pas à l'extinction de l'espèce humaine ou à l'affaiblissement d'une population). Dans le cas du polymorphisme génétique, l'ensemble des variations observées n'ont pas de conséquences pathologiques, ce sont des variations phénotypiques normales (métabolisme, pigmentation de la peau, couleur des yeux…). Il existe 2 définitions du polymorphisme génétique : une définition stricte et une définition en génétique des populations. (1) Définition stricte Coexistence de plusieurs allèles (versions d'un gène) à un locus donné avec une fréquence de l'allèle le plus rare supérieure à 1% dans la population générale. (2) Définition en génétique des populations Coexistence stable dans une population de plus d'un génotype à une fréquence telle que le phénotype le plus rare ne puisse être maintenu par des mutations récurrentes. (3) Caractéristiques Les polymorphismes ont différentes caractéristiques : - Leur localisation génomique : en carte physique ils sont localisés à des endroits précis des chromosomes et peuvent se répartir de manière variable chez les descendants, on parle de carte génétique, c'est la fréquence de recombinaison possible entre 2 loci (proches ou éloignés). - Le type de séquence variable : l'informativité (capacité à distinguer 2 individus) est plus élevée lorsqu'on analyse plusieurs centaines de milliers de polymorphismes simple (SNP = Single Nucleotide Polymorphism) plutôt que des séquences répétées. On a donc des polymorphismes d'un ou quelques nucléotides, ou bien des polymorphismes du nombre de répétition. - Informativité ou allélisme (nombre de variants différents retrouvés dans une population donnée.) 54 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 4 (4m 5s)
[Audio] 3. Mutations C'est la définition que nous allons assumer dans ce cours. On fait la différence entre polymorphisme et mutation, les deux sont des variations génétiques par rapport à un génome de référence consensuel en génétique humaine, moyennement observé sur la terre entière. Les polymorphismes sont des variations sans conséquences pathologiques et les mutations ont des conséquences pathologiques (1) Définition génétique Toute modification de l'information génétique décelable, c'est-à-dire observable, par un changement brusque et héréditaire survenant au niveau d'un ou plusieurs caractères. (2) Définition en génétique humaine Variation entraînant une conséquence pathogénique immédiate ou retardée (susceptibilité). Ces variants pourront être classés selon leur conséquence, c'est-à-dire selon leur capacité à être liés à une pathologie. II. POLYMORPHISME : BIODIVERSITÉ GÉNÉTIQUE Ce sont des variations génétiques fréquentes correspondant le plus souvent à des variants de classe 1 qui n'ont donc pas de conséquences pathogéniques. Il existe plusieurs types de polymorphisme, classés selon leur mécanisme d'apparition ou leur méthode d'étude. Il s'agit des polymorphismes de restriction, de répétition et de substitution. A. POLYMORPHISME DE RESTRICTION On détecte ce polymorphisme par une technique dite de restriction, ce sont des polymorphismes de variations de nucléotide simple (comme les SNP). Cependant lorsqu'ils interviennent, ils créent ou ils font perdre un site de coupure par une enzyme de restriction (cf. UE15 au S2). Les enzymes de restriction sont des enzymes générées par génie génétique (extraites de bactéries) qui ont la propriété de couper l'ADN à des positions nucléotidiques données (séquences palindromiques). 55 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 5 (6m 6s)
[Audio] B. POLYMORPHISME DE RÉPÉTITION La finesse du séquençage nous permet d'aborder plus facilement les séquences microsatellites. Ce sont des répétitions de 2 nucléotides alors que les séquences minisatellites sont des répétition de 11 à 30 nucléotides approximativement. On s'intéresse à l'informativité des polymorphismes de restriction, on aura autant d'allèles qu'il y aura de répétition de la séquence (on observe majoritairement 8 répétitions mais il existe des allèles avec plus ou moins de répétition). On observe donc un multi allélisme dans la population mais seulement 2 allèles à l'échelle de l'individu car nous sommes diploïdes. L'informativité au niveau de l'individu est donc assez importante, en effet, il est possible de séparer une population grâce à ces polymorphismes. Cependant, le faible nombre de polymorphisme de restriction dans le génome (environ 100 000), permet surtout de différencier des groupes de population et moins les individus entre eux (sauf ceux possédant un polymorphisme extrêmement rare). C. POLYMORPHISME DE SUBSTITUTION Il s'agit d'un polymorphisme à l'échelle du nucléotide, on parle alors de SNP (Single Nucleotide Polymorphism), c'est-à-dire qui ne concerne qu'un seul nucléotide (A devient T, G devient C…). Il s'agit de variation plus simple que les répétitions on parle de polymorphisme bi-allélique, il n'y a donc que 2 variants à une position donnée chez un individu, on a le polymorphisme ou on ne l'a pas. Mais si on considère la quantité de variations à différents locus (+ d'un million), on peut différencier n'importe quel individu d'un autre (sauf les jumeaux issus du même œuf), l'informativité du SNP est alors importante par le nombre de position étudiée, ce sont les variations les plus fréquentes et celles qui sont le plus utilisées. On utilise largement les polymorphismes lors d'enquêtes génétiques. À partir d'une trace ADN (prélevé sur une scène de crime par exemple), on va rechercher les positions polymorphes pour identifier l'individu, en génotypant environs 50 positions, puis en comparant avec un panel de la police scientifique (par exemple pour vérifier si un suspect est porteur, ou non, de polymorphismes détectés a priori). Si on analysait une seule position de SNP, il serait très probable de trouver un individu portant le polymorphisme, car les SNP sont peu informatifs sur un locus donné. En revanche, en prenant plusieurs variations en compte, ils deviennent très informatifs et il n'y a plus aucune chance de trouver un individu ressemblant (à 100%) à un autre, sauf dans le cas de jumeaux monozygotes. On a alors une « carte d'identité » génétique formée par l'ensemble de ces polymorphismes. On parle d'empreintes génétiques, imaginées en 1985 par un scientifique anglais, Alec Jeffreys. 56 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 6 (9m 13s)
[Audio] D. POLYMORPHISMES FONCTIONNELS Il s'agit de variations nucléotidiques entraînant la modification d'acides aminés à l'origine de l'existence de différentes formes de protéines. Exemple : Les 3 formes de l'apolipoprotéine E sont dues à la modification d'une ou 2 arginines (Arg112 et Arg158) en cystéine. Les 3 formes (Cys112/Arg158, Cys112/Cys158 et Arg112/Arg158) ne sont pas présentes à la même fréquence dans la population. E. EXEMPLE D'UTILISATION DES POLYMORPHISMES 1. Génotypage des séquences répétées La Figure 2 représente la base des empreintes génétiques, on utilise des couples d'amorces (P1 et P2) qui vont encadrer une séquence répétée (dans cet exemple on a une répétition de 16 dimères de CA). Il peut y avoir d'autres allèles observés dans la population générale (14 ou 12 CA). On prend l'exemple de la famille dans la Figure 3 (père, mère et 3 filles) et on cherche à savoir si l'atteinte du père est la même que celle des 2 filles malades. Pour cela on va génotyper les individus, c'est-à-dire rechercher les variations à certains endroits précis du génome. Lorsque l'on fait la PCR (Figure 2) on va déterminer des allèles, qui peuvent être à l'état hétérozygote ou homozygote. En suivant les allèles, on peut attribuer l'allèle 121 paternelle à chacune des filles (Figure 3), l'autre allèle des filles pourra être soit 121 ou 221, retrouvés chez la mère, soit 212 retrouvé chez le père. Les 3 filles sont hétérozygotes, mais l'impact pathogénique provient forcément de l'allèle paternel 121, en effet on ne retrouve pas l'allèle 212 paternel chez la descendance atteints. Donc tous les individus porteurs de l'allèle 121 du père sont malades. On voit que le père transmet l'allèle 121 à la première fille et la mère lui transmet l'autre allèle 121. Pour la deuxième fille, le père transmet toujours 121 et la mère transmet cette fois-ci son autre allèle, 221. Enfin la troisième fille, le père transmet 212 et la mère 121. Donc le 121 de la mère ne peut pas être porteur de la mutation car elle n'est pas atteinte. De plus, le père est hétérozygote et son allèle 212 n'est pas porteur de la mutation (seul le 121 l'est), car la troisième fille a l'allèle 212 et n'est pas malade. 57 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 7 (12m 14s)
[Audio] Le génotypage est utilisé en recherche de paternité ou bien dans les enquêtes policières (etc.). Figure 3 Figure 2 58 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 8 (12m 38s)
[Audio] 2. Single Nucleotide Polymorphism Les SNP sont très informatif car on a automatisé la technique de façon à avoir une lecture simultanée de 30 000 à 400 000 SNP, ce nombre important de polymorphisme permet d'avoir un « code barre » moléculaire spécifique d'un patient. III. MUTATIONS A. NIVEAU D'ÉTUDE Le niveau d'étude des mutations dépend de leur type et de leurs conséquences phénotypiques. On peut ainsi identifier 3 niveaux d'étude : - Macroscopique : changement phénotypique observable à l'œil nu. - Cellulaire : anomalies sur le nombre ou la structure des chromosomes - Macromoléculaire : au niveau des acides nucléiques La première étude d'une mutation est celle de Thomas Morgan en 1910 sur la drosophile (Petites mouches à la surface du vinaigre). Il crée un élevage de drosophiles qui ont normalement toutes les yeux rouges mais au fil des génération, il réussit à isoler un individu aux yeux blanc. On appelle cette mutation la mutation white. Une modification du nombre de chromosome qui a une conséquence pathologique, dans l'espèce humaine, est la trisomie 21. On l'identifie sur un caryotype où il y a 3 chromosomes 21 et non 2, il y a ensuite un retentissement pathologique de cette trisomie. Une deuxième altération du nombre de chromosome viable, dans l'espèce humaine, est la monosomie du chromosome X ou le syndrome de Turner. Il manque donc un chromosome sexuel (le X), chez les jeunes femmes. Il s'agit de la seule monosomie viable de l'espèce humaine. B. VARIATIONS PONCTUELLES DE L'ADN 1. Substitution Il s'agit du remplacement d'une base ou d'une paire de bases par une autre. On peut en distinguer 2 types : - La transition si on reste dans la même catégorie nucléotidique (purinepurine ou pyrimidine-pyrimidine), elles sont deux fois plus fréquentes que les transversions (surtout C vers T) - La transversion si on change de catégorie nucléotidique 59 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 9 (14m 51s)
[Audio] 2. Gain/perte de nucléotides Il y a 2 types de mutations aboutissant à un gain de nucléotides : - L'insertion : ajout de quelques nucléotides à un seul endroit avec rétablissement de la continuité - La duplication : copie une ou plusieurs fois de quelques nucléotides à un seul endroit avec rétablissement de la continuité Il y a 1 type de mutations aboutissant à une perte de nucléotides : - La délétion : la perte de quelques nucléotides à un seul endroit avec rétablissement de la continuité Il y a également 1 type de mutations qui peut aboutir à une perte et un gain de nucléotides : - Les délins : il s'agit d'une délétion et d'une insertion de nucléotides, ces délins sont généralement déséquilibrés, cela signifie que le nombre de nucléotides insérés et délétés ne sont pas les mêmes. C. IDENTIFICATION DES VARIATIONS PONCTUELLES : MÉTHODE DE SANGER On détecte les mutations par séquençage, le séquençage le plus utilisé et la méthode de Sanger, mise au point dans les années 80(la méthodologie sera vue en UE15). Elle permet de lire une séquence d'ADN, avec un code international (pas à retenir) : A en vert, C en bleu, G en noir, T en rouge. Il y a parfois une cohabitation de deux bases sur une position nucléotidique donnée, correspondant à deux allèles différents. Il y a aussi des chevauchements, c'est-à-dire un allèle normal et un allèle variant à cause d'une perte de nucléotide, les deux séquences ne font donc plus la même taille, on parle alors de chevauchement du cadre de lecture. 60 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.
Scene 10 (16m 37s)
[Audio] IV. ORIGINE DES MUTATIONS A. MUTATIONS SURVENANT SPONTANÉMENT AU COURS DE LA RÉPLICATION 1. Erreur réplicative ou erreur d'incorporation Les erreurs les plus fréquentes et les plus facilement réparées sont les erreurs d'incorporation, lors de la réplication. On a ici une guanine, complémentaire d'une cytosine. À gauche, on observe une erreur réplicative car en face du G il n'y pas l'incorporation d'une cytosine mais celle d'une thymine. Lorsque cette erreur arrive pendant la réplication, on parle de mésappariement (mauvais appariement). Si ce mésappariement n'est pas réparé, à la réplication suivante les brins se séparent et on aura d'un côté, une paire de bases CG (paire de bases initiale) et de l'autre une paire de bases TA, la variation génétique s'ancre dans le génome. Dans ce caslà, on a une transition C vers T (les plus fréquentes) Dans les mutations survenant au cours de la réplication, on a des analogues chimiques de base, qui sont des formes rares de l'uracile, de la cytosine ou de la guanine. Par exemple l'énol-guanine s'hybride avec la thymine et non avec la cytosine. De même l'énol-thymine s'hybride avec la guanine et non avec l'adénine. Ces formes tautomériques sont rares mais peuvent être incorporée accidentellement pendant la réplication, entrainant des anomalies de reconnaissance des bases complémentaires. 61 Cours Galien Bordeaux – 2024/2025 PASS UE 7 – Biochimie et biologie moléculaire de la cellule – Polycopié 1/2.