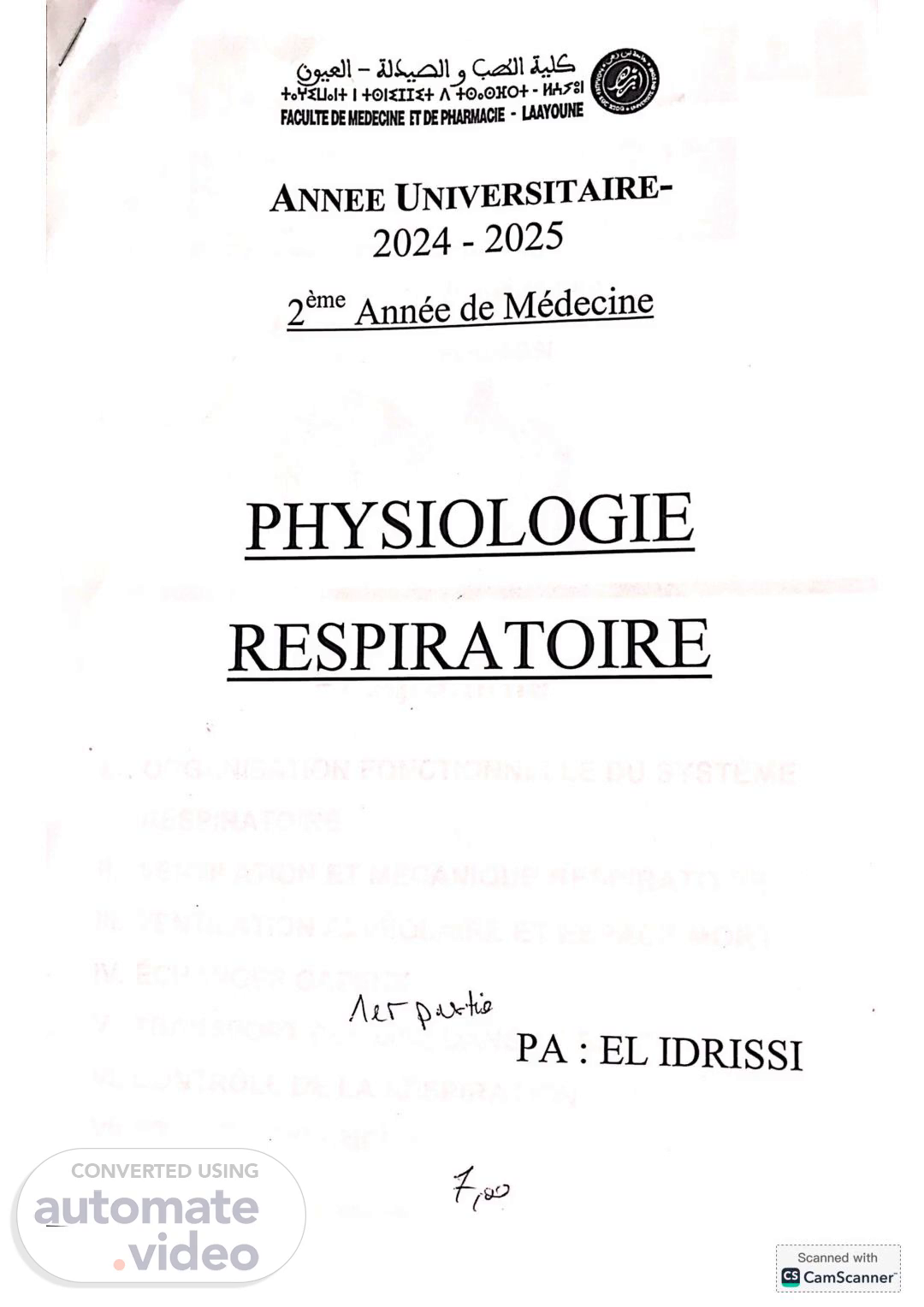Scene 1 (0s)
+0YZU01+ I +01t11Z+ A +@OOXO+ - HARI ETDEMUÆUCIE - LUYWIC ANNEE UNIVERSITAIRE- 2024 - 2025 2éme Année de Médecine PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE PA : EL IDRISSI Scanned with CamScanner-.
Scene 2 (8s)
PÖ.öSafå'éEUDRISSl g-b-ll a-I-I-S +cYtU01+ I ( Physiologie respiratoire 2åme année de médecine Année universitaire : 2024 - 2025 Pr. Safae ELIDRISSI Programme ORGANISATION FONCTIONNELLE DU SYSTÉME l. RESPIRATOIRE VENTILATION ET MÉCANIQUE RESPIRATOIRE Ill. VENTILATION ALVÉOLAIRE ET ESPACE MORT W. ÉCHANGES GAZEUX V. TRANSPORT DES GAZ DANS LE SANG VI. CONTROLE DE LA RESPIRATION VII. BRONCHOMOTRICITÉ pr. safae ELIDRISSI Scanned with CamScanner.
Scene 3 (24s)
Programme 1. ORGANISATION FONCTIONNELLE DU SYSTÉME RESPIRATOIRE 11. VENTILATION ET MÉCANIQUE RESPIRATOIRE Ill. VENTILATION ALVÉOLAIRE ET ESPACE MORT lv. ÉCHANGES GAZEUX V. TRANSPORT DES GAZ DANS LE SANG VI. CONTROLE DE LA RESPIRATION VII. BRONCHOMOTRICITÉ hapitrel: ORGANISATION FONCTIONNELLE DU SYSTÉME RESPIRATOIRE Scanned with @CamScanner•.
Scene 4 (38s)
Plan Introduction II. Anatomie fonctionnelle du systéme respiratoire Ill. Zone de conduction IV. Zone respiratoire V. Vascularisation et innervation du systéme respiratoire VI. Structure de Ia paroi bronchique VII.Plévre VIII.Conclusion PF2Såfåé 'ELIbRiSSi I. Introduction La respiration: c'est l'ensemble des phénoménes qui concourent å assurer les échanges gazeux entre l'atmosphére et Ia cellules vivante de l'organisme. La fonction physiologique principale de I'appareil respiratoire est l'hématose = processus permettant un apport continu d'02 aux cellules (indispensable å leur métabolisme) et le rejet du C02 (gaz carbonique en excés) qu'elles produisent. Maintenir un niveau normal des paramétres sanguins (pa02, paC02, Sa02 et pH mesurés par les gazes du sang) quelque soient les besoins de l'organisme : repos, sommeil, effort de Ia vie courante, marche, montée d'escalier, effort intense... Scanned with CamScanner.
Scene 5 (1m 9s)
Hématose Pour que ce processus hématosique se réalise il faut a-GQ!2djUQ-.QS—• a- une circulation d'air : c'est Ia ventilation, elle permet le renouvellement de "air alvéolaire. b- un lieu d'échange : c'est I'alvéole pulmonaire, Ies échanges gazeux se passent par diffusion å travers Ia membrane alvéolo-capillaire. c- une circulation de sang : c'est Ia perfusion, elle est indispensable au transport des gaz (02 et C02) dans Ie sang. N.B: Tout processus pathologique altérant une de ces 3 étapes conduit å une perturbation de I'hématose II. Anatomie fonctionnelle du systéme respiratoire . AERIENNES SUPERIEURES Nez Cavité nasale Sinus Pharynx Larynx V AERIENNES Bronches Bronchioles Péy" 0? z. P.oum6n Diaphragme Organisation générale du systéme respiratoire Pr. safae EUDRISSI Scanned with CamScanner.
Scene 6 (1m 37s)
A. Les différentes voies aériennes (VA) 1) Les voies aériennes supérieures (YAS)•. . Nez • Bouche, • Pharynx • Larynx. •r: SåfåéELlDÄiSS1 • Le nez : réchauffe et humidifier l'air, c'est un filtre qui empéche l'inhalation de grosses particules inhalées. • Bouche, • Pharynx, • Larynx. -zfÅ. Res iration nasale Respiration bucco nasale Scanned with CamScanner-.
Scene 7 (1m 52s)
• L'oropharynx: - Prolonge la cavité buccale - Absence de soutien rigide - Possibilité de collapsus, pendant Ie sommeil, par relåchement des muscles dilatateurs du pharynx, Conséquenge : fermeture des voies aériennes et apnées obstructives. L 'apnée obstructive Oropharynx M. génioglosse M. to-hyoTdlen A. Les différentes voies aériennes (VA) 2) Les voies aériennes inférieures (VAI): - C'est la partie thoracique du systéme respiratoire: la trachée, Ies deux bronches souches, leurs branches et Ies poumons. - L'air entre dans le systéme respiratoire par la bouche et le nez et passe par le pharynx (carrefour aérodigestif), le larynx (contenant les cordes vocales) puis la trachée. Scanned with CamScanner.
Scene 8 (2m 18s)
B. Ramification des voies aériennes La trachée : est un tube semi flexible constitué de 15 å 20 anneaux cartilagineux en forme de C. Elle se divise (lire division), au niveau du thorax, en deux bronches souches (D, G) pour chaque poumon. • Les bronches : comme la trachée, les bronches sont des tubes semi- rigides contenant du cartilage. Dans Ies poumon, Ies bronches se divisent de fagon répétitive (divisions 2-11) et deviennent des bronchioles. • Les bronchioles : sont des petites voies qui peuvent étre comprimées et dont la paroi est faite de muscle lisse. Elles continuent de se diviser (division 12-23) jusqu'aux bronchioles respiratoires qui font la transition entre les voies aériennes et l'épithélium d'échange du poumon. Pr:safåe ELIDRiSSj' Nombre de Trachée Bronchos Bronchloks Bronchloks termlndes Bronchioks respratoires Conduits Alvé Oles N ombre de conduits par ramifica tion 1 2 4 8 16 32 6 x 10 3-6 x 10' Ramification des voies aériennes Scanned with CamScanner.
Scene 9 (2m 51s)
T' T 16 17 18 19 20 22 a votes aérleme$ centrales 10 voles aériemes périphérlques lill oo C. Segmentation générale de l'appareil respiratoire B. Autour de chaque bronche lobaire il y a un lobe, autour de chaque bronche segmentaire il y a un segment.... Scanned with CamScanner-.
Scene 10 (3m 2s)
III. Zone de conduction 1) Définition: • Cette zone désigne toutes les voies respiratoires formées de conduits relativement rigides qui acheminent l'air la zone respiratoire. • Elle va du nez aux bronchioles terminales: + Nez, cavité nasale + Pharynx, Larynx + Trachée + Les 16 premiéres générations de la division bronchique: Bronches Bronchioles terminales Visafae EUDRiSS1 2) Fonctions de la zone de conduction: Elle permet de: - Acheminer l'air - Filtrer l'air - Réchauffer l'air - Humidifier l'air Une structure particuliére de l'épithélium respiratoire cilié Pr. safae EUDRI Terrinal z 2 3 4 16 17 18 T 19 20 21 22 a Scanned with CamScanner-.
Scene 11 (3m 25s)
La structure de I'épithélium respiratoire cilié Les surfaces épithéliales des VA se caractérisent par l'existence de : Cils : - Sur Ia face interne des voies respiratoires - Battent en continu en haut vers Ie pharynx, Mucus: - Sécrété par les cellules épithéliales des voies respiratoires, - Piége les particules de Ia poussiöre, Structure de répithéllum respiratoire cillé La particules collent au mucus et sont refoulés vers le haut par les cils Ce mécanisme joue un röle important (défense) afin de filtrer l'air avant d'arriver aux poumons "Pi,Sfåé'.EUDRISSW Un grand nombre d'agents nocifs inhibent cette activité ciliaire Le tabac+++: Agent nocif : inhibe l'activité des cils. Ainsi, fumer 1 seule cigarette peut immobiliser les cils pendant plusieurs heures. Pathologie : mucoviscidose: (mucus + viscosité) - Maladie du tissu épithélial des glandes exocrines - Maladie génétique, fréquente en Europe, - Mucus collant, épais. •Conséquences : Encombrement des voies respiratoires et géne respiratoire. Scanned with CamScanner.
Scene 12 (4m 0s)
IV. Zone respiratoire 1) Définition: C'est la zone Ot se déroulent les échanges gazeux, composée exclusivement de structures microscopiques: soit les bronchioles respiratoires, les conduits alvéolaires ou les alvéoles pulmonaires. • Dans cette zone, Ies alvéoles sont entremélés avec les capillaires pulmonaires. Zone respiratoire : Canaux Alvéolaires Sacs Alvéolaires Alvéoles +++ •pr. safa•e EUDRtSS1 Arteriole BraxNde tenninale Veinule ;LVQJ' 2) Structure fonctionnelle des alvé Ies a. Les alvéoles • Sont des petits sacs creux, dont les extrémités ouvertes, sont en continuité avec Ia lumiére des voies aériennes • Trés vascularisés • Diamétre = 0 2 mm, • Nombre : 30d millions disposés par groupe de 15-20, • Surface totale : 80-100 court de tennis. IIIZI 8.9. : Figure 3 : Alvéoles pr. safae EUDRISSI La grande surface des alvéoles et la fine épaisseur assurent un échange rapide de grandes quantités d'02 et de C02 par diffusion. Scanned with CamScanner-.
Scene 13 (4m 34s)
int L'ædéme pulmonaire La faible épaisseur de Ia membrane alvéolo-capillaire Ia rend plus perméable en cas d'augmentation de la pression hydrostatique dans Ies capillaires pulmonaires ceci favorisant I'apparition d'un ædéme pulmonaire : transsudat de liquide du capillaire pulmonaire vers Ia lumiåre alvéolaire = Cdéme pulmonaire ßåfåéEUOR b. Les différents types de cellules alvéolaires • Pneumocytes de type I : cellules épithéliales aplaties formant Ia paroi alvéolaire. • Pneumocytes de type II : fonction métaboliquen, elles sécrétent le surfactant : phospholipide tapissant l'intérieur des alvéoles, réduisant la tension superficielle et permettant une distension pulmonaire plus facile. • Macrophages qui ingérent les substances étrangeres : mucus, bactéries.. = Röle de défense. Schéma des cellules alvéolaires •h•éohie Lindahüi Scanned with CamScanner.
Scene 14 (5m 1s)
Noyau Pneumocvtes de tvoe II cellulalre Iibérant le surfactant Pneumocytes de type I Formant Ia parol alvéolalre Molécules du n 1m de surfactant - A , Alr contenu dans I'alvéole pulmonalre Fim aqueux ou hypophage surfactant stocké dans les véslcules Dlfférentes formes de surfacatnt IIbéré Valsseaux sangulns et globlules rouges Les différents types de cellules alvéolaires PF.SafaéELIDRlSSlv c. La tension superficielle: La distensibilité du poumon est limitée par 2 facteurs: - La présence de tissu élastique interstitiel (fibres de collagéne et d'élastine). - La tension superficielle exercée par le liquide qui recouvre les alvéoles. La tension superficielle (exprimée en dynes) =la force superficielle de contraction d'un liquide gråce å laquelle Ia surface air/liquide tend å étre la plus réduite possible. Air A l'interface air/liquide — les rnolécules (B) sont attjrées préférentjellement • les unes vers Jes autres • vem linthur Interface air/liquide se rétracte pour atteindre une surface minimum Scanned with CamScanner.
Scene 15 (5m 32s)
• La surface alvéolaire des pneumocytes est recouverte d'une lame- de liquide en contact avec le gaz alvéolaire, ce qui génöre Une tension superficielle dirigée vers le centre de l'alvéole et créant une pression (P) qui risque de les collaber. • Le surfactant sont des molécules qui se substituent aux molécules d'eau å la surface des alvéoles et perturbent leurs forces cohésives etdonc diminuent la tension superficielle. pulmonalr• Gwtte d•eau La loi de Laplace : P=2T/r oü ssionå l'intérieurde l'alvéole • T=tension su erficielle du li uide, r=ra de l'alvéole. Loi de Laplace: P=2T/r. mais T varie en fonction de r Loi de Laplace: P=2T/r Surfactant — Surfactant - conapsus Surfactant - 11. I Surfactant + PA pe 2TAlrA= 2Te/rø Le surfactant abaisse plus la TS dms les petits alvéoles que dans les Sans surfactant. T est constante Selon cette loi, plus le rayon de l'alvéole est petit et plus la pression sera grande d'oü le risque de collapsus. Cependant le surfactant est davantage concentr€ dans les plus petites alvéoles par rapport au plus grandes, ce qui permet dl réduire leurs tension superficielle et éviter que les petites bulles ne se vident dan les grandes Scanned with CamScanner.
Scene 16 (6m 15s)
Röles h siolo i ues du surfactant le surfactant diminue la tension superficielle alvéolaire donc augmente la compliance pulmonaire (Avolume/Apression) stabilise Ies alvéoles de taille différentes diminue la quantité de liquide filtré hors des capillaires et rend Ia surface alvéolaire imperméable aux protéines Pr.5Safae EUDRISSI En pathologie: Détresse respiratoire du nouveau-né thSAV01R SURL D ESSERESPlRATäR Chez le prématuré, le surfactant est immature. Ce déficit en surfactant aboutit å une détresse respiratoire cause du collapsus alvéolaire qui aboutit å une mauvaise ventilation. • Dans ce cas on procéde une injection directe de surfactant exogéne dans les voies aériennes. Scanned with CamScanner.
Scene 17 (6m 38s)
V. Vascularisation et innervation du systöme respiratoire A. Vascularisation pulmonaire: Le sang est apporté aux pour-nons par 2 types de circulation : La circulation pulmonaire et la circulation bronchique. 1. La circulation pulmonaire • Le sang veineux systémique est transporté par les artéres pulmonaires qui vont se ramifier pour former Ies capillaires pulmonaires. • Le sang hématosé est transporté des poumons au cæur par Ies veines pulmonaires. A "inverse de la circutation Eystémique : - Les arteres pulmonaires véhiculent le sang déSOxygéné (bleu) - Les veines pulmonaires Véhiculent le Sang oxygéné (rouge) Dans cette circu'ation: - Le volume est élevé: la totalité du sang de l'organisme passe par les poumons au moins Ifois/min, le débit sanguin pulmonaire = 5 Umin - La pression est faible (25/8 mmHg) fa€ELlDRlSSl 2. La circulation bronchique : Les artéres bronchiques conduisent le sang oxygéné de la circulation générale aux tissus pulmonaires. Elles dérivent de I'aorte et cheminent parallélement aux ramifications bronchiques. Circulation å petit volume mais å forte pression. Elle apporte du sang oxygéné å tous Ies tissus pulmonaires sauf aux alvéoles. La circulation bronchique Scanned with CamScanner.
Scene 18 (7m 19s)
B. Innervation des poumons : Les poumons sont innervés par : Des neurofibres motrices parasympathiques et sympathiques, Des neurofibres viscéro-sensitives. Les fibres parasympathiques provoquent la bronchoconstriction • Les fibres sympathiques provoquent Ia bronchodilatation. PF.'Såfåé ELIbR1sSfV VI. Structure de la paroi bronchique La lumiére de Ia bronche est tapissée : - d'une muqueuse ciliée reposant sur - une couche mince sous-muqueuse - II existe des glandes séro-muqueuses: fabriquent Ie mucus qui va tapisser Ia muqueuse ciliée. - Puis une couche de muscle lisse circulaire reposant sur un chorion riche en fibres élastiques. En périphérie se trouve une charpente cartilagineuse ± rigide permettant de maintenir Ie calibre de Ia bronche onstant. Stuctur• dt la paroi bronchlque (CT) Scanned with CamScanner.
Scene 19 (7m 48s)
La structure histologique des parois des bronches porpere changem elle de la trachée, mais au fil des ramifications, il s tructuraux suivants : • do • + do — • s&o-nwquwses do — — • en • épds (ostvne) • • en + rams 9öSåfåé EUDRiSS1 En pathologie: Asthme • Vers les conduits alvéolaires, le muscle circulaire devient épais. Lors de spasmes, cette couche de muscle lisse circulaire provoquera la crise d'asthme : Pasthme est une pathologie des petites bronches o. L'ASTHME normalo Bronche rétréde par sécrétions et inflammation (Bronetite dyonlque) rétrécio par contraction du musde (Crise d• asthme) Scanned with CamScanner.
Scene 20 (8m 8s)
VII. Plévre séreuse reliant le poumon å la cage thoracique, formée de 2 • Feuillet viscéral : contre le poumon • Feuillet pariéta! : contre Ia cage thoracique Ces 2 feuillets sont accolés et limitent entre eux un espace virtuel qui contient quelques gouttes de liquide (2 mi) (röle de lubrification) et ou régne une pression négative. • La plévre permet : • L 'interrelation entre les poumons et Ia cage thoraciques • Le glissement des poumons sur Ia cage thoracique • La transmission des mouvements de la cage thoracique aux poumons. DPF. Såfåd ÉLIDklSSi .10 cm Valeur de la pression intrapleurale: En position debout, et pour des raisons essentiellement liées ä la gravité, la pression intrapleurale est plus élevée ä la base (-3 cmH20) qu'au sommet du poumon (-10 cmH20). Röle La pression intrapleurale négative : sert å maintenir les bronchioles bien ouvertes car elle est transmise via les septa alvéolaires et les attaches alvéolaires aux parois bronchiolaires Scanned with CamScanner.
Scene 21 (8m 42s)
En pathologie: Epanchements pleuraux La cavité pleurale peut étre le siége de phénoméne pathologiques : • Pleurésie : présence de liquide entre Ies deux feuillets de Ia plövre (cavité pleurale). Le liquide peut étre purulent (trouble), hématique (sang), citrin (jaune trés Clair), séro-hématique (épanchement sérum contenant un peu de sang), etc. • Pneumothorax: présence d'air dans Ia cavité pleurale. : Pleurésie VIII. Conclusion En physiologie, le terme respiration a plusieurs sens (définitions) : - Respiration = Ventilation pulmonaire : Circulation de l'air dans les poumons, durant l'inspiration et l'expiration, dans le but de renouveler continuellement les gaz respiratoires. Diffusion de l'oxygéne des poumons vers Ies - Respiration externe capillaires pulmonaires et diffusion du dioxyde de carbone de ces capillaires vers les poumons. Respiration interne : Diffusion de l'oxygéne du sang vers les cellules et du C02 des cellules vers les capillaires systémiques. Respiration cellulaire : qui se référe å la réaction intracellulaire de l'oxygöne (02) avec les molécules organiques pour produire le gaz carbonique (C02) et d l'énergie sous forme d'ATP. Pr. Safre EUDRISSI Scanned with CamScanner.