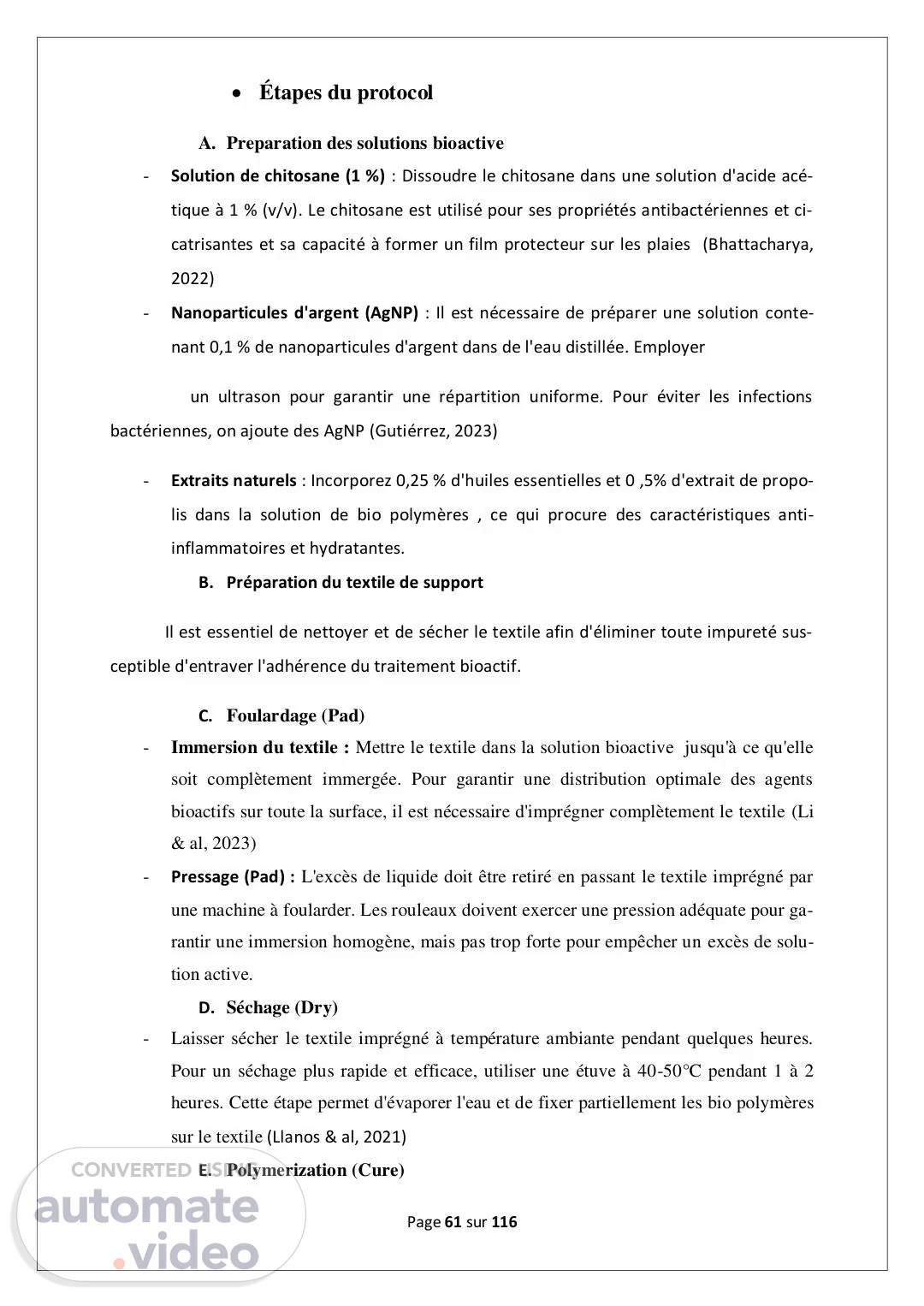Scene 1 (0s)
Page 61 sur 116 Étapes du protocol A. Preparation des solutions bioactive - Solution de chitosane (1 %) : Dissoudre le chitosane dans une solution d'acide acé- tique à 1 % (v/v). Le chitosane est utilisé pour ses propriétés antibactériennes et ci- catrisantes et sa capacité à former un film protecteur sur les plaies (Bhattacharya, 2022) - Nanoparticules d'argent (AgNP) : Il est nécessaire de préparer une solution conte- nant 0,1 % de nanoparticules d'argent dans de l'eau distillée. Employer un ultrason pour garantir une répartition uniforme. Pour éviter les infections bactériennes, on ajoute des AgNP (Gutiérrez, 2023) - Extraits naturels : Incorporez 0,25 % d'huiles essentielles et 0 ,5% d'extrait de propo- lis dans la solution de bio polymères , ce qui procure des caractéristiques anti- inflammatoires et hydratantes. B. Préparation du textile de support Il est essentiel de nettoyer et de sécher le textile afin d'éliminer toute impureté sus- ceptible d'entraver l'adhérence du traitement bioactif. C. Foulardage (Pad) - Immersion du textile : Mettre le textile dans la solution bioactive jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergée. Pour garantir une distribution optimale des agents bioactifs sur toute la surface, il est nécessaire d'imprégner complètement le textile (Li & al, 2023) - Pressage (Pad) : L'excès de liquide doit être retiré en passant le textile imprégné par une machine à foularder. Les rouleaux doivent exercer une pression adéquate pour ga- rantir une immersion homogène, mais pas trop forte pour empêcher un excès de solu- tion active. D. Séchage (Dry) - Laisser sécher le textile imprégné à température ambiante pendant quelques heures. Pour un séchage plus rapide et efficace, utiliser une étuve à 40-50°C pendant 1 à 2 heures. Cette étape permet d'évaporer l'eau et de fixer partiellement les bio polymères sur le textile (Llanos & al, 2021) E. Polymerization (Cure).
Scene 2 (1m 5s)
Page 62 sur 116 - Polymerization thermique : Après séchage, les textiles sont placés dans une étuve à 100-120°C pendant 1 à 2 heures pour achever la polymérisation. Cette étape permet d'immobiliser définitivement les bios polymères et les nanoparticules sur le support textile, assurant ainsi une libération contrô- lée d'agents bioactifs au contact de la plaie ( (González & al, 2023) Pour optimiser la fixation des polymères au support, il serait préférable d'utiliser une solution de glycérol (1 %) ou d'acide citrique (0,5 %). F. Stérilisation - Stériliser le pansement après polymérisation en utilisant un autoclave (121°C pendant 15 minutes) ou par irradiation UV pendant 30 minutes. Cela garantit que le pansement est exempt de toute contamination avant utilisation (Bhattacharya, 2022) Figure 17 élaboration par la technique ‘’Pad-Dry-Cure’’ (photos original).
Scene 3 (1m 39s)
Page 63 sur 116 la technique ‘’spray-coating‘’ La production de pansements actifs à l’aide de la technologie de revêtement par pulvé- risation présente de nombreux avantages. L'épaisseur du revêtement peut être contrôlée, garantissant une répartition uniforme des subs- tances bioactives et s'adaptant aux différentes surfaces. En combinant des biopolymères, des nanoparticules antimicrobiennes et des extraits naturels, les pansements actifs obtenus peuvent favoriser la cicatrisation tout en luttant contre les infec- tions bactériennes, répondant ainsi à la demande d'innovation dans le domaine du soin des plaies. Étapes du protocol A. Solution de chitosane (1 %) : Dissoudre le chitosane dans une solution d'acide acétique à 1 % (v/v). Le chitosane est utilisé pour ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes et sa capacité à former un film protecteur sur les plaies (Bhattacharya, 2022) B. Préparation des nanoparticules : Il est nécessaire de préparer une solution contenant 0,1 % de nanoparticules d'argent dans de l'eau distillée. Employer un ultrason pour ga- rantir une répartition uniforme. Pour éviter les infections bactériennes, on ajoute des AgNP (Gutiérrez, 2023) C. Préparation des agents naturels: Incorporez 0,25 % d'huiles essentielles et 0 ,5% d'ex- trait de propolis dans la solution de biopolymères, ce qui procure des caractéristiques anti-inflammatoires et hydratantes. D. Assemblage des solutions pour spray-coating : - Mélange des solutions : Combiner la solution de chitosane avec les nanoparticules d'argent et les extraits naturels. Mélanger uniformément sous agitation magnétique pour obtenir une solution homogène. Ce mélange servira de base pour le revêtement par pulvérisation. E. Préparation du substrat de pansement: - Utiliser un substrat biodégradable : un film de : (gélatine 3%, chitosan 2% et de glycérol 2%) préalablement fabriqué. Ce substrat servira de support pour le panse- ment actif (Li & al, 2023).
Scene 4 (2m 44s)
Page 64 sur 116 F. Application par spray-coating: - Pulvérisation des solutions : Sur le substrat de pansement, appliquez une solution homogène de chitosane qui renferme des nanoparticules et des agents bioactifs. Si be- soin, appliquez plusieurs couches pour obtenir l'épaisseur désirée (environ 100-300 μm), en laissant chaque couche sécher avant de procéder à la prochaine (Li et al., 2023). - Laissez le pansement sécher à température ambiante ou dans une étuve à 40°C pour intensifier la procédure de séchage. G. Stérilisation du pansement: - Une fois séchés, il est nécessaire de procéder à la stérilisation des pansements en optant pour une technique adéquate : autoclave (121°C, 15 minutes) ou irradiation UV pendant 30 minutes. La stérilisation est essentielle pour garantir le bon fonction- nement des équipements médicaux (Bhattacharya et al. 2022). Figure 18 élaboration par la technique la technique ‘’spray-coating (Photo original).
Scene 5 (3m 24s)
Page 65 sur 116 3. Etude in vitro 3.1. Méthode d’analyse GC-MS : Les échantillons ont été analysés sur la Plateforme Technique d’Analyse Physico-Chimique PTAPC- CRAPC à Laghouat, Algérie, utilisant un ap- pareil SHIMADZU GCMS-QP2020 muni d’une colonne capillaire Rxi®-5ms fusionnée de Cross bond® 5 % diphényle / 95 % diméthyle polysiloxane, 30 m × 0,25 mm id... Épaisseur du film de 0,25 μm. La phase de la colonne est similaire et en série avec les colonnes HP-1ms, HP-1msUI, DB-1ms, DB-5ms, DB-1msUI., Ultra-1, VF-1ms, ZB-1ms et elles sont aussi considérés équivalentes avec les phases USP G1, G2, G38.. Un volume de 0,5 μL d’échantillon dilué dans n-hexane. Nous avons maintenu les températures de l'injecteur et du détecteur à 250°C et 310°C, respectivement. La colonne a été réglée à une température fixe de 50°C pendant 2 minutes, puis elle a été désactivée. 3.2. Evaluation de l’activité antioxydant de l’huiles essentielles et pro- polis La méthode du piégeage du radical DPPH• Principe Le test DPPH permet de mesurer le pouvoir anti radicalaire de molécules pures ou d'extraits vé- gétaux dans un système modèle (solvant organique, température ambiante). Il mesure la capacité d'un antioxydant (composés phénoliques généralement) à réduire le radical chimique DPPH par trans- fert d'un hydrogène .Le DPPH, initialement violet, se transforme en DPPH-H de couleur jaune pâle (Berset, 2006) Figure 19 Forme libre et réduite de DPPH (Berset, 2006).
Scene 6 (4m 25s)
Page 66 sur 116 Protocole On a ajouté 400 ml de chaque concentration de l'huile essentiel ou de la référence (acide ascor- bique) à 1600 μL de solution de DPPH préparée dans du méthanol. On a incubé les solutions dans l'obscurité pendant 30 minutes, puis on a mesuré les absorbances à λ=517 nm. On a testé les extraits et la référence à diverses concentrations (62,5 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 μg/ml) .Un blanc a été préparé pour chaque extrait de la plante et de la référence en utilisant 400 μL de méthanol et 1600 μL de la solution DPPH. Chaque concentration de l'extrait testé a fait l'objet de trois essais. On a donc établi l’IC50 (con- centration de l'échantillon requise pour neutraliser 50% des radicaux libres). La formule suivante ex- prime l'activité antioxydante associée à l'effet de piégeage du radical DPPH ̇ en pourcentage d'inhibi- tion (PI). PI % = [(AC - AE) / AC] × 100 AC: absorbance en absence de l’inhibiteur (contrôle négatif) AE: absorbance en présence de l’HE 3.3. Activité anti inflammatoire Principe Dans cette étude, les propriétés anti-inflammatoires in vitro des huiles essentielles d'ori- gan, de menthe, de lavande ainsi que de la propolis ont été examinées en utilisant le modèle de dénaturation de l'albumine. Cette technique repose sur la capacité de l'extrait brut à réduire la dénaturation thermique de la BSA (sérum albumine bovine) (Bouhlali, 2016) L'évaluation de l'activité anti-inflammatoire se base sur une méthode de dénaturation des pro- téines, initialement décrite par (Kandikattu, 2013) avec des modifications apportées au pro- tocole expérimental. Protocol Les solutions mères sont préparées en dissolvant 16 mg des extraits dans 1 ml d'eau distillée. Quatre dilutions sont ensuite réalisées à partir de cette solution mère, avec des facteurs de dilution de 1/2, 1/4, 1/8 et 1/16. Pour chaque dilution, trois répétitions sont effectuées dans une microplaque de 96 puits..
Scene 7 (5m 30s)
Page 67 sur 116 Un blanc est préparé en mélangeant 100 μl de Tris-HCl et 100 μl d'extrait. Le témoin négatif, composé de 100 μl de BSA et 100 μl d'eau distillée, permet d'évaluer la dénaturation complète de la BSA en l'absence de substance inhibitrice. Les échantillons sont préparés en mélangeant 100 μl de BSA avec 100 μl d'extrait, tandis que le standard est obtenu en combinant 100 μl de BSA avec 100 μl de Diclofénac. Tous les échantillons, incluant le blanc, le témoin négatif, les échantillons et le standard, sont incubés pendant 20 minutes à 72 °C. Après l'incubation, les échantillons sont refroidis, puis l'absorbance est mesurée à 660 nm avec un lecteur de microplaques. Le pourcentage d'inhibition de la dénaturation est calculé selon la formule suivante : PI (%) = (Abs control - Abs ext.) / Abs control * 100. Equation 1 le pourcentage d'inhibition - Où : PI représente le pourcentage d'inhibition. Abs control : l'absorbance du contrôle. Abs ext l'absorbance de l'extrait 3.4. Activités antifongique de l’huiles essentielles et propolis La méthode des disques a été employée pour évaluer l'activité antifongique des champignons pathogènes. On a placé un disque de chaque souche test au centre d'une boîte de gélose PDA, puis on a ajouté 40 μl de chaque concentration sur le disque. On a testé des concentrations de 100, 50 et 25 mg/ml. Les diamètres de différentes régions d'inhibition ont été mesurés à l'aide d'une règle transpa- rente après 48 heures d'incubation à 25 °C et enregistrés en mm De l'eau distillée stérilisée a été utilisée comme témoin positif et la souche en question a été utilisée comme témoin négatif (tous les tests ont été réalisés en triplicata). 3.5. Activités antibactérienne de l’huiles essentielles et propolis L’activité antibactérienne de l’huiles essentielles et propolis obtenus, a été testé en Choisissant la méthode de diffusion sur disques, appelée aussi méthode de Vincent ou tech- nique de l’aromatogramme mise au point par Schroeder et Messing en 1949. Principe.
Scene 8 (6m 35s)
Page 68 sur 116 Le principe de cette méthode est d’imprégner des disques de papier Wattman n°1 de 6 mm de diamètre avec les substances à tester, vis-à-vis de deux souches bactériennes : Escherichia coli (Gram-) (NCTC 10418) et à Gram+ : Staphylococcus aureus (ATCC 25923) Protocol Les échantillons sont repris dans le méthanol à raison de 100 mg pour 1 ml. Des disques de papier Wattman stériles de 6 mm de diamètre sont imprégnés avec 10 μL de chaque solu- tion mère ainsi deux autres dilutions (5% et 2 ,5%). Finalement on prépare des disques impré- gnés de méthanol. Ces deux dernières catégories de disques serviront de contrôle. Des disques de ciprofloxacine (5μg), érythromycine (15 μg), Chloramphénicol (30 μg) ont été également utilisés comme antibiotique de référence. (Tous les tests ont été réalisés en triplicata). - A partir de colonies jeunes de 18 à 24 h, une suspension bactérienne est réalisée dans l’eau distillée stérile pour chaque souche. La turbidité de cette suspension est ajustée à 0,5 Mc Farland puis diluée au 1/100. On obtient alors un inoculum estimé à 106 unités formant colonie par millilitre (ufc/ml). Cet inoculum est ensemencé par inondation sur des boites de Pétri contenant la gélose Mueller-Hinton. Les disques imprégnés des différents extraits et fractions sont ensuite délicatement dépo- sés à la surface de la gélose. Il en est de même pour les disques de ciprofloxacine. Les boites de Pétri sont d’abord laissées pendant 1h à la température ambiante pour une pré-diffusion des substances, avant d’être incubées à 37°C à l’étuve pendant 24 h 3.6. Caractérisation du chitosane et nanoparticules Test de solubilité du chitosane On examine la solubilité du chitosane extrait dans les milieux acides, basiques et neutres. Le test de solubilité a été effectué dans 5 % (v / v) d'acide acétique, 0,5 de NaOH et de l'eau distillée, selon Ngah et Fatinthan (Fatinathan, 2008) le teste de solubilité a été réalisé dans 5 % (v / v) de l’acide acétique, 0.5 de NaOH et de l’eau distillée. On pèse environ 0,05 g de produit ajouté à 50ml de ses trois solutions séparément, et les laisser sous agitation pendant 24 heure. Nous avons effectué la solubilité de chitosane à diffé- rents concentrations 10% 8% 6% 4%.
Scene 9 (7m 40s)
Page 69 sur 116 Caractérisation par FTIR Principe Les molécules absorbent la lumière infrarouge lors de la spectroscopie infrarouge à transfor- mée de Fourier (FTIR), ce qui entraîne des vibrations spécifiques des liaisons chimiques. Chaque groupe fonctionnel au sein d'une molécule possède un profil d'absorption particulier dans la région infrarouge, ce qui permet d'identifier et de caractériser les composés chimiques situés. Il existe une certaine perte de lumière infrarouge lors du passage à travers un échantil- lon, ce qui signifie que certaines longueurs d'onde sont absorbées. Ce type d'absorption est dû aux transitions d'énergie entre les niveaux vibrationnels des molécules, c’est-à-dire aux vibra- tions causées par les liaisons chimiques des molécules dans la bande d'absorption. Toutes les liaisons chimiques dans un composé ont leurs fréquences d'absorption caractéristiques ; ainsi, les groupes fonctionnels présents dans l'échantillon peuvent être analysés (Stuart, 2004) La technique FTIR utilise un interféromètre de Michelson pour moduler le signal infrarouge. Un signal complexe dans le domaine temporel est transformé en un spectre à l'aide de la trans- formée de Fourier. Cette transformation permet de reconstruire le signal diffusé, mesurant ainsi la concentration des groupes fonctionnels et présentant les groupes fonctionnels de nombres d'onde spécifiques (Smith, 2011) Spectre FTIR : On obtient un spectre avec des pics d'absorption caractéristiques de différents groupes chimiques. Les pics sont observés à des nombres d'onde différents en cm⁻¹ et sont utilisés dans l'identification des composés et des structures moléculaires. (Griffiths, 2007) L’absorbance par spectroscopie UV-VIS 3.6.3.1. Chitosane Préparation de la solution de chitosane : Mélanger le chitosane avec de l'acide acétique à une teneur de 1 mg/ml. Assurez-vous de dis- soudre entièrement le chitosane en agitant la solution pendant au moins une heure. (Kumirska, et al., 2010) Préparation de la solution tampon phosphate : Préparer une solution tampon phosphate à un pH de 7.4. Cette solution servira de milieu pour la mesure de l'absorbance. (Dasheng Liu, 2006) Calibration du spectrophotomètre :.
Scene 10 (8m 45s)
Page 70 sur 116 Utilisez la solution tampon phosphate comme blanc et assurez-vous que le spectrophotomètre est correctement étalonné sur la plage de longueurs d'onde appropriée (généralement entre 200 et 400 nm). Transférer une petite quantité de solution de chitosane dans une cuvette propre et sèche Nanoparticules d’argents Pour préparer l'échantillon : Dissoudre ou de disperser les nanoparticules dans un solvant adéquat (notamment de l'eau ou de l'éthanol) afin d'obtenir une suspension colloïdale. Évaluation de l'absorption : L'échantillon doit être placé dans une cuve en quartz propre et soumis à un spectrophoto- mètre UV-visible. On enregistre le spectre d'absorption sur une plage de longueurs d'onde, généralement comprise entre 200 et 800 nm 3.7. Tests des propriétés du pansement Capacité d'absorption L'évaluation de l'aptitude du pansement à absorber des exsudats se fait en le plongeant dans une solution saline pendant 24 heures et en quantifiant le volume d'absorption (Llanos & al, 2021) Activité antimicrobienne L'efficacité antimicrobienne contre S. aureus et E. coli est évaluée en utilisant la tech- nique de diffusion sur milieu solide. Dans les zones traitées, les nanoparticules d'argent ou de zinc devraient entraver la prolifération des bactéries (Gutiérrez, 2023) Taux d'humidité L'humidité, en général, inclut toutes les substances qui s'évaporent lors du chauffage, en- traînant une perte de masse de l'échantillon. Le pourcentage de teneur en eau des films, sou- vent appelé de manière inexacte le taux d'humidité des films, sera déterminé en séchant de petits morceaux de films préalablement pesés dans une étuve à 110°C pendant 6 heures. (Eduarda Mueller, 2024) Test de Perméabilité.
Scene 11 (9m 47s)
Page 71 sur 116 Pour la perméabilité à la vapeur d'eau, 5 g de chlorure de calcium (CaCl₂) ont été ajoutés dans des béchers. Ces béchers sont ensuite recouverts de films sans aucun trou ni défaut et scellés avec un film. Un gradient d'humidité relative d'environ 100 % doit être maintenu à travers le film en plaçant les béchers à l'intérieur d'un dessiccateur contenant de l'eau distillée. (Rhim, 2007) Test d'enfouissement dans le sol Les films de biopansement obtenus, seront enterrés dans le sol agricole à une profondeur de 5 à 7 cm en dessous de la surface du sol (dans des pots) à température ambiante (22°C). (Tosin, 159, 184-195.) 4. Etude in vivo Notre étude a été réalisée sur des rats femelles de souches albinos pesant entre 150g et l80g, provenant de L’animalerie de la faculté de science de la nature et de la vie, Université des Frères Mentouri-Constantine 1. Avant et après le traitement, les animaux sont placés dans des cages en plastique avec libre accès à la nourriture (croquettes) et à l'eau. Pour chaque rat, des plaies cutanées sont réalisées sur la partie antéro- dorsale. Après in- duction de l'anesthésie, les rats sont rasés sur la partie souhaitée. Puis, Enfin, après application d'une tension de la peau à inciser, une ouverture superficielle de la surface délimitée précé- demment est réalisée d'un seul coup de bistouri, en commençant par une lame perpendiculaire et en continuant de gauche à droite en abaissant la main lame à 45° environ. Après incisions les rats sont placés dans des cages individuelles. Figure 20 Test de perméabilité par le desséchant CaCl₂.
Scene 12 (10m 50s)
Page 72 sur 116 4.1. Répartition des lots Les rats ont été pesés et identifies au niveau de la queue avec un feutre indélébile puis mets ensuite dans des cages étiquetées et individuelles. Les animaux ont été repartis en trois lots, chaque lot étant constitué de deux rats comme suit : Lot Témoin (T) : ne reçoit aucun traitement ; Lot PT : traité par le pansement bioactif type « textile » ; Lot PB : traité par le pansement bioactif type « Biofilm » ; Figure 21 Traitement des plaies des trois lots 4.2. Traitement des animaux L'observation macroscopique des différentes plaies est réalisée avant chaque nouvelle ap- plication. Durant toute la période de notre étude, nous avons contrôlées certains paramètres: -Poids des rats: les rats ont été pesés chaque 3 jour (Ier, 3ème, 6 ème, 9 ème, 12 ème, et 14 ème jour). -Apparition de rougeur, d'œdème et de bourgeon : ces phénomènes sont surveillés durant toute la période de notre étude. -Apparition et la disparition de la croûte : ces phénomènes sont surveillés durant toute la période de notre étude. 4.3. Observation et évaluation.
Scene 13 (11m 37s)
Page 73 sur 116 Lot Témoin (T) Les rats du lot témoin, qui n'ont reçu aucun traitement, montrent une cicatrisation plus lente. Les signes d'inflammation, comme la rougeur et l'œdème, persistent plus longtemps par rapport aux lots traités. La formation de croûtes est marquée, et les bourgeons apparaissent plus tardivement, indiquant une cicatrisation retardée par rapport aux lots traités. Lot PT (Pansement Textile) Le pansement bioactif appliqué avec la technique ‘’Pad-Dry-Cure’’ montre une amélioration visible de la cicatrisation par rapport au lot témoin : Réduction de l'inflammation : La rougeur et l'œdème diminuent rapidement après les premiers jours d'application. Ces observations suggèrent une activité anti-inflammatoire des composants bioactifs du pansement textile. Formation des bourgeons : La phase de régénération tissulaire s’initie précocement avec l'apparition rapide de bourgeons. Ce résultat témoigne de la stimulation de la cicatrisation par le pansement bioactif textile. Formation de croûtes : Bien que des croûtes se forment, elles sont moins marquées que dans le lot témoin, probablement grâce à l'humidité retenue par le pansement. Lot PB (Pansement Biofilm) Le pansement biofilm, appliqué par la technique « Spray-Coating », montre des résultats par- ticulièrement favorables en termes de cicatrisation : Réparation tissulaire optimisée : Le biofilm appliqué en fine couche couvre la plaie de ma- nière homogène et maintient un niveau d’hydratation stable, favorisant ainsi une cicatrisation rapide. Limitation des croûtes : Les plaies sous pansement biofilm présentent moins de croûtes. La cicatrisation en milieu humide, facilitée par le biofilm, permet une guérison plus douce et ré- duit le risque de marques visibles. Diminution rapide de l'inflammation : Les signes de rougeur et d'œdème disparaissent plus rapidement que dans les autres lots, reflétant une bonne efficacité anti-inflammatoire du pan- sement biofilm. Comparativement au lot témoin, les pansements bioactifs, en particulier le pansement biofilm (PB), favorisent une cicatrisation plus rapide et plus complète. Les plaies traitées avec le pansement textile (PT) montrent également des progrès importants en termes de réduction de l'inflammation et de.
Scene 14 (12m 42s)
Page 74 sur 116 stimulation de la régénération tissulaire. Cependant, le pansement biofilm offre une cicatrisation en milieu humide plus efficace, limitant la formation de croûtes et laissant des plaies visuellement plus saines, ce qui suggère un potentiel élevé pour les applications médicales où une cicatrisation rapide et sans marques est souhaitée. Figure 22 Aspect des plaies des lots : témoin ; PT;PB durant l’étude (photo original).
Scene 15 (13m 2s)
Page 75 sur 116 IV. Résultats et discussion.
Scene 16 (13m 9s)
Page 76 sur 116 5. Résultats et discussion : 5.1. Rendement 5.2. Les rendements d’extractions en huiles essentielles des feuilles et des sommités fleuries d’origan et lavande , et des feuilles du menthe ainsi que la propolis, nano- particules et chitosan sont exprimés en pourcentage . (Tableau 1). Tableau 2 Rendement d’extraction des espèces étudiées Espèces Rendement (%) Lavande Menthe Origan Propolis Nanoparticules D’Argent Chitosan 5.3. Etude in vitro Chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse GC-MS Propolis Les résultats de l'analyse GC-MS de l'extrait de propolis ont mis en évidence la pré- sence de différents composés bioactifs, répartis en différentes catégories : Substances volatiles : Les monoterpènes à faible concentration, le linalool et le linalyl acé- tate (temps de rétention de 15,750 min et 22.949 min, respectivement), jouent un rôle dans l'effet antimicrobien et antioxydant de la propolis. En outre, les propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires du carvacrol et de l'acide salicylique (24.591 min et 24.971 min) renfor- cent les utilisations thérapeutiques de l'extrait..
Scene 17 (13m 54s)
Page 77 sur 116 Composés phénoliques : L’eugénol (27.399 min) et l’acide caféique (61.650 min) sont des phénols bien documentés pour leurs effets antioxydants et anti-inflammatoires. Ils ont des concentrations notables dans l'extrait, ce qui souligne leur rôle dans la stabilité et l’efficacité antimicrobienne de la propolis. Les acides gras : n-hexadécanoïques et 9-octadécanoïques (49,904 min et 55.363 min), ainsi que l'éthyl oléate (56,194 min), jouent un rôle dans les propriétés hydratantes et la bio- disponibilité des composés actifs de la propolis. Les flavonoïdes et les antioxydants : qui sont abondants dans cet extrait (64,706 min, 4,28 %), ainsi que la galantine (70,867 min), sont connus pour leur activité antioxydante et anti-inflammatoire. L'abondance de ces substances indique une capacité de protection élevée contre les radicaux libres et renforce les avantages de l'extrait. Figure 23 chromatogramme d'extrait de propolis.
Scene 18 (14m 37s)
Page 78 sur 116 Tableau 3 les principaux composants identifiés dans l'extrait éthanoïque de propolis, accompagnés de leur temps de rétention, pourcentage de la surface du pic, et similarité Origan L'analyse GC-MS de l'huile d'origan révèle une concentration élevée de composés bioactifs, principalement des terpènes et des phénols. Le thymol (24,719 min, 32,67%) est le composé phénolique principal de l'huile d'origan. Il est connu pour ses puissantes propriétés antimicrobiennes, anti oxydantes et anti-inflammatoires γ-terpinène (13,921 min, 23,05%) : Ce terpène, présent en grande quantité, est connu pour ses propriétés antioxydantes et antimicrobiennes, agissant ainsi en synergie avec le thymol dans l'huile. o-Cymene (12.352 min, 19.61% ) : Ce composé aromatique hydrocarboné, qui constitue en- viron 20 % de l'huile, est fréquemment associé à des propriétés anti-inflammatoires et à la stabilité de l'huile d'origan. Composants Temps de rétention Surface Similarité Linalool 15.750 min 0.10% 94 Linalyl acétate 22.949 min 0.18% 97 Carvacrol 24.591 min 0.16% 95 Salicylique acide 24.971 min 0.27% 96 Eugenol 27.399 min 1.38% 98 n-Hexadecanoic acide 49.904 min 0.97% 92 9-Octadecenoic acide, (E)- 55.363 min 2.42% 93 Ethyle Oleate 56.194 min 2.92% 91 Caféique acide 61.650 min 2.43% 75 Galangin 70.867 min 1.83% 87 Flavonoïdes 64.706 min 4.28% 91.
Scene 19 (15m 38s)
Page 79 sur 116 Myrcène (10.099 min, 2,48%) et α-terpinène (11,982 min, 4,77%) : Ces monoterpènes ont des propriétés antioxydantes et participent à la composition globale de l'huile en renforçant l'action anti-inflammatoire. Le caryophyllène (30,090 minutes, 1,66%) est un sesquiterpène reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires, même s’il est présent à un niveau inférieur. Il complète bien l’huile en renforçant ses effets apaisants et anti-inflammatoires. Tableau 4 les principaux composants identifiés dans l'huile essentielle d'origan, accompagnés de leur temps de rétention, pourcentage de la surface du pic, et similarité Figure 24 chromatogramme d’huile essentielle d'origan.
Scene 20 (16m 8s)
Page 80 sur 116 Composants Temps de rétention Surface similarité Thymol 24.719 min 32.67% 97 γ-Terpinene 13.921 min 23.05% 97 o-Cymene 12.352 min 19.61% 97 Carvacrol 25.031 min 3.61% 96 Myrcene 10.909 min 2.48% 97 α-Terpinene 11.982 min 4.77% 97 Caryophyllene 30.090 min 1.66% 96 Lavande L’analyse GC-MS a montré que l’huile de lavande est riche en esters et alcools terpènes. Les composés majoritaires et leurs temps de rétention sont les suivants : Linalyl acétate est le composé dominant présent dans l’huile de la lavande (23.017 min, 45,53 %). C’est un ester connu pour présenter des effets relaxants et anti-inflammatoires. La restauration de sa quantité est accréditée à l’odeur particulière de la lavande qui la rend re- laxante. Linalool est un alcool terpénique bien connu pour ses propriétés antimicrobiennes. À des taux élevés, il assure l’effet relaxant et antimicrobien avec le linalyl acétate. Eucalyptol (12.552 min, 2.09%) et 2-pinène (8.561 min, 2.49%) : bien que peu nombreux, ces composés apportent des propriétés antimicrobiennes et rafraîchissantes à l’huile de la- vande, et contribuent à la variété de ses odeurs naturelles Le terpinéol (19.887 min, 1.42%) a des propriétés apaisantes et légèrement analgésiques, ce qui contribue à l’effet relaxant de l’huile..
Scene 21 (17m 7s)
Page 81 sur 116 (+)-2-Bornanone (17.676 min, 4.81%) et endo-Borneol (18.708 min, 3.46%) Les pro- priétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes de ces composés renforcent l'efficaci- té thérapeutique de l'huile de lavande. De plus, ils participent à ses propriétés cal- mantes et analgésiques Composants Temps de rétention Surface similarité Figure 25 chromatogramme d'huile essentielle de lavande.
Scene 22 (17m 28s)
Page 82 sur 116 Menthe L’analyse GC-MS de l’huile de menthe montre une forte concentration du menthol et de la menthone dont on tire ses vertus rafraîchissantes et antiseptiques Menthol (19,591 min, 41,26%) : c’est le principal composé et on le connaît pour ses vertus rafraîchissantes, analgésiques et antimicrobiennes8. C’est la raison pour laquelle l’huile en contient en beaucoup 1-Menthone (18,524 min, 23,52 %): encore un cétone terpénique est la raison pour laquelle l’huile donne l’odeur de menthe mais aussi des bienfaits antioxydants et antimicrobiens L’acétate de menthol (19; 24,850 min, 5,68%): cet ester du menthol donne le côté calmant et apaisant de l’huile pour redoubler l’action antimicrobienne et anti-inflammatoire. Euca- lyptol (12.733 min, 8,89%) : pré- Linalool 15.793 min 28.80 96% Linalyl acétate 23.017 min 45.53% 97% Eucalyptol 12.552 min 2.09% 91% 2-Pinene 8.561 min 2.49% 98% Caryophyllene 30.053 min 1.83% 96% Terpineol (α-) 19.887 min 1.42% 97% (+)-2-Bornanone 17.676 min 4.81% 98% Endo-Borneol 18.708 min 3.46% 97% Figure 26 chromatogramme de l'huile de Menthe.
Scene 23 (18m 20s)
Page 83 sur 116 sent en petite quantité, apporte un effet rafraîchissant supplémentaire et des propriétés antimi- crobiennes, ce qui renforce l'effet antiseptique global de l'huile de menthe. Tableau 5 les principaux identifiés dans l'huile essentielle de Menthe, accompagnés de leur temps de rétention, pourcentage de la surface du pic, et similarité Composants Temps de rétention Surface Similarité Menthol 19.591min 41.26% 97% l-Menthone 18.524min 23.52% 96% Menthol Acétate 24 .85min 5.68% 98% Pulegone 22.297min 1.35% 96% Eucalyptol 12.733min 8.89% 91%.
Scene 24 (18m 51s)
Page 84 sur 116 5.4. Activité antioxydantes déterminée par la méthode du piégeage du radi- cal DPPH• La figure 5 montre les résultats de l'activité de piégeage du radical DPPH par les quatre ex- traits testés : propolis, origan, menthe, et lavande. À mesure que les concentrations augmen- tent, chacun des extraits montre une inhibition du radical DPPH de manière dose-dépendante. La propolis affiche une activité antioxydantes élevée, avec un pourcentage d'inhibition qui atteint presque 100 % à des concentrations plus élevées. L'huile essentielle d'origan montre également une bonne capacité de piégeage du radical DPPH, atteignant environ 60 % d'inhi- bition à des concentrations élevées. En revanche, les huiles essentielles de menthe et de la- vande présentent des activités antioxydantes plus faibles. La menthe atteint un taux d'inhibi- tion maximal d'environ 5 %, tandis que la lavande atteint environ 8 % aux concentrations les plus élevées. Figure 27 pourcentage d'inhibition du radical DPPH par les huiles essentiels et propolis.
Scene 25 (19m 30s)
Page 85 sur 116 Détermination de L’IC50 Les IC50 ont été calculés en utilisant les équations des graphes. Dans cette situation, l'extrait de propolis présente une IC50 plus faible que celle des autres extraits, reflétant ainsi une meil- leure activité antioxydantes. Les valeurs d'IC50 calculées sont les suivantes : propolis à 0,36 mg/ml, origan à 2,8 mg/ml, menthe à 44,9815 mg/ml, et lavande à 26, 54 mg/ml. Comme le montre le tableau 5, En comparaison, l'acide ascorbique, utilisé comme référence, présente une IC50 beaucoup plus basse, à 0,2 mg/ml, indiquant une efficacité antioxydantes bien supé- rieure par rapport aux extraits testés. Tableau 6 Les valeurs de IC50 de l’extrait et du standard dans le test DPPH IC50 (µg/ml) Acide ascorbique 0,36 Propolis 0,36 Origan 2 ,8 Lavande 26, 54 Menthe 44,98 Les résultats obtenus pour l'activité antioxydante, mesurée par le test DPPH, révèlent des différences notables entre les extraits de propolis et d'huiles essentielles de lavande, menthe et origan. Le standard, l'acide ascorbique, présente une IC50 de 0,36 mg/mL, soulignant son ef- ficacité élevée en tant qu'antioxydant de référence. La propolis, avec une IC50 de 0,36 mg/mL, se révèle également très efficace, comparable à celle de l'acide ascorbique. Cette ac- tivité peut être attribuée à la richesse de la propolis en composés phénoliques et flavonoïdes, connus pour leurs propriétés antioxydantes en neutralisant les radicaux libres via le transfert d'hydrogène. L'huile essentielle d'origan présente une IC50 de 2,8 mg/mL, ce qui témoigne d'une bonne capacité antioxydante, bien que moins marquée que celle de la propolis et de l'acide ascor-.
Scene 26 (20m 35s)
Page 86 sur 116 bique. Les huiles de menthe et de lavande montrent des IC50 beaucoup plus élevées, à 44,98 mg/mL et 26,54 mg/mL respectivement, indiquant une activité antioxydante relativement faible. Ces résultats sont en accord avec les études démontrant que l'activité antioxydante des huiles essentielles dépend fortement de leur composition en composés phénoliques et du type d'extraction employé. 5.5. Activité anti inflammatoire La dénaturation des protéines est l'une des causes de l'inflammation. Les anti- inflammatoires sont connus pour inhiber la dénaturation des protéines (Chatterjee et al., 2012; Mizushima, 1966). Dans la présente étude, l'inhibition de la dénaturation de l'albumine sé- rique bovine (BSA) induite par la chaleur a été utilisée pour évaluer les propriétés anti- inflammatoires des extraits de lavande, d'origan et de menthe. Le Diclofénac, utilisé comme référence, a montré une inhibition de la dénaturation de la BSA atteignant un maximum de 71,833 % à une concentration de 625 µg/ml. Les extraits de plantes, testés aux mêmes concentrations, ont également montré une inhibition dose-dépendante. L'extrait d'origan a présenté l'inhibition la plus élevée parmi les trois ex- traits, atteignant 59,481 % à 625 µg/ml. L'extrait de lavande a montré une inhibition maxi- male de 57,103 % à la même concentration, tandis que l'extrait de menthe a atteint un maxi- mum de 54,615 %..
Scene 27 (21m 30s)
Page 87 sur 116 Ces résultats montrent que les extraits d'origan, de lavande et de menthe possèdent tous une activité anti-inflammatoire, bien que leur efficacité varie. Cette capacité anti- inflammatoire est due à la présence de composés actifs, notamment les phénols et flavonoïdes, qui sont connus pour stabiliser les protéines et réduire les processus inflammatoires. L’origan, en particulier, possède des composants tels que le thymol et le carvacrol, recon- nus pour leur capacité à atténuer l'inflammation. Cela explique pourquoi il a montré le meil- leur potentiel anti-inflammatoire parmi les extraits étudiés. 5.6. Activités antibactérienne et antifongique de l’huiles essentielles et propolis L’activité antibactérienne et fongique des huiles essentielles (HE) est évaluée par le dia- mètre (en mm) des zones d'inhibition de la croissance microbienne, selon la méthode décrite par Dorman et Deans (2000). Pour estimer cette activité, une échelle de classification a été établie par Meena et Sethi (1994) et Ela et al. (1996), qui classes le pouvoir antimicrobien en quatre categories: 1. Fortement inhibitrice : diamètre de la zone d'inhibition supérieur à 28 mm ; Figure 28 pourcentage d'inhibition du BSA par les huiles essentiels et propolis.
Scene 28 (22m 17s)
Page 88 sur 116 2. Modérément inhibitrice : diamètre de la zone entre 16 et 28 mm ; 3. Légèrement inhibitrice : diamètre de la zone entre 10 et 16 mm ; 4. Non inhibitrice : diamètre de la zone d'inhibition inférieur à 10 mm ; Ce système de classification permet de quantifier et de comparer l'efficacité des HE contre la croissance microbienne. Activités antifungique Nos résultats sont résumés dans le tableau si dessous ainsi que les figures (7, 8,9) repré- sentent les diamètres des zones d’inhibitions. Tableau 7 Diamètres des zones d’inhibition (en mm) d’Aspergillus Niger Échantillon Concentration Diamètre (mm) Lavande 10% 18 5% 15 2,5% 15 Propolis 10% / 5% / 2,5% / Menthe 10% 23 5% 21 2,5% 1 5 Origan 10% 20 5% 16 2,5% 18 Témoin + 20 Témoin - Croissance mycélienne.
Scene 29 (22m 53s)
Page 89 sur 116 Les huiles essentielles de menthe et d’origan se distinguent par leurs effets modérément inhibiteurs contre Aspergillus Niger, même à des concentrations plus faibles, et pourraient être envisagées comme des agents antifongiques naturels poten- tiels. La lavande offre une certaine activité inhibitrice mais perd rapidement de son ef- ficacité avec la dilution. La propolis, pour sa part, n'a montré aucune activité inhibi- trice dans ces conditions, limitant son intérêt contre Aspergillus Niger. Ces observa- tions soulignent l'importance de la concentration et du choix des huiles essentielles pour maximiser les effets antimicrobiens dans des formulations naturelles. Activités antibactérienne de l’huiles essentielles et propolis Nos résultats sont résumés dans le tableau si dessous ainsi que les figures (7, 8,9) re- présentent les diamètres des zones d’inhibitions. Tableau 8 Diamètres des zones d’inhibition (en mm) des bactéries testées Échantillon Concentration E-Coli SA SM 17 16 Figure 29 Activité antifongique de l'huile d'origan.
Scene 30 (23m 35s)
Page 90 sur 116 Lavande 0 ,5 % 20 14 0 ,25 % 22 17 Propolis SM / / 0 ,5 % 10 20 0 ,25 % 14 20 Menthe SM 17 19 0 ,5 % 15 18 0 ,25 % 18 20 Solution actif 0 ,5 % / / 0 ,25 % 16 25 Témoin + / 15 19 Témoin - / 10 10 Figure 30 Activité antifongique de l'huile d'origan.