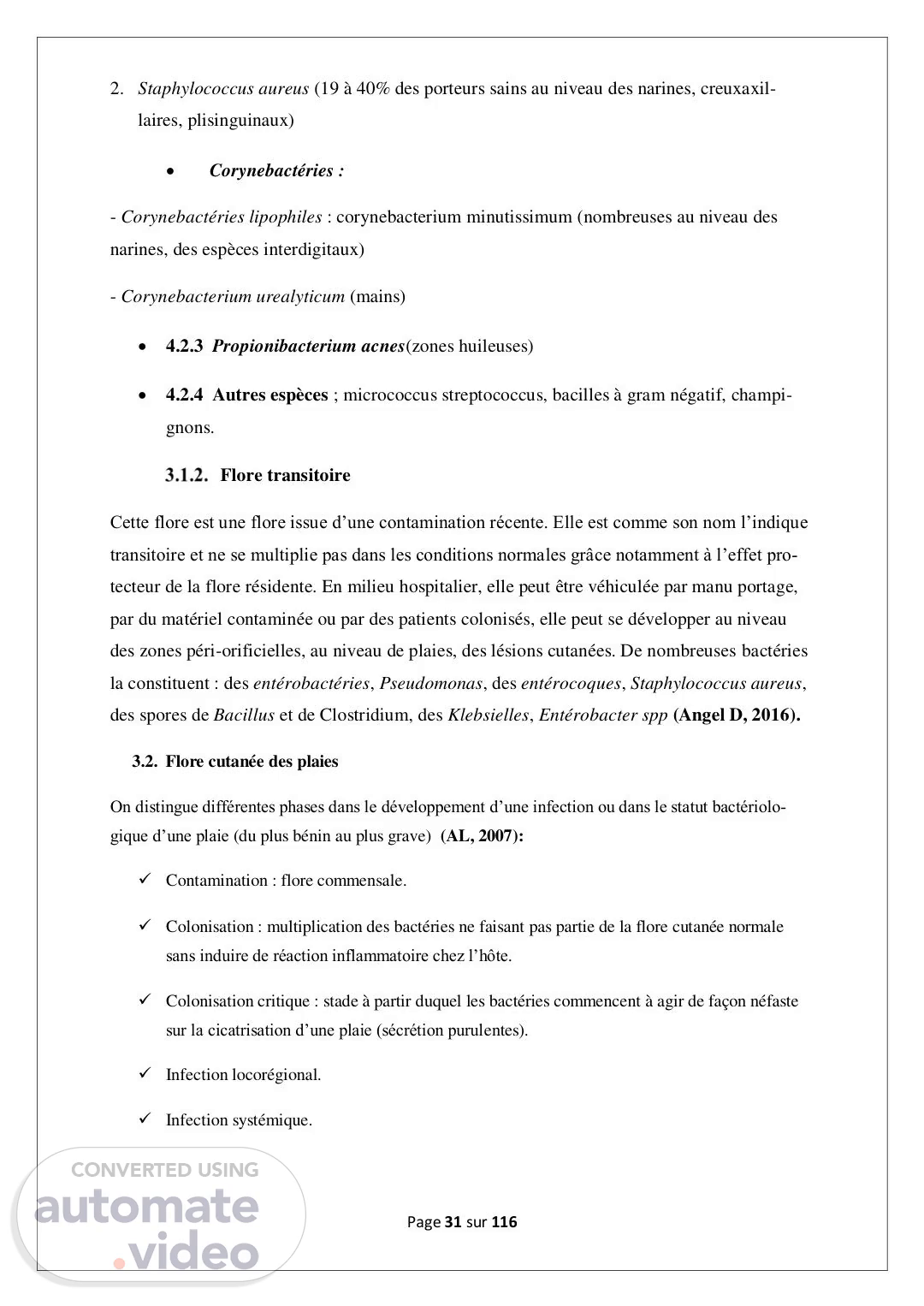Scene 1 (0s)
Page 31 sur 116 2. Staphylococcus aureus (19 à 40% des porteurs sains au niveau des narines, creuxaxil- laires, plisinguinaux) Corynebactéries : - Corynebactéries lipophiles : corynebacterium minutissimum (nombreuses au niveau des narines, des espèces interdigitaux) - Corynebacterium urealyticum (mains) 4.2.3 Propionibacterium acnes(zones huileuses) 4.2.4 Autres espèces ; micrococcus streptococcus, bacilles à gram négatif, champi- gnons. Flore transitoire Cette flore est une flore issue d’une contamination récente. Elle est comme son nom l’indique transitoire et ne se multiplie pas dans les conditions normales grâce notamment à l’effet pro- tecteur de la flore résidente. En milieu hospitalier, elle peut être véhiculée par manu portage, par du matériel contaminée ou par des patients colonisés, elle peut se développer au niveau des zones péri-orificielles, au niveau de plaies, des lésions cutanées. De nombreuses bactéries la constituent : des entérobactéries, Pseudomonas, des entérocoques, Staphylococcus aureus, des spores de Bacillus et de Clostridium, des Klebsielles, Entérobacter spp (Angel D, 2016). 3.2. Flore cutanée des plaies On distingue différentes phases dans le développement d’une infection ou dans le statut bactériolo- gique d’une plaie (du plus bénin au plus grave) (AL, 2007): Contamination : flore commensale. Colonisation : multiplication des bactéries ne faisant pas partie de la flore cutanée normale sans induire de réaction inflammatoire chez l’hôte. Colonisation critique : stade à partir duquel les bactéries commencent à agir de façon néfaste sur la cicatrisation d’une plaie (sécrétion purulentes). Infection locorégional. Infection systémique..
Scene 2 (59s)
Page 32 sur 116 Différentes circonstances conduisant à un développement bactérien anormal de part l’écologie de ce développement (potentiellement pathogène) et son intensité : Une altération de la barrière physique comme peut l’être une plaie, Une contamination par des bactéries manu portées ou véhiculées au sein d’une struc- ture de soins, Une sélection par un traitement antibiotique général ou local, par des antiseptiques lo- caux. La flore cutanée des plaies est souvent poly-microbienne même en l’absence d’infection, elle est constituée de (Bolognia, 2018): Staphylococcus aureus ; dans 43 à 88% des cas. Staphylocoques blancs ; 14 à 21% des cas. Pseudomonas Aeruginosa : 7 à 33% des cas Plus rarement : Escherichia coli, Entérobacter cloaceae, Klebsielles, streptocoques, enterocoques, proteus, Ou des anaérobies. La prise en charge d’une plaie en voie d’infection diffère en fonction du stade de l’infection. On utilisera des thérapeutiques locales à partir du stade de colonisation critique, afin d’éviter un passage de la plaie vers le stade «infection» proprement dite. Ces thérapeutiques compren- nent par exemple un lavage correct de la plaie au sérum physiologique associé à des panse- ments. (Chan, 2021) Ces thérapeutiques locales ne seront plus utilisées seules au stade «infection» et seront asso- ciées à une antibiotique par voie générale. Outre la définition bactériologique de l’infection (numération bactérienne par biopsie profonde de la plaie), elle se caractérise par une clinique particulière et doit réunir au moins 2 des signes suivants. (Al-Hamdani, 2021) Augmentation du volume de la plaie ; Erythème péri-lésionnel ; Induration ;.
Scene 3 (1m 58s)
Page 33 sur 116 Sensibilité locale à la douleur ; Chaleur locale ; Présence de pus ; On caractérise comme évocateur d’une infection : des tissus friables, un décollement profond et une odeur nauséabonde. A ce stade d’infection, toutes les bactéries retrouvées au niveau de la plaie ne sont pas forcément impliquées dans l’infection on retrouve différents stades de pathogènes (Chan, 2021): Les pathogènes obligatoires : staphylocoques dorés, streptocoques. Les bactéries le plus souvent pathogènes : corynebactéries, staphylocoques blancs. Les bactéries plus au moins pathogènes (à discuter selon la sévérité de l’infection) : bacilles pyocyaniques, les entérobactéries. (Chan, 2021) Suite à ces constatation on se rend vite compte de l’importance du respect de la bactérie cycle d’une plaie .cet équilibre fragile pouvant d’un jour à l’autre être rompu à la suite d’un «stress local», conduisant vers l’infection (Chan, 2021) . Suite à ces constatation on se rend vite compte de l’importance du respect du bactériocycle d’une plaie .cet équilibre fragile pouvant d’un jour à l’autre être rompu à la suite d’un «stress local», conduisant vers l’infection (Chan, 2021). 4. Textiles fonctionnalisés pour le soin des plaies 4.1. Les supports textiles des pansements Les textiles fonctionnalisés pour le soin des plaies sont des matériaux conçus pour offrir une protection et un environnement propice à la cicatrisation des plaies. Les supports textiles des pansements peuvent être fabriqués à partir de fibres textiles obtenues de polymères naturels ou synthétiques. Les fibres textiles obtenues de polymères naturels, tels que la cellulose, l'al- ginate et le collagène, sont largement utilisées dans la fabrication des pansements en raison de leur biocompatibilité et biodégradabilité. Elles induisent et stimulent le processus de cicatrisation et ne rapportent pas de réactions immunologiques. (Chan, 2021).
Scene 4 (3m 3s)
Page 34 sur 116 Les fibres textiles obtenues de polymères synthétiques : sont également uti- lisées dans la fabrication des pansements. Elles doivent présenter plusieurs pro- priétés, telles que l'absence de toxicité, de réaction allergique, la stérilité, la bio- compatibilité et de bonnes propriétés mécaniques. Les fibres textiles présentent une longueur d'au moins 100 fois leur diamètre et peuvent être assemblées en fils pour former des étoffes par tissage, tricotage, tressage, ou par enchevêtrement de fibres ou de mono-filaments pour former des non tissés. (Chan, 2021) Augmentation du volume de la plaie ; Erythème péri-lésionnel ; Induration ; Sensibilité locale à la douleur ; Chaleur locale ; Présence de pus ; 4.2. La fonctionnalisation de pansements L’enrobage des fibres L'enrobage des fibres est une technique utilisée pour fonctionnaliser les pansements en incorporant des principes actifs ou des matériaux spéciaux dans la structure des fibres (Chaloupka, 2010)Cette technique permet de créer des pansements à libération de principes actifs, qui peuvent être utilisés pour traiter des plaies et favoriser la cicatrisation (Chaloupka, 2010) -Les fibres échangeuses d’ions - Les fibres creuses et fibres cœur-peau 4.3. Incorporation de microcapsules dans les (nano) fibres Les microcapsules sont des particules sphériques avec des dimensions entre 1 et 1000 micro- mètres qui peuvent contenir des substances solides, liquides ou gazeuses (J.Richard)L'incorporation de microcapsules dans des fibres, notamment des fibres textiles, peut être réalisée en utilisant des techniques de micro encapsulation, telles que la coacervation complexe, la gélation ion tropique ou la polycondensation inter faciale (J.Richard).
Scene 5 (4m 3s)
Page 35 sur 116 Les microcapsules peuvent contenir des substances actives, telles que des parfums, des huiles essentielles ou des médicaments, qui peuvent être libérées lentement pour des applications spécifiques, telles que l'industrie textile, la cosmétique ou la pharmacie (J.Richard) La stabilité des microcapsules dépend des interactions entre leurs composants, et la surface chimique des fibres textiles peut être utilisée pour moduler ces interactions et améliorer la stabilité des microcapsules (J.Richard) La stabilité des microcapsules dépend des interactions entre leurs composants, et la surface chimique des fibres textiles peut être utilisée pour moduler ces interactions et améliorer la stabilité des microcapsules (J.Richard) 4.4. LA MICROENCAPSULATION Définition La micro encapsulation est une des techniques de conservation de la qualité des subs- tances sensibles et une méthode pour la production des matériaux avec de nouvelles propriétés intéressantes constituées d’un matériau enrobant contenant une matière active. La micro en- capsulation est un procédé qui consiste à enfermer des particules micrométriques dans une coquille de polymère, qui à son tour les isole et les protège de l'environnement extérieur. Le produit obtenu par ce procédé est appelé les microparticules qui sont différenciés par leur morphologie et leur structure. Les particules obtenues se divisent en 3 groupes: microparticules, nanoparticules et lipo- somes (J.Richard) Les nanoparticules : Les nanoparticules sont des systèmes colloïdaux dont la taille est comprise entre 10 et 1000 nm, à base de polymères généralement biodégradables, ou de lipides capables de retenir une ou des molécules actives par séquestration et/ou adsorption. Les nanoparticules peuvent être de type matriciel, le principe actif est dispersé ou dissous dans la matrice de polymère, ou de lipides, on parle alors de nano sphères. Les nanoparticules peuvent aussi être de type réser- voir, il s’agit alors de nano capsules, constituées d’un cœur généralement liquide entouré d’une fine membrane de polymère généralement dont l’épaisseur ne dépasse pas quelques nanomètres (J.P.Benoît) Les microparticules.
Scene 6 (5m 8s)
Page 36 sur 116 Les microcapsules sont des structures réservoirs et sphériques, elles sont constituées d'un cœur généralement huileux entouré par une mince paroi de polymère dont l'épaisseur n'excède pas quelques nanomètres, le principe actif est généralement dissous dans le cœur huileux, mais peut aussi être adsorbé sur la surface des microcapsules .Dans cette géométrie, les taux d'encapsulation peuvent être particulièrement élevées: entre 85% et 90% de masse de matière active par rapport à la masse de microparticules (S.Rabeau, 2009) Figure 6 Morphologie des microparticules (S.Rabeau, 2009) 4.5. La micro encapsulation dans le domaine pharmaceutique Dans le domaine pharmaceutique, des microcapsules contenant des médicaments sont utili- sées par voie orale ou par injection interne dans le muscle. Les microcapsules sont principa- lement conçues pour contrôler la durée de la libération du principe actif (S.Rabeau, 2009) .Les microcapsules sont véhiculées dans le corps. Puis par la dispersion et l’infiltration du médicament vers l’endroit ciblé, une concentration propre et une durée spécifique de la libération permettent de donner pleinement les effets du médicament (S.Rabeau, 2009) 4.6. Les systèmes multicouches de polyélectrolytes (PEM) Les polyélectrolytes font l'objet d'un grand nombre de travaux. Différents aspects ont été trai- tés du point de vue théorique, Simultanément, le développement et la mise en place de tech- niques expérimentales, comme par exemple la diffusion de lumière, de neutrons et de rayons X aux petits angles ou encore les mesures de viscosité, ont permis d'étudier ces systèmes. La présence des charges sur les chaînes de polymères, donne naissance à des propriétés intéres- santes, différentes de celles des polymères neutres, avant de détailler quelques concepts géné- raux, il est important de définir dans un premier temps ce qu'est un polyélectrolyte (Vowden, 2011). Les polyélectrolytes (PE).
Scene 7 (6m 13s)
Page 37 sur 116 Les polyélectrolytes sont des polymères qui portent des charges, ces charges proviennent de groupements ionisables qui se dissocient dans des solvants polaires, tels que l'eau, le dimé- thylformamide DMF, et le diméthylsulfoxide DMSO. L'eau dissocie facilement (forte cons- tante diélectrique) et solvate bien (moment dipolaire permanent) les charges. Par conséquent, presque tous les poly électrolytes sont fortement solubles dans l'eau. L'ionisation de ces poly électrolytes en solution aqueuse provoque des chaînes polymères chargées appelées ployions (les macro ions), et de petits ions libres appelées conterions de charges opposées. Il peut y avoir deux types de conterions: ceux libérés par les macromolé- cules en s'ionisant en solution et ceux dus à un sel ajouté. Ce dernier induit aussi des ions de même charge que celle portée par le ployions appelé coion (A. Bray, 1998) On peut classer les différents poly électrolytes en fonction de leur origine ; ainsi on trouve : - les polyélectrolytes naturels. - les polyélectrolytes synthétiques. Les polyélectrolytes naturels Les polysaccharides Les polysaccharides ou polyosides sont issus d’origine naturelle, c’est des sucres complexes sous forme d’enchaînement macromoléculaire constitués par polymérisation d’un seul type d’oses (homo polysaccharide) ou plusieurs (hétéros polysaccharides) (A. Bray, 1998) . 1. Le Chitosane : C’est un polysaccharide linéaire cationique (polycation) . Il contient de la nacétylglucosamine (2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranose) et glucosa- mine (2-amino-2-unités de désoxy-β-gluco-pyranose) [30], il est extrait des coquilles de crus- tacés il est sous forme de chitine désacétylée (W.R. Gombotz, 1998) .il est généralement in- soluble dans les solutions aqueuses ayant un pH supérieur à 7, mais en raison de la protona- tion des groupes amino libres dans le glucosamine, le chitosane se dissout dans des solutions acides diluées avec pH inférieur à 6 (Di Martino, 2005)Le chitosane est largement utilisé dans des applications médicales sous diverses formes, telles que les gels, les poudres, les films et les fibres (M. E. Gomes, 2004) ..
Scene 8 (7m 18s)
Page 38 sur 116 Figure 7 Structure chimique du chitosane (M. E. Gomes, 2004) . 2. L’amidon : Parmi tous les polysaccharides l’amidon est le deuxième composé le plus abondant après la cellulose, il est de nature semi-cristalline, linéaire ramifié et il peut être modifié, sa structure est composée d’unité de glucoses liés par des liaisons glyco- sidiques. Il est disponible dans les plantes vertes et aussi dans les algues, il se compose de deux types de molécules l’amylose (amorphe) et l’amylopectine (cristallin) et la composition varie selon l’origine botanique et le fond génétique (F. R. Torres, 2013)L’amidon est disponible sous diverses formes telles que ; les micros sphères, les nano sphères les gels, les hydrogels, les graines et les films, et il est utilisé dans le do- maine biomédical (Z. M. Huang, 2003, )Il est couramment utilisé pour ses propriétés épaississantes ainsi que gélifiantes (Z. M. Huang, 2003, ) 3. Les alginates : Ce sont des polysaccharides linéaires anioniques dérivés principale- ment de parois cellulaires de couleur brune « Algues ». Ils sont constitués de résidus d'acide βD-mannuronique (M) et d'acide α-L-guluronique (G), leur unité est répartie en blocs MM, GG et MG. Ils ont la capacité de former des complexes polyélectrolytes et des gels en réagissant avec des cations. Les alginates peuvent être appliqués dans les cosmétiques, l’industrie alimentaire, pharmaceutique et en médecine en raison de leur biodégradabilité et non-toxicité (K.I. Draget, 2002) . 4. Les polypeptides et les protéines 5. Les poly nucléotides Polyélectrolytes synthétiques Les polyélectrolytes synthétiques sont la plupart des polyélectrolytes utilisés aujourd'hui, car ils offrent un avantage considérable par rapport aux polyélectrolytes naturels. Ils présentent l'avantage d'être produits en quantités importantes, avec une régularité élevée, une pureté éle-.
Scene 9 (8m 23s)
Page 39 sur 116 vée et une grande régularité dans l'enchaînement des monomères. Néanmoins les polyélectro- lytes naturels restent irremplaçables pour des applications spécifiques, notamment pour la médecine, leur origine leur confère en effet des propriétés uniques de biocompatibilité et bio- dégradabilité (K.I. Draget, 2002). 1. Poly2-acryloylamido-2-méthylpropanesulfonique (PAMP) 2. Polystyrène sulfonate de sodium (PSSNa) 3. Polyacide acrylique (PAA) Complexes de polyélectrolytes Une propriété très intéressante des polyélectrolytes est leur capacité de former des complexes avec les poly électrolytes des charges opposées, un processus qui est connu pour être important dans les systèmes biologiques aussi (E. Tsuchida and K. Abe, 1986)Les com- plexes de poly électrolytes CPEs, (poly électrolyte complexes PECs en anglais), sont formés par interaction entre des polyanions et polycations conduisant à la libération de contre-ions. La formation de CPEs peut avoir lieu en solution ou aux interfaces. Ce dernier phénomène a conduit au développement d’une nouvelle forme de matériaux hybrides nano-structurés sous la forme de films minces. Figure 8 Schéma de la libération de contre-ions sur la formation du complexe poly électrolyte (E. Tsuchida and K. Abe, 1986) Paramètres liés à la construction des systèmes PEM Nature des Poly électrolytes : Les poly électrolytes (PE) utilisés, tels que le PAH (polyallylamine), le PEI (polyéthylèneimine) et le PAA (acide polyacrylique), ont des.
Scene 10 (9m 18s)
Page 40 sur 116 propriétés différentes (charge, conformation, etc.) qui affectent les caractéristiques des films multicouches. (Ankerfors, 2008). Concentration des Poly électrolytes : La concentration des solutions de PE influence l'épaisseur et la densité des couches déposées. Une concentration plus élevée entraîne généralement une croissance plus rapide des films (Ankerfors, 2008). Charge des Couches : La charge des couches successives (positive ou négative) dé- termine l'interaction électrostatique entre elles et impacte la structure, la stabilité et les propriétés des films (Ankerfors, 2008) . Épaisseur des Couches : L'épaisseur des couches individuelles peut varier de quelques angströms à plusieurs dizaines d'angströms selon les conditions de dépôt (pH, force ionique, etc.). Cela affecte les propriétés de barrière et de perméabilité des films. (Ankerfors, 2008). Interactions Électrostatiques : Les interactions électrostatiques entre les couches de PE chargées opposément sont le principal mécanisme de construction des films multi- couches. Elles déterminent l'assemblage, la stabilité et les propriétés des systèmes PEM (Ankerfors, 2008) Influence sur les Propriétés Physicochimiques Les propriétés physicochimiques des films multicouches sont fortement influencées par ces paramètres de construction (E. Tsuchida and K. Abe, 1986) en particulier : - La morphologie et la structure des films. - La solidité mécanique et la capacité à résister à la destruction. - Les caractéristiques de perméabilité et de barrière. - Les interactions avec les biomolécules (protéines, cellules, etc.) - Les caractéristiques de surface (mouillabilité, charge, etc.) En modifiant ces divers paramètres, il est donc envisageable de créer des systèmes PEM avec des caractéristiques physicochimiques optimisées pour diverses applications biomédicales (Kong, 2018). Stabilisation des systèmes PEM.
Scene 11 (10m 21s)
Page 41 sur 116 Il est essentiel de garantir la stabilité des systèmes PEM afin de garantir leur fonctionnalité et leurs performances. Cela nécessite un contrôle approfondi des conditions de dépôt, de la per- méabilité, de la charge des couches et de la conception globale du système. Grâce à ces mé- thodes, il est possible de garantir la stabilité à long terme et les performances nécessaires aux applications biomédicales. 1. Ajustement des Conditions de Dépôt des Couches Le contrôle des paramètres de dépôt tels que le pH, la force ionique, la température, etc. per- met d'optimiser l'assemblage et la stabilité des multicouches (E. Tsuchida and K. Abe, 1986) 2. Contrôle de la Perméabilité des Multicouches La perméabilité des films PEM doit être ajustée pour empêcher une fuite indésirable des es- pèces encapsulées (médicaments, inhibiteurs, etc.) (Kong, 2018) . 3. Modification de la Charge des Couches L'ajustement de la charge des couches successives (positive/négative) influence les interac- tions électrostatiques et améliore la stabilité des systèmes PEM (Kong, 2018). 4. Utilisation d'Agents Stabilisants L'ajout d'espèces chimiques comme des réticulant peut renforcer la stabilité mécanique et la résistance à la dégradation des films multicouches (E. Tsuchida and K. Abe, 1986) . 5. Optimisation de la Conception du Système Une conception judicieuse des paramètres de construction (nature des PE, épaisseur, etc.) permet d'obtenir des systèmes PEM stables et fonctionnels (Kong, 2018) . 4.7. Applications biomédicales des systèmes PEM De nombreux domaines biomédicaux utilisent les systèmes PEM, allant de la prescription de médicaments à la thérapie cellulaire. Leur particularité réside dans leur aptitude à contrôler de manière précise la libération de composés bioactifs et leur compatibilité avec les tissus biologiques. En médecine régénérative, les systèmes PEM sont utilisés pour entourer et main- tenir les cellules thérapeutiques, ce qui facilite leur transplantation et leur survie dans l'orga- nisme (Kong, 2018) .De plus, ces systèmes sont employés dans l'élaboration de dispositifs implantables destinés à administrer des médicaments de manière précise, ce qui facilite une.
Scene 12 (11m 26s)
Page 42 sur 116 administration précise et contrôlée de substances thérapeutiques (Sahiner, 2014) , En outre, les systèmes PEM sont analysés en raison de leur potentiel dans le domaine de la bioimpression en 3D (Ma, 2018). 1. Modification des tissus et microchirurgie : Les systèmes PEM sont utilisés pour des procédures de modification des tissus et de microchirurgie, offrant une précision ac- crue et des résultats améliorés. 2. Fabrication de dispositifs médicaux : Les films multicouches de polyelectrolytes sont employés dans la fabrication de dispositifs médicaux pour diverses applications biomédicales. 3. Imagerie biomédicale : Les systèmes PEM sont utilisés dans des techniques d'image- rie biomédicale avancées, offrant une résolution élevée et des capacités d'imagerie précises. 4. Microscopie à haute résolution : Les applications biomédicales des systèmes PEM incluent la microscopie à haute résolution pour des études détaillées des tissus et des cellules. 5. Interactions chimiques et biologique 5.1. Substances antibactériennes Les agents antimicrobiens occupent une place importante grâce à leurs rôles, comme inhibi- teurs de croissance des bactéries, des champignons, des virus et des insectes donc sont classés comme des agents antibactériens, antiviraux, antioxydants, anticancéreux et antifongiques (Deshmukh, 2015). Ces agents antimicrobiens peuvent agir de différentes manières, soit en tuant les micro- organismes (bactéricide, fongicide, virucide), soit en inhibant temporairement leur croissance (bactériostatique). Ils sont utilisés dans divers domaines tels que la médecine, l'agroalimen- taire, l'hygiène et la recherche microbiologique pour assurer la stérilisation, la désinfection et la prévention des infections. Il existe de nombreuses sources naturelles de substances antimicrobiennes, qui peuvent être d’origine végétale, animale ou microbiennes. Définitions.
Scene 13 (12m 30s)
Page 43 sur 116 Stérilisation C’est une opération qui a pour objet de tuer tous les micro-organismes d’une préparation. Le matériel traité est dit stérile quand le résultat est acquis, c'est-à-dire qu’aucun microorganisme n’est capable de se développer. Désinfection Opération, au résultat momentané, permettant de tuer des micro-organismes et/ ou d’inactiver des virus sur un support inerte. Antisepsie Opération, au résultat momentané, permettant, au niveau de support vivant, dans la limite de leur tolérance, d’éliminer, ou de tuer, les micro-organismes, et/ou d’inactiver les virus. Le résultat est limité aux micro-organismes et virus présents, au moment de l’opération. Classification agents physiques -La température. - Les radiations. -La pression. - La filtration ou la centrifugation. agents chimiques - Les antibiotiques et les sulfamides. Les antiseptiques. 5.2. Réactions entre les composants des pansements et les tissus de la plaie Les interactions entre les composants des pansements et les tissus de la plaie peuvent en- gendrer diverses réactions, influencées par la composition des pansements, la nature de la plaie et la sensibilité individuelle du patient (Thomas, 2010)Ces réactions peuvent inclure des irritations cutanées, des réactions allergiques, des inflammations, la macération de la peau et des réactions chimiques indésirables (Schreml, 2010) .Il est crucial que les professionnels de la santé sélectionnent des pansements adaptés aux besoins spécifiques du patient et surveillent.
Scene 14 (13m 27s)
Page 44 sur 116 attentivement toute réaction adverse (Bale, 2012)). En cas de réaction suspecte, le retrait du pansement et une consultation médicale sont recommandés. 5.3. Effets des agents antimicrobiens et des agents de cicatrisation sur l’environnement microbien de la plaie et le potentiel dans la régénération tissu- laire Les pansements antimicrobiens favorisent la guérison des plaies en contrôlant la charge bactérienne, en créant un environnement propice à la cicatrisation, en favorisant la régénéra- tion tissulaire et en protégeant la plaie contre les agents pathogènes, contribuant ainsi à un processus de guérison optimal. (EWMA, 2006.) Action antimicrobienne Les agents antimicrobiens présents dans les pansements, tels que l'argent ou l'iode, agissent en tuant les bactéries présentes dans la plaie et en empêchant la croissance de nou- velles bactéries. Cela réduit la charge bactérienne et prévient les infections, créant ainsi un environnement propice à la cicatrisation (romande, 2010) Création d'un environnement favorable Les pansements antimicrobiens maintiennent la plaie propre, protégée et humide, favo- risant ainsi la régénération des tissus. En maintenant un milieu humide, ils facilitent la migra- tion des cellules de la peau pour une cicatrisation efficace. De plus, en permettant les échanges gazeux nécessaires, ils favorisent la circulation de l'oxygène, essentiel à la guérison (Rinaudo, 2006) Drainage des exsudats Les pansements antimicrobiens absorbent l'excès d'exsudat de la plaie, favorisant ainsi un environnement propre et réduisant les risques d'infection. Ce drainage efficace contribue à maintenir la plaie dans des conditions optimales pour la cicatrisation (romande, 2010). 5.4. Méthodes biologiques antibactériennes Certaines plantes médicinales contiennent des composés naturels, comme les flavonoïdes, qui présentent une activité antibactérienne intéressante. Une étude a montré que l'extrait fla- vonique des feuilles de Marrubium vulgare avait un effet inhibiteur considérable sur la majo- rité des espèces bactériennes pathogènes testées, y compris des souches multi résistantes.
Scene 15 (14m 32s)
Page 45 sur 116 (Vowden, 2011)Ces composés naturels pourraient représenter une alternative intéressante aux antibiotiques. Mécanismes d'action antibactériens Les antibiotiques agissent selon différents mécanismes (Jones, 2015): Inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne (β-lactamines, glycopeptides) Inhibition de la synthèse protéique (aminosides, tétracyclines, macrolides) Inhibition de la synthèse des acides nucléiques (quinolones, rifamycines) Perturbation de la membrane cytoplasmique (polymyxines) La résistance bactérienne aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique, né- cessitant le développement de nouvelles approches thérapeutiques alternatives (Jones, 2015) Mécanisme d'action des molécules à activité biologique Les huiles essentielles sont connues pour leur activité antibactérienne, agissant notamment sur le quorum sensing des bactéries. Les polymères peptidiques étoilés ont également des mé- canismes d'action spécifiques (Jones, 2015). 6. Pansements avec principes actifs 6.1. Choix du pansement en fonction du type de plaie Le choix du pansement antimicrobien est fortement influencé par le type de plaie, car chaque type de plaie possède des caractéristiques et des besoins spécifiques en matière de traitement et de prévention des infections. Plaies superficielles Pansement adhésif ou non adhésif afin de préserver la propreté et la protection de la plaie contre les contaminants extérieurs. Plaies légèrement profondes Pansement stérile qui ne se fixe pas à la plaie afin de faciliter la cicatrisation. Plaies avec saignements légers à modérés Le pansement hémostatique ou compressif est utilisé pour gérer le flux sanguin..
Scene 16 (15m 28s)
Page 46 sur 116 Plaies infectées ou à risque d'infection Le pansement antimicrobien est utilisé pour éviter ou soigner l'infection. Des substances telles que l'argent ou l'iode peuvent être présentes dans ces pansements. Plaies présentant des quantités importantes d'exsudat (liquide sécrété par la plaie) Le pansement absorbant est utilisé pour absorber l'excès d'exsudats et maintenir un environnement humide favorable à la prise en charge. Plaies nécessitant une protection contre l'eau La protection de la plaie contre l'eau peut être assurée par un pansement imperméable ou un film transparent, permettant ainsi une surveillance visuelle de la guérison. Plaies chirurgicales La stérilité du pansement chirurgical permet de préserver la plaie des contaminants et de favoriser une cicatrisation optimale. 6.2. Impact des pansements sur le processus de cicatrisation : Les pansements ont un rôle essentiel dans la cicatrisation des plaies en créant un environ- nement favorable à une cicatrisation optimale. Selon les études, la composition et la structure des pansements contemporains ont une influence importante sur la progression de la cicatrisa- tion des plaies, avec des éléments tels que le taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR), les couches absorbantes et la respirabilité qui ont un impact sur le taux de réépithélialisation et la formation de croûtes (Jones, 2015) En outre, les bandages à structures multicouches ont un impact complexe sur la cicatrisation des plaies, avec des couches spécifiques visant à réduire les adhésions, gérer les exsudats, utiliser des médicaments et fermer la plaie (Smith T. &., 2018)En outre, des méthodes novatrices comme la technologie couche par couche sont mises en place. 6.3. Nouveaux matériaux pour les pansements bioactifs : Les matériaux innovants utilisés pour les pansements bioactifs constituent une avancée majeure dans le domaine de la guérison des plaies. Ces matériaux, généralement issus de sources naturelles ou conçus pour être en interaction active avec le processus de guérison, présentent de nombreux bénéfices par rapport aux matériaux classiques. Voici une analyse.
Scene 17 (16m 33s)
Page 47 sur 116 approfondie des principaux nouveaux matériaux employés dans le domaine des panse- ments bioactifs et de leurs bénéfices. Le chitosane : est un composé naturel dérivé de la chitine des crustacés, qui a des propriétés antimicrobiennes et hémostatiques (Jayakumar, 2011). L'alginate : qui provient des algues marines, se transforme en gel lorsqu'il entre en contact avec les exsudats, créant ainsi un environnement humide instable (Thomas, Alginate dressings in surgery and wound management, 2000) Le collagène : une protéine structurelle issue de sources animales, joue un rôle cru- cial dans la construction et la réparation des tissus (Jayakumar, 2011). L'acide hyaluronique : Il existe un polysaccharide naturel dans le tissu conjonctif, qui joue un rôle crucial dans la rétention de l'humidité et la régénération cellulaire (Litwiniuk, 2016) Les nanofibres : sont des matériaux à l'échelle nanométrique qui permettent une li- bération régulée de médicaments ou de facteurs de croissance directement sur la plaie (Boateng, 2015) Les hydrogels : sont des réseaux polymériques tridimensionnels qui ont la capacité d'absorber et de retenir de grandes quantités d'eau, ce qui les rend utiles pour maintenir un milieu humide (Vowden, The use of topical antimicrobials in wound management. Wounds UK,, 2011) Protéines en soie : Élaborées en raison de leur compatibilité avec le corps et de leur capacité à stimuler la cicatrisation sans provoquer de réactions immunitaires () Vepari, 2007) Miel médicinal : Produit pour ses propriétés antibactériennes naturelles et sa capa- cité à maintenir un environnement de guérison humide (Molan, 2001) 6.4. Avantages écologiques et biocompatibilité inhérente des biomaté- riaux dérivés de sources naturelles : Avantages Écologiques : Biodégradabilité : Le chitosane, l'alginate et le collagène sont des biomatériaux naturels qui se dégradent par voie biologique. Cela implique qu'ils ont la capacité de se décomposer naturelle- ment dans l'environnement sans laisser de résidus toxiques, ce qui permet de diminuer l'empreinte écologique des déchets médicaux (Molan, 2001)..
Scene 18 (17m 38s)
Page 48 sur 116 Ressources Renouvelables : Les biomatériaux naturels tels que les algues (pour l'alginate) ou les crustacés (pour le chitosane) peuvent être renouvelés. La durabilité de leur exploitation garantit une alimentation continue sans épuiser les ressources naturelles (Jayakumar, Bio- materials based on chitin and chitosan in wound dressing applications. , 2011) . Réduction de l'Empreinte Carbone : En général, la fabrication de biomatériaux provenant de sources naturelles pré- sente une empreinte carbone plus faible que celle des matériaux synthétiques. La fa- brication de produits finis à partir de matières premières naturelles demande souvent moins d’énergie (Thomas, Alginate dressings in surgery and wound management, 2000) Absence de Produits Chimiques Toxiques : Contrairement à de nombreux polymères synthétiques, les biomatériaux naturels ne requièrent pas l'emploi de substances chimiques toxiques pour leur fabrication ou leur dégradation (Venkatesan, 2010). Biocompatibilité : Compatibilité avec les Tissus Humains : En général, les tissus humains tolèrent bien les biomatériaux naturels, ce qui réduit les risques de réaction immunitaire ou de rejet. Ils ont souvent une structure proche de celle des éléments naturels du corps humain (Boateng J. S., 2010) Propriétés Antimicrobiennes Naturelles : Certaines substances naturelles présentent des propriétés antimicrobiennes intrinsèques, ce qui permet de prévenir les infections dans les plaies sans l'utilisation de substances chimiques (Friess, 1998). Favorisent la Régénération Tissulaire : Les biomatériaux naturels ont la capacité d'éta- blir une interaction bénéfique avec les cellules humaines, ce qui favorise la guérison et la restauration des tissus endommagés (Rabea, 2003). Absence de Réactions Allergiques : Ces biomatériaux sont moins susceptibles de susci- ter des réactions allergiques que certains matériaux synthétiques en raison de leur ori- gine naturelle (Litwiniuk M. K., 2016).
Scene 19 (18m 43s)
Page 49 sur 116 III. Matériels et Méthodes.
Scene 20 (18m 52s)
Page 50 sur 116 Matériels et Méthodes 1. Matériels 1.1. Support du pansement Un textile stérile en tissu non tissé Un dispositif médical à usage unique composé de viscose (70%) et de polyester (30%).La densité est de 45g/m2, c’est un Tissu extrêmement absorbant qui se distingue par sa faible capacité à s'adhérer , assure une certaine protection contre les germes et les saletés. (Laboratoire Aldismed , (2024)) 1.2. Polymère : Chitosane Définit au chapitre précédent (Partie théorique : Chapitre I : La chitine et le chitosane) 1.3. Les principes actifs : Propolis ( La cire d’abeille) INCI : CERA ALBA Famille : Cire : Solide ou liquide Origine : Animale La propolis est une substance riche en résine fabriquée par les abeilles à partir de di- vers exsudats végétaux.. Par l'ajout de sécrétions salivaires ou de matières gommeuses et bal- samiques collectées auprès de différentes espèces végétales (Boulechfar, 2019) La propolis est un matériau très visqueux et très adhérent qui recouvre les bourgeons et la résine des coni- fères (Ferhoum, 2010) Matériel végétal Le matériau végétal est composé de deux espèces : L’origan, la menthe (Mentha) et la lavande (Lavandula) de la famille des Lamiacées. Les plantes sélectionnées reposent sur leur utilisation traditionnelle en tant que plantes médicinales..
Scene 21 (19m 43s)
Page 51 sur 116 Nanoparticules d’argent Nanoparticule d’argent AgNp sont des matériaux métalliques composés de particules d’argent ultrafines, de taille généralement comprise entre 1 et 100 nanomètres. Les NPs d’argent sont importantes et dignes d’être étudiées en raison de leurs propriétés particulières en raison de la petite échelle de nanomètres. Elles libèrent Ag + qui détruisent la membrane cellulaire des micro-organismes, les empêchant de survivre et, par conséquent, sont utiles dans les applications de stérilisation et pour les pansements antibactériens. (Chaloupka, 2010) 2. Méthodes 2.1. Extraction du chitosane La matière première utilisée pour cette étude est l’exosquelette de crevettes rouge, Les ca- rapaces de crevettes utilisées dans cette étude pour synthétiser le chitosane sont ramenées d’un restaurant situé à Tipaza et le marché de poissons à Sétif , (les crevettes sont pêchées de la mer méditerranéenne) elles sont décortiquée lavées plusieurs fois avec l’eau de robinet afin d’éliminer toutes les impuretés possibles, ensuite à l’eau distillée puis séchées à l’aire libre et enfin broyées en fine poudre ..
Scene 22 (20m 24s)
Page 52 sur 116 Figure 9 Prétraitement des carapaces de crevettes (photo originale). Après le prétraitement, les carapaces de crevettes doivent subir une autre série de traitements qui se déroule en trois étapes essentielles : une déminéralisation, une déprotéinisation et une étape de blanchiment. Le protocole expérimental adopté dans cette étude pour l’extraction de la chitine est inspiré dans la littérature (Kadouche S, 2016) (Michael Oduor-odoteP, 2005).
Scene 23 (20m 45s)
Page 53 sur 116 Déminéralisation : Après avoir été prétraitées, les carapaces ont été précisément immergées dans une so- lution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl 1N avec un rapport de masse du solide/volume du liquide de 1 :10 (w/v). L'ensemble a été soumis à une agitation modérée pendant 6 heures à Figure 10 procédé de la fabrication de chitosane (Skaugrud., 1990).
Scene 24 (21m 8s)
Page 54 sur 116 une température de 50°C pour obtenir une texture homogène , Le carbonate de calcium (Ca- CO3), principal minéral des carapaces, réagit avec du HCl pour former du chlorure de cal- cium, de l'eau et du gaz carbonique, comme illustré dans la réaction indiquée ci-dessous. 2HCl +CaCO3 →CaCl2 +H2O+CO2 La solution a été filtrée après la déminéralisation et la matière obtenue a été lavée à plusieurs reprises avec de l'eau distillée jusqu'à ce qu'elle soit neutre, puis séchée à l'étuve pendant une nuit à une température de 50°C. Figure 11 Déminéralisation dans l’'acide chlorhydrique à une température de 50°C et Filtration (photo originale) Figure 12 après séchage dans l'étuve pendant une nuit à une température de 50°C. (Photo originale).
Scene 25 (21m 40s)
Page 55 sur 116 Déprotéinisation : Au cours de cette étape, les carapaces de crevettes déminéralisées ont été traitées avec de la soude NaOH (premier échantillon avec 4% de NaOH, deuxième échantillon avec 6%, troisième échantillon avec 8% et quatrième échantillon avec 10%) à une température de 100°C sur un agitateur à plaque chauffante. Pendant 6 heures, en utilisant une proportion so- lide/liquide de 1 :20 (w/v). Figure 13 Déprotéinisation avec la soude NaOH (photo originale) La filtration sous vide est effectuée puis la solution aqueuse est lavée à l'eau distillée afin de séparer la chitine de la solution. La matière récupérée a subi une nuit d'étuvage à une tempéra- ture de 40°C. Blanchiment : La déprotéinisation du produit a été effectuée en utilisant du peroxyde de l'hydrogène H2O2 (0,3%) avec un rapport solide/solvant de 1 :10 (w /v), accompagné d'une agitation ma- gnétique maintenue pendant 2 heures. Après avoir été rincée à plusieurs reprises avec de l'eau distillée, la chitine a été séchée dans l'étuve. (Rinaudo, 2006).
Scene 26 (22m 23s)
Page 56 sur 116 Synthèse du chitosane par la désacétylation de la chitine Le produit de la désacétylation de la chitine est appelé chitosane. Le traitement avec NaOH permet de réaliser cette étape, ce qui implique une diminution de la longueur de chaîne de la chitine en substituant le groupement acétyle pour obtenir le chitosane. Le rendement de la désacétylation peut être influencé par divers facteurs tels que la température, la durée du traitement et la quantité de chitine par rapport à la solution d'alcaline. La chitine a été traitée avec la solution de NaOH (12,5 M) dans la hotte, agitée et chauffée à 100C°, pendant deux heures. Une fois le traitement terminé, notre mélange a été filtré à l'aide d'un papier filtre. A la fin notre échantillon a été séché dans l’étuve à 60C°, ensuite nous avons récupère L’échantillon 2.2. Extraction de la propolis Une partie de la propolis a été séchée en plein air (figure a), puis transformée en poudre (figure b), Une bouteille en verre a été remplie à deux tiers de la poudre de propolis obtenue. Le reste du volume a été rempli avec de l'éthanol pur, La macération de l'extrait éthanoïque a duré une semaine, avec une agitation quotidienne (figure c). Par la suite, il a été récupéré par Figure 14 blanchiment avec peroxyde de l'hydrogène (photo originale).
Scene 27 (23m 16s)
Page 57 sur 116 un filtre de 150 mm de diamètre (figure d), et concentré par le rotavap à 70 °C (figure e) (Flórez, 2023) 2.3. Extraction de l’huile essentielle L'hydro distillation, en tant que méthode standard, est utilisée pour extraire une huile es- sentielle (MEYER-WARNOD, 1984) et pour vérifier sa qualité Un mélange atteint sa tem- pérature d'ébullition lorsque la somme des tensions de vapeur de Chaque composant a la même pression d'évaporation. Ainsi, elle est plus faible que tous les points d'ébullition des substances pures. De cette manière, le mélange « eau + huile essentielle » se dissout à une température inférieure à 100oC à une pression ambiante. En revanche, les composés aroma- tiques ont généralement des températures d'ébullition très élevées (RIVERA, 2006) L'hydro distillation a été utilisée pour extraire les huiles essentielles de ces plantes. Cette mé- thode implique d'immerger 100 g de la plante éventuellement broyée dans un ballon de 1 L rempli d'eau distillée, puis de la porter à ébullition. En utilisant une chauffe ballon. La condensation des vapeurs hétérogènes sur une surface froide est connue sous le nom de réfrigérant. Les huiles essentielles ont été séparées à l'aide d'une ampoule de décantation. Figure 15 Extraction de la propolis (photo originale).
Scene 28 (24m 7s)
Page 58 sur 116.
Scene 29 (24m 13s)
Page 59 sur 116 2.4. Extraction des nanoparticules Les nanoparticules peuvent être synthétisées à l’aide de diverses méthodes, notamment par le biais de techniques physiques, chimiques et biologiques. Les anciennes techniques de réduction chimique, y compris l’utilisation du citrate de sodium en tant que réducteur, sont fréquemment appliquées à la fabrication de nanoparticules métalliques stables. (Lee, 2020) Cependant, en raison du fait que ces techniques sont nocives pour l’environnement, des ap- proches écologiques basées sur des extraits végétaux sont également appliquées de manière répandue.. (Iravani, 2019) . Ces approches offrent la possibilité de fabriquer des nanoparti- cules présentant des caractéristiques similaires à celles obtenues par des techniques chi- miques, mais avec une toxicité moindre (Kumar, 2021 ) La méthode biologique ou "verte" utilise des extraits végétaux comme agents réducteurs et stabilisants. Le thé vert est riche en catéchines, des polyphénols aux puissantes propriétés antioxy- dants, Ces composés aident à réduire les ions métalliques pour former des nanoparticules stables Préparation de l'extrait végétal : infuser des feuilles de thé vert dans de l’eau distil- lée pendant 15-20 minutes, puis filtrer pour obtenir l'extrait aqueux.(figure A) Préparation de la solution de nitrate d’argent : Préparer une solution de nitrate d'argent (AgNO₃) à 1 mM en dissolvant 0,017 g d’AgNO₃ dans 100 ml d'eau distillée. (figure B) Réduction par l'extrait végétal : ajouter lentement la solution de nitrate d’argent (AgNO₃) sur l’extrait du thé en agitant à l’aide d’un agitateur magnétique (figure C). La couleur de la solution changera progressivement (souvent en jaune ou brun), indi- quant la réduction des ions Ag⁺ et la formation des nanoparticules Centrifugation du mélange : Après la synthèse, centrifugez le mélange à une vitesse appropriée (environ 3000-5000 tr/min) pendant 30 minutes. (figure D) Récupération des nanoparticules Une fois la centrifugation terminée, les nanoparti- cules sont généralement collectées sous forme de précipité au fond du tube (culot), tandis que le surnageant contient des composés non réagis ou des impuretés (figure E).
Scene 30 (25m 18s)
Page 60 sur 116 Séchage : par évaporation à l'air à température ambiante pour obtenir une poudre de nanoparticules (figure F) 2.5. Elaboration du pansement Dans le domaine des soins des plaies, le développement de pansements actifs repré- sente une avancée significative pour améliorer la cicatrisation et prévenir les infections. Deux techniques prometteuses, la méthode "Pad-Dry-Cure" et la technique de "spray-coating", se distinguent par leur capacité à intégrer des agents bioactifs sur des supports la technique ‘’Pad-Dry-Cure’’ La méthode Pad-Dry-Cure permet de créer des pansements actifs efficaces et durables en intégrant des bio polymères, des nanoparticules antimicrobiennes et des agents naturels sur un support textile. Cette technique assure une distribution homogène des agents bioactifs et une polymérisation stable, tout en préservant les propriétés mécaniques et antimicrobiennes essentielles pour la cicatrisation des plaies. Figure 16 Extraction des nanoparticules d'argent AgNps (photo original).