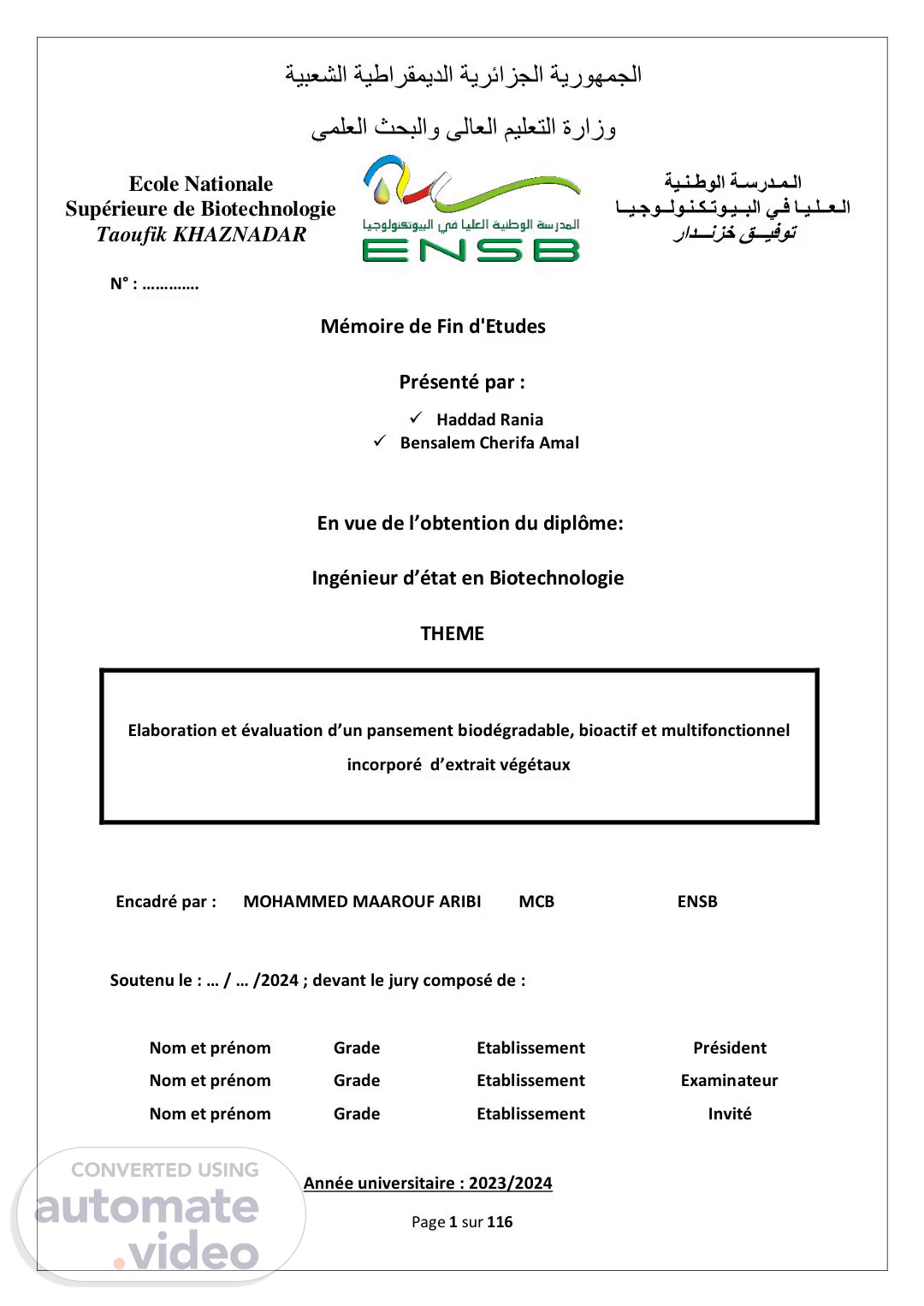Scene 1 (0s)
Page 1 sur 116 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو N° : …………. Mémoire de Fin d'Etudes Présenté par : Haddad Rania Bensalem Cherifa Amal En vue de l’obtention du diplôme: Ingénieur d’état en Biotechnologie THEME Soutenu le : … / … /2024 ; devant le jury composé de : Année universitaire : 2023/2024 Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie Taoufik KHAZNADAR ةيـنـطولا ةـسردـمـلا لوـنـكـتوـيــبلا يـف اـيـلــعـلاـــيـجوـا رادـــنزخ قـــيفوت Elaboration et évaluation d’un pansement biodégradable, bioactif et multifonctionnel incorporé d’extrait végétaux Encadré par : MOHAMMED MAAROUF ARIBI MCB ENSB Nom et prénom Grade Etablissement Président Nom et prénom Grade Etablissement Examinateur Nom et prénom Grade Etablissement Invité.
Scene 2 (30s)
Page 2 sur 116 Remerciements Nous remercions tout d’abord Allah le tout puissant de nous avoir donné la santé, le courage et la patience afin de pouvoir accomplir ce modeste travail et terminer nos études. Nous voudrions remercier profondément notre encadrant Mohamed MAROUF ARIBI pour avoir encadré et dirigé ce travail avec une grande rigueur scientifique, pour ses précieux conseils, ses efforts, son soutien, et son suivi durant toute la préparation de ce mémoire. Nos sincères remerciements vont aussi aux membres du jury pour le grand Honneur qu’ils nous ont fait en acceptant de présider et d’examiner notre travail. Vos conseils, vos critiques et vos appréciations seront les repères de nos projets futurs. Veuillez trouver dans ce modeste travail le témoignage de notre Profonde reconnaissance et notre sincère respect. Nos remerciements s’étendent à tous nos enseignants de l’ENSB pour l’aide qu’ils ont pu nous apporter au cours de nos recherches. Enfin, nous exprimons nos sincères reconnaissances et notre profonde gratitude à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin lors de la réalisation de ce travail..
Scene 3 (1m 13s)
Page 3 sur 116 Dédicace : Je dédie ce modeste travail à : A mon père Messaoud, qui a été mon modèle de force, d'amour incon- ditionnel et de détermination. Mon support dans la vie, qui m'a appris, m'a supporté et ma dirigé Vers la gloire, je tiens à te remercier au fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. A ma mère Ratiba, qui ma bénie par ces prières tout au long de mon par- cours, tu es ma source inépuisable d'amour, de compassion et de réconfort. Merci de m’encourager à croire en moi et à viser l'excellence. A mes très chère sœurs Sirine et Ritedj, mes compagnons de vie, mes confidents et mes meilleurs amis. Votre présence me rappelle que je ne suis jamais seule. A mon marie Amin, dont l’impact sur mon parcours a été inestimable. A toute la famille Haddad et Belkadi. A ma chère amie et âme sœur Ikram. A mes meilleures amies Chaima, Nour, Manel, Hana ,Afaf et Wissem. A ma meilleure rencontre à l’ENSB, mon cher binôme Cherifa. A tous les amis de l’ENSB. A tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce mémoire, je vous dis : Merci. Rania.
Scene 4 (2m 2s)
Page 4 sur 116 Dédicace : Je dédie ce modeste travail : Cherifa Amal.
Scene 5 (2m 10s)
Page 5 sur 116 Liste des figures : Figure 1 la structure de la peau humaine (P, 2014) ........................................................................... 12 Figure 2 la structure de l’épiderme (MAGALHÃES, 2020) .............................................................. 12 Figure 3 Evolution de la charge bactérienne dans les plaies infectées (Angel D, 2016) ....................... 20 Figure 4 Représentation schématique de la formation d'un biofilm poly microbien ........................... 21 Figure 5 Pansement hydro cellulaire (BARANOSKI S. A. E., 2016) ................................................. 28 Figure 6 Morphologie des microparticules [25]. ................................................................................ 36 Figure 7 Structure chimique du chitosane[35].................................................................................... 38 Figure 8 Schéma de la libération de contre-ions sur la formation du complexe poly électrolyte [41]... 39 Figure 9 Prétraitement des carapaces de crevettes (photo originale). ................................................ 52 Figure 10 procédé de la fabrication de chitosane (Skaugrud., 1990) ................................................... 53 Figure 11 Déminéralisation dans l’'acide chlorhydrique à une température de 50°C et ....................... 54 Figure 12 après séchage dans l'étuve pendant une nuit à une température de 50°C. ........................... 54 Figure 13 Déprotéinisation avec la soude NaOH (photo originale) ................................................... 55 Figure 14 blanchiment avec peroxyde de l'hydrogène (photo originale) ............................................. 56 Figure 15 Extraction de la propolis (photo originale) ......................................................................... 57 Figure 16 Extraction des nanoparticules d'argent AgNps (photo original) ........................................ 60 Figure 17 élaboration par la technique ‘’Pad-Dry-Cure’’ (photos original)......................................... 62 Figure 18 élaboration par la technique la technique ‘’spray-coating (Photo original) ........................ 64 Figure 19 Forme libre et réduite de DPPH (Berset, 2006) .................................................................. 65 Figure 20 Test de perméabilité par le desséchant CaCl₂ ..................................................................... 71 Figure 21 Traitement des plaies des trois lots .................................................................................... 72 Figure 22 Aspect des plaies des lots : témoin ; PT;PB durant l’étude (photo original) ....................... 74 Figure 23 chromatogramme d'extrait de propolis ............................................................................... 77 Figure 24 chromatogramme d’huile essentielle d'origan .................................................................. 79 Figure 25 chromatogramme d'huile essentielle de lavande ................................................................. 81 Figure 26 chromatogramme de l'huile de Menthe ............................................................................. 82 Figure 27 pourcentage d'inhibition du radical DPPH par les huiles essentiels et propolis.................... 84 Figure 28 pourcentage d'inhibition du BSA par les huiles essentiels et propolis ................................ 87 Figure 29 Activité antifongique de l'huile d'origan ............................................................................ 89 Figure 30 Activité antifongique de l'huile d'origan ............................................................................ 90 Figure 31 Activité antifongique de l'huile de lavande ........................................................................ 91 Figure 32 Activité antifongique de l'huile de Menthe......................................................................... 91 Figure 33 Activité antibactérienne de l'huile du Menthe .................................................................. 92 Figure 34 Activité antibactérienne de l’huile de la lavande ............................................................... 92 Figure 35 Activité antibactérienne de la propolis .............................................................................. 93 Figure 36 Activité antibactérienne de l'huile de la solution bioactif ................................................... 93 Figure 37 Spectre d'absorbance du chitosane synthétisé avec différentes concentration 4% 6% 8%10% ......................................................................................................................................................... 95 Figure 38 Spectre d'absorbance du chitosane commercial ................................................................. 95 Figure 39 Spectre UV VIS de nanoparticules d'argent ...................................................................... 97 Figure 40 spectres infrarouge du chitosane extrait a partir du carapace de crevette avec deux concentration différentes de NaOH 4% 6% ....................................................................................... 98 Figure 41 spectres infrarouge du chitosane extrait a partir du carapace de crevette avec deux concentration différentes de NaOH 8% 10% ..................................................................................... 99 Figure 42 Spectre infrarouge d'un chitosane commercial ................................................................. 100.
Scene 6 (3m 15s)
Page 6 sur 116 Figure 43 Spectre infrarouge du nanoparticule d'argent ................................................................... 102 Figure 44 spectre infrarouge du pansement a base du chitosane ....................................................... 106 Figure 45 spectre infrarouge du pansement a base d'un textile non tissé ........................................... 106 Liste des tableaux : Tableau 1 les types des plaies (Braun, 2024) ..................................................................................... 15 Tableau 2 Rendement d’extraction des espèces étudiées ................................................................... 76 Tableau 3 les principaux composants identifiés dans l'extrait éthanoïque de propolis, accompagnés de leur temps de rétention, pourcentage de la surface du pic, et similarité............................................... 78 Tableau 4 les principaux composants identifiés dans l'huile essentielle d'origan, accompagnés de leur temps de rétention, pourcentage de la surface du pic, et similarité ..................................................... 79 Tableau 5 les principaux identifiés dans l'huile essentielle de Menthe, accompagnés de leur temps de rétention, pourcentage de la surface du pic, et similarité .................................................................... 83 Tableau 6 Les valeurs de IC50 de l’extrait et du standard dans le test DPPH...................................... 85 Tableau 7 Diamètres des zones d’inhibition (en mm) d’Aspergillus Niger .......................................... 88 Tableau 8 Diamètres des zones d’inhibition (en mm) des bactéries testées ......................................... 89 Tableau 9 Diamètres des zones d’inhibition (en mm) des bactéries testées ......................................... 93 Tableau 10 Résultat de test de solubilité du chitosane synthétisé et commerciale ............................... 94 Tableau 11 Résultats du degré de désacétylation (DDA) % ............................................................. 101 Tableau 12 Résultats de test d'absorption ........................................................................................ 103 Tableau 13 les résultats du test d'humidité ....................................................................................... 103 Tableau 14 Résultat du test de perméabilité des biofilms de chitosane ............................................. 104 Tableau 15 les résultats du test d'enfouissement dans le sol ............................................................. 105.
Scene 7 (4m 15s)
Page 7 sur 116 Liste des abréviations : EPS : les substances polymères extracellulaires PDGF : facteur de croissance dérivé des plaquettes MEC : matrice extracellulaire TPN : Thérapie par pression négative CMC : carboxyméthylcellulose PEM : multicouches de poly électrolytes PAMP : Poly2-acryloylamido-2-méthylpropanesulfonique PSSNa : Polystyrène sulfonate de sodium PAA : Polyacide acrylique ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail MSD : Merck Sharp & Dohme (référence aux manuels médicaux) BSA : Bovine Serum Albumin (Albumine de sérum bovin) DPPH : 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (utilisé pour mesurer l'activité antioxydante) GC-MS : Gas Chromatography-Mass Spectrometry (Chromatographie en phase gazeuse- spectrométrie de masse) FTIR : Fourier Transform Infrared Spectroscopy (Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier) IC50 : Concentration Inhibitrice 50 (concentration nécessaire pour inhiber 50 % de l'activité d'une cible biologique, souvent utilisé dans les tests antioxydants et anti-inflammatoires) HE : Huile Essentielle EPS : Exopolysaccharides (utilisés dans le contexte des biofilms bactériens) PTAPC : Plateforme Technique d’Analyse Physico-Chimique NCTC : National Collection of Type Cultures (collection de cultures types utilisées dans les tests bactériens) PDGF : Platelet-Derived Growth Factor (Facteur de croissance dérivé des plaquettes, utilisé dans la cicatrisation).
Scene 8 (5m 2s)
Page 8 sur 116.
Scene 9 (5m 8s)
Page 9 sur 116 I. Introduction générale La prise en charge des plaies, qu'elles soient superficielles ou profondes, exige des so- lutions médicales capables de favoriser une cicatrisation rapide, de réduire les risques d'infec- tion. Dans le domaine de la biomédecine, l'innovation autour des pansements bioactifs et bio- dégradables suscite un intérêt croissant. Ces dispositifs médicaux modernes, enrichis en com- posants naturels et agents antimicrobiens, apportent des réponses efficaces pour soutenir le processus de cicatrisation. Ils offrent des avantages importants en termes de biocompatibilité et de durabilité, répondant ainsi aux exigences actuelles de santé et de développement durable. Le projet présenté ici s’inscrit dans cette dynamique innovante et vise la conception d’un pansement biodégradable et multifonctionnel. Ce dernier repose sur une matrice de bio- polymères combinée à des agents bioactifs d’origine naturelle, comme les huiles essentielles et autres extraits végétaux, choisis pour leurs propriétés antimicrobiennes et cicatrisantes. Cette composition permet de maintenir un environnement optimal pour la cicatrisation tout en assurant une protection contre les infections. Elle favorise également la régénération tissu- laire, ce qui est essentiel pour le rétablissement de l'intégrité de la peau endommagée..
Scene 10 (5m 56s)
Page 10 sur 116 Le document s’articule autour de plusieurs axes. Tout d’abord, une revue bibliogra- phique expose les bases théoriques de la cicatrisation et les types de plaies, ainsi que les diffé- rentes familles de pansements existantes et leurs applications. Ensuite, les matériaux et mé- thodes utilisés pour concevoir et tester ce pansement bioactif sont détaillés, incluant le choix des composants, les techniques d'incorporation des agents bioactifs et les étapes de fabrica- tion. Enfin, une évaluation expérimentale est réalisée pour étudier l’efficacité du pansement et ses effets sur le processus de cicatrisation. Par cette recherche, l’objectif est de contribuer au développement de solutions théra- peutiques qui non seulement soutiennent le processus de guérison des plaies, mais qui soient également respectueuses de l’environnement et adaptées aux exigences des systèmes de santé modernes. En intégrant des biomatériaux innovants et des agents naturels, ce projet ouvre la voie à des avancées prometteuses dans le domaine des soins des plaies, avec des applications potentielles tant au niveau local qu'international..
Scene 11 (6m 37s)
Page 11 sur 116 II. Revue bibliographique Partie 1: La peau, ses problèmes et les traitements 1. Anatomie, physiologie et renouvellement de la peau 1.1. Structure de la peau La peau est le plus grand organe du corps, représentant plus de 10 % de la masse corpo- relle, et celui qui permet au corps d'interagir le plus intimement avec son environnement ( NEVILLE AM, 1994) La peau n'est pas une simple enveloppe, c'est un organe vital. Elle nous préserve tout en nous L’offrant la possibilité de communiquer avec notre environnement ; Elle est un support de Notre identité et un marqueur du temps qui passe. Les 3 couches qui forment la structure de La Peau ont des fonctions différentes, mais complémentaires (INES., 2024).
Scene 12 (7m 12s)
Page 12 sur 116 Epiderme C’est la couche la plus superficielle de la peau. L'épiderme est la couche superficielle de la peau, composée de quatre sous-couches la couche basale, la couche spinuleuse, la couche granuleuse et la couche cornée, La couche basale permet le renouvellement des kératinocytes de l'épiderme et renferme des mélanocytes qui synthétisent la mélanine, qui est responsable de la pigmentation de la peau. Il y a 4 à 5 épaisseurs de kératinocytes liés entre eux dans la couche spinuleuse. Les cellules de la couche granuleuse sont remplies de grains de kératine et de mélanine. Les kératinocytes morts et sans noyau constituent la couche cornée, la plus ex- terne, qui garantit l'imperméabilité et la protection de la peau (Benedetti, 2021) Figure 2 la structure de l’épiderme (MAGALHÃES, 2020) Figure 1 la structure de la peau humaine (P, 2014).
Scene 13 (7m 50s)
Page 13 sur 116 L'épiderme a pour principale fonction de maintenir la couche cornée en état de renouvel- lement permanent, ce qui en fait une barrière imperméable et protectrice ,Les kératinocytes de cette couche sont morts et sans noyau, riches en kératine, une protéine fibreuse et insoluble dans l'eau et aussi protégeant l'organisme des agressions extérieures telles que les chocs, la pollution, les micro-organismes, les rayons UV nocifs , Il renferme des mécanismes de pro- tection contre les rayons UV, comme une augmentation de la production de kératinocytes afin de restreindre l'exposition aux UV et une stimulation de la production de mélanine, un pig- ment qui filtre les rayons UV et absorbe les radicaux libres générés dans les cellules par les rayons UV afin d'éviter qu'ils ne causent des dommages (Bolognia, 2018) Derme Le derme ou corium se trouve directement sous la membrane basale et se compose de tissu conjonctif dense et irrégulier avec un feutre de collagène, élastique et réticulaire fibres incorporées dans une substance fondamentale amorphe de mucopolysaccharides , Les types cellulaires prédominants du derme sont les fibroblastes, les mastocytes, et les macrophages. De plus, les plasmocytes, les chromatophores, les cellules adipeuses et les leucocytes extravasés sont souvent associés aux vaisseaux sanguins, aux nerfs et aux vais- seaux sanguins. Lymphatiques. Glandes sudoripares, glandes sébacées, follicules pileux et muscles arrecteurs des pili sont présents dans le derme. On peut arbitrairement diviser le derme en une partie superficielle couche papillaire qui se fond dans une couche réticulaire profonde. La couche papillaire est fine et se compose de tissu conjonctif lâche, qui est en contact avec l'épiderme et épouse le contour des crêtes et des sillons épithéliaux basaux. Quand il dépasse dans l'épiderme, elle donne naissance à la papille dermique. Quand l'épiderme s'invagine dans le derme, des picots épidermiques se forment. La couche réti- culaire est une couche plus épaisse constituée de tissu conjonctif dense et irrégulier avec moins de cellules et plus de fibres (MONTEIRO-RIVIERE, 1991) l'hypoderme.
Scene 14 (8m 55s)
Page 14 sur 116 renferme des cellules adipeuses qui produisent des cellules souches qui peuvent être utilisées pour synthétiser des facteurs de croissance tels que VEGF, IGF, HGF et TGF-β1, ce qui favo- rise la production et la migration des fibroblastes ; Il s'agit de la couche la plus profonde de la peau. Son rôle principal est d'amortir les chocs et de préserver le corps du froid grâce à un mécanisme d'isolation (B, 2009) 1.2. les fonctions de la peau : (VENUS M, 2010) le rôle d’une barrière de protectrice des organes et des tissus contre l'environnement extérieur et les agressions mécaniques. la protection contre les microorganismes. Les peptides antimicrobiens, les cellules de Langer- hans épidermiques résidentes et les cellules T épidermiques transitoires sont produits. Il est également important de souligner que les kératinocytes présents dans la couche cornée possè- dent une structure de type « scaffold » qui empêche la pénétration des bactéries. La peau as- sure une protection contre les rayonnements UV ; la couche cornée les reflète afin de diminuer la quantité d'exposition, tandis que l'activité des mélanocytes augmente lors de l'exposition afin que l'ADN réduise l'absorption des rayonnements UV la synthèse de la vitamine D les terminaisons nerveuses situées dans la peau permettent à l’organisme de percevoir des sen- sations les vibrations, la température, la pression ou la douleur 2. Plaies et cicatrisation 2.1. Définition Plaie est un dommage cutané qui se manifeste par une rupture de la continuité des tissus et une violation de la barrière cutanée, ce qui requiert un processus dynamique complexe pour être réparé ou cicatrisé. Elle peut se présenter de manière superficielle, se concentrant uni- quement sur l'épiderme (érosion), une partie du derme ou être profonde, exposant le tissu dermique. Sa progression est influencée par son étendue et sa profondeur, ainsi que par des facteurs locaux ou généraux qui peuvent entraver ou entraver sa guérison plaies aiguë : Suite à une blessure chirurgicale ou traumatique, elle se développe à travers les différentes étapes de cicatrisation, en environ un mois. (Braun, 2024) Plaies chronique : lorsque son délai de cicatrisation est anormalement prolongé, gé- néralement au-delà de 4 à 6 semaines selon son origine (Braun, 2024).
Scene 15 (10m 0s)
Page 15 sur 116 2.2. TYPES DE PLAIES Tableau 1 les types des plaies (Braun, 2024) PLAIE CHIRURGICALE Incision de la peau créée intentionnellement PLAIE ATONE La plaie n'évolue pas, est souvent sèche et recouverte d'un tissu blanchâtre. PLAIE CONTAMINÉE Présence d'organismes microbiens dans la plaie, flore initiale PLAIE COLONISÉE La prolifération bactérienne dans la plaie ne provoque pas nécessairement une réponse immunitaire systémique. PLAIE INFECTÉE L'invasion et la prolifération des micro-organismes entraînent une réponse inflam- matoire locale et/ou systémique, ainsi que des symptômes et des signes cliniques d'infection tels que la fièvre, la chaleur, la rougeur, la douleur et l'œdème. PLAIE SOUS-MINÉE Inclut des fissures plus ou moins ondulées et profondes sous les bords de la plaie. PLAIE CAVITAIRE Comporte une partie creuse PLAIE FISTULEUSE C'est un moyen de communication entre un organe cutané et le corps. PHLYCTÈNE (DÉCOLLEMENT BULLEUX) Une ampoule transparente se forme dans la vésicule grâce à la sérosité sous- épidermique. Lorsqu'il y a une hémorragie, le liquide devient rouge puis noir, ce qui augmente le risque d'infection. 2.3. La cicatrisation Définition La cicatrisation est un mécanisme biologique complexe et en constante évolution qui conduit à la guérison d'une blessure. Elle s'étend selon l'intensité de la blessure, de la contusion ou de l'intoxication Les étapes de la cicatrisation Le processus normal de cicatrisation d'une plaie se déroule en quatre étapes : Phase 1 : La phase vasculaire et inflammatoire.
Scene 16 (10m 59s)
Page 16 sur 116 S’installe rapidement après une blessure. L'objectif principal est de pallier la perte de tissu causée et de mettre fin à l'hémorragie. Cela peut être réalisé par la formation d'un caillot sanguin, principalement de fibrine, qui se forme sur le site affecté. (LAVERDET, 2018) Les cellules inflammatoires (polynucléaires neutrophiles, mastocytes et lymphocytes) et les plaquettes sanguines constituent la majorité de cette matrice temporaire, ce qui entraîne l'apparition d'un érythème chaud et douloureux (KIM MH, 2008) Il y a plusieurs facteurs de croissance sécrétés, tels que le transforming growth factor- β1 (TGFβ1), l'épithélial growth factor, le platelet-derived growth factor et le vascular endothelial growth factor, qui sont essentiels pour recruter les fibroblastes ainsi que les cellules endothéliales et inflammatoires dans le lit placé. Phase 2 : La croissance ou la prolifération : Commence après la phase inflammatoire. Son objectif principal est de substituer la ma- trice provisoire par un tissu de granulation (ou tissu de bourgeonnement d'une plaie) Il est constitué d'une matrice cellulaire néo synthétisée, principalement constituée de col- lagène de type III, de capillaires sanguins et de diverses cellules qui doivent s'activer. Le développement de l'angiogenèse dans ce tissu de granulation est indispensable pour four- nir de l'oxygène et des nutriments aux nombreuses cellules qui y sont présentes. Les mo- nocytes se divisent en macrophages pour faciliter l'élimination des débris et la production de divers facteurs spécifiques. (LA, 1995) Les fibroblastes se transforment en myofibroblastes, qui jouent un rôle crucial dans le processus de cicatrisation, en rapprochant notamment les berges de la blesse en raison de leur aptitude à contracter. On peut réaliser cette contractilité en produisant de l'actine α-musculaire lisse, une forme d'actine spécifique des cellules musculaires lisses vasculaires contractiles. Ces myofibroblastes produiront également une nou- velle MEC qui contribuera à remplacer rapidement le tissu détruit, Le TGF-β1 joue un rôle crucial dans la transformation des fibroblastes en myofibroblastes (DARBY IA, 2014) Les lymphocytes B sont présents et s'activent en plasmocytes, ce qui leur permet de produire des immunoglobulines. Un néo derme se développe progressivement au- dessus du tissu de granulation et commence le processus de réépithé lialisation, Effec- tivement, les souches de kératinocytes se multiplient au niveau des bords de la plaie.
Scene 17 (12m 4s)
Page 17 sur 116 et se déplacent entre le caillot et le tissu granulaire. Par la suite, les kératinocytes se divisent et atteignent leur maturité pour former progressivement un épithélium strati- fié. (EA., 2001) Phase 3 : Épithélialisation : Une fois que les tissus ont été réparés, la plaie se rétracte et se recouvre progressivement d'un nouvel épithélium, ce qui entraîne un processus d'épithélialisation. Les kératinocytes (cellules de la couche basale) se multiplient et commencent à envelopper le tissu de granulation en partant des bords de la plaie. Pour que ces kératinocytes puissent migrer correctement, ils nécessitent un tissu de granula- tion sain, humide et à niveau. Après la création de cette première couche cellulaire, l'épithélium se développe grâce à la division cellulaire et atteint rapidement une plus grande résistance. La blessure est cicatrisée (BARANOSKI S., 2016) Phase 4 : Maturation : Dans le cas d'une plaie suturée, cette phase appelée «matura- tion » débute dès les premiers jours, mais peut également durer plusieurs mois dans le cas de plaies étendues et largement ouvertes. Son caractère se manifeste par une re- modellation du tissu conjonctif et la création d'une guérison. Le tissu granulaire s'éva- nouit pour laisser place à un tissu fibreux conjonctif. La résistance aux forces de trac- tion est augmentée grâce à l'épaisseur des fibres de collagène. Le nombre de cheveux diminue et le flux sanguin diminue également. On voit alors l'eau et les vaisseaux sup- plémentaires disparaître, et la cicatrice se renforce. Cependant, dans tous les cas, les cicatrices sont moins solides et moins élastiques que la peau normale, en partie en rai- son d'un certain manque d'élastine. Cela peut prendre du temps. (AL, 2007) 3. Les plaies chroniques principales 3.1. Les brûlures Les brûlures sont des affections traumatiques qui se manifestent par une destruction partielle ou complète du tissu cutané ou des tissus sous-jacents par un agent thermique, électrique, chimique ou des radiations ionisantes. (LEGRAND M., 2019) La sévérité des blessures cau- sées est influencée par différents facteurs tels que la surface et la profondeur des plaies, leur localisation, l'agent responsable de la combustion et les facteurs de risque liés à la personne, tels que le diabète, l'ischémie et l’immobilisation. Profondeur des brûlures : BRULURES DU PREMIER DEGRE : se manifeste par une rougeur persistante, un éry- thème et témoigne de l'hyper vascularisation du derme. (S., 2012) Seules les couches.
Scene 18 (13m 9s)
Page 18 sur 116 superficielles de l'épiderme sont touchées et la couche basale reste en bon état. Afin de se rétablir, elle nécessite entre 3 et 5 jours (ASSELIN G., 2021) BRULURES DU DEUXIEME DEGRE : En règle générale, elle se distingue par la pré- sence de phlyctènes, dont l'épiderme est totalement détruit ou seulement une partie. Le derme subit également une touche plus ou moins profonde. Quand elles sont su- perficielles, la cicatrisation ne dure que 15 jours, tandis que lorsqu'elles sont plus pro- fondes, elle dure de 15 à 30 jours et entraîne souvent une greffe de peau (RAFFOUL W., 2006) BRULURES DU TROISIEME DEGRE : La destruction totale de l'épiderme et du derme nécessite une greffe de la peau pour le traitement. En général, on évalue le volume des brûlures en utilisant un pourcentage de la surface corporelle brûlée SCB (Total Burn Surface Area, TBSA) (F, DJENANE, 2010) Les types des brûlures LES BRULURES THERMIQUES : se produisent lorsqu'une chaleur extrême est pré- sente, telles que le contact avec du feu, des objets chauds, des liquides bouillants ou des plaques électriques. Les brûlures froides sont aussi connues sous le nom de brû- lures thermiques. (22L'intensité des brûlures varie en fonction du point d'ébullition de l'agent liquide en question et de sa viscosité. Les brûlures causées par les huiles ayant un point d'ébullition supérieur à 300°C sont plus intenses que celles causées par l'eau, avec un point d'ébullition de 100°C (JB., DAVID, 2008) LES BRULURES CHIMIQUES : En général, ce genre de brûlures se produit plus lente- ment qu'un accident impliquant un agent thermique ou électrique. Divers produits chimiques, qu'ils soient acides ou bases, ont la capacité de causer des dommages à la peau de manière plus ou moins rapide et profonde (JB., DAVID, 2008) LES BRULURES ELECTRIQUE : Les brûlures thermiques peuvent être causées par un courant électrique, ce qui peut entraîner des brûlures directes par contact avec le conducteur. En général, les brûlures électriques sont sévères et requièrent une intervention médicale immédiate. (JB., DAVID, 2008) 3.2. Les ulcères de pression L'ulcère se caractérise par une diminution de la substance dermo-épidermique située au tiers distal de la jambe, généralement en région malléolaire et sus-malléolaire, sans tendance à la cicatrisation spon- tanée. Son caractère chronique et son risque de récidive le distinguent. 90 % des ulcères des jambes proviennent de vaisseaux sanguins, qu'ils soient veineux, mixtes ou artériels. D'autres raisons sont moins fréquentes, telles que l'angiodermite nécrotique, les affections hématologiques ou les affections.
Scene 19 (14m 14s)
Page 19 sur 116 de système. Au fil des dernières décennies, on observe une augmentation de la prévalence des ulcères d'origine mixte artérioveineuse, en raison du vieillissement des patients atteints de cette affection (Lamy, C, 2024) 3.3. Les ulcères de jambe On définit l'ulcère de jambe comme une plaie cutanée sous-gonale qui ne se guérit pas depuis plus d'un mois (26) La plupart des ulcères de jambe sont d’origine veineuse (70%) en comparaison avec les ulcères de jambe de type artériels (25%) (Morton LM, 2016) . Les ulcères sont causés par un dys- fonctionnement du réseau artérioveineux et sont courants chez les personnes âgées, surtout chez les femmes. (Battu V, 2012 ) Les ulcères veineux de jambe sont causés par une insuffisance valvulaire des veines, ce qui entraîne une hyperpression veineuse et le développement de varices, ou dans les cas plus sévères par des thromboses veineuses profondes. La surpoids entraîne une inflammation des vais- seaux sanguins, ce qui peut entraîner une insuffisance veineuse qui peut devenir chronique. Par ail- leurs, les ulcères de jambe de type artériels sont associés à une hypoxie cellulaire qui entraîne une nécrose. (Battu V, 2012 ) 4. Facteurs impliqués dans les plaies chroniques Le processus de cicatrisation est complexe et peut prendre du temps dans certaines blessures, en parti- culier les blessures chroniques, ou n'être jamais parfait. La guérison totale des blessures ne repose pas uniquement sur les éléments liés au patient ou à la blessure, mais également sur les compétences et les connaissances des techniciens de santé. L'évaluation des plaies et le traitement à appliquer peuvent être influencés par leur diagnostic. Ainsi, il est primordial d'adopter des stratégies axées sur le patient, c'est-à-dire de repérer leurs besoins et préoccupations, ainsi que les difficultés liées à la guérison. Ce- pendant, il est important de considérer que le taux de cicatrisation peut différer d'un patient à l'autre. (Moffatt C, 2008 ) Les professionnels de santé peuvent identifier s'il existe ou non un risque de chronicité en fonction de la taille d'une plaie, de sa profondeur ou de sa localisation anatomique. Cependant, l'émergence de cellules sénescentes, celles qui ne se reproduisent pas, peut entraîner des dommages à la cicatrisation. Par exemple, les fibroblastes qui se sont sénescents génèrent un stress oxydatif et produisent des cyto- kines pro-inflammatoires ; plus de 15% de ces fibroblastes peuvent entraver le processus de cicatrisa- tion (Henderson E a. , 2006 ) . Les plaies superficielles ne se guérent pas suffisamment rapidement, contrairement aux plaies superficielles. En ce qui concerne les facteurs physiques associés aux patients, il y a des maladies sous-jacentes comme le diabète, l'obésité, la malnutrition, les maladies vasculaires et la mobilité réduite qui ont un impact significatif sur la réussite de la cicatrisation. Ainsi, la capacité à traiter ces maladies est un élé- ment essentiel dans la prise en charge des blessures. (Moffatt C, 2008 ).
Scene 20 (15m 19s)
Page 20 sur 116 Une glycémie contrôlée a un impact positif sur la cicatrisation ou la restauration du flux sanguin afin d'améliorer le traitement des ulcères de jambe. (Marston WA, , 2006 ) En ce qui concerne les facteurs psychosociaux, l'isolement social, le stress, la dépression et surtout les situations qui affectent la fonction immunitaire ont un impact négatif sur le processus de guérison. Au terme d'une étude clinique, Yang et al ont prouvé que le stress et la dépression jouent un rôle crucial dans la régulation des métallo protéinases matricielles et dans l'expression des inhibiteurs tissulaires de ces dernières. (Moffatt C, 2008 ) 4.1. Plaies infectées et biofilms Le corps humain représente un écosystème en constante évolution qui abrite une variété de microorga- nismes appelés « microflore ». Chez l'individu adulte, la flore cutanée est constituée de milliards de bactéries, de champignons et de virus (connus sous le nom de "commensales") qui sont en harmonie avec les défenses immunitaires de l'hôte sans provoquer d'infections. (Scalise A, 2015 )La tempéra- ture, l'humidité et la composition des exsudats sont adaptés pour une éventuelle colonisation et conta- mination microbienne. (Bertesteanu S, 2014 ) Les signes et symptômes des plaies infectées incluent : la chaleur et le gonflement de la zone touchée, une inflammation excessive accompagnée d'une douleur intense et d'exsudats purulents, suivis d'une colonisation critique et de mauvaises odeurs (Swanson T, 2016 ), Effectivement, la relation entre l'hôte et les microorganismes est dynamique et l'infection nécessite un déséquilibre, ainsi que celle du système immunitaire. Quatre expressions sont utilisées pour décrire le degré d'une plaie infectée (Fi- gure 3). Tout d'abord, la contamination désigne la présence de bactéries sans prolifération active, tan- dis que la colonisation désigne la multiplication des bactéries, sans entraîner la réponse de l'hôte. Le mot « colonisation critique» désigne le moment où la prolifération bactérienne dépasse la réaction de l'hôte, tandis que le terme « infecté » désigne la situation où la charge bactérienne est déjà en expan- sion (Scalise A, 2015 ) Figure 3 Evolution de la charge bactérienne dans les plaies infectées (Angel D, 2016).
Scene 21 (16m 25s)
Page 21 sur 116 Il convient de faire une distinction entre les infections à microorganismes planctoniques et celles à biofilm. Le plus souvent, les microorganismes ont été étudiés dans leur état plancto- nique, c'est-à-dire en tant qu'entités libres dans un milieu liquide. Cependant, il a été prouvé que, dans la plupart des situations naturelles et cliniques, les microorganismes évoluent dans des communautés complexes appelées biofilms, qui sont actuellement considérées comme responsables de plus de 80 % des infections microbiennes du corps humain. (Angel D, 2016) Les biofilms sont des organismes poly- ou mono-microbiens complexes qui peuvent se fixer entre eux et aux surfaces naturelles ou synthétiques grâce à la production d'une matrice pro- tectrice constituée de protéines, d'ADN, de lipides, de substances humiques et surtout de sucres, les exo-polysaccharides (EPS). On connaît bien les biofilms dans le domaine médical en raison de leur influence sur la santé, tels que l'endocardite ou l'otite, d'une part, ou en rai- son des problèmes d'infections sur des dispositifs médicaux tels que les sondes urinaires, les implants orthopédiques et mammaires, les lentilles, les dispositifs intra-utérins et les sutures, d'autre part. Le cycle de formation, de maturation et de dispersion d'un biofilm est illustré dans la Figure 4, qui comprend cinq étapes ( Diane ST, 2011) L’adhésion réversible Figure 4 Représentation schématique de la formation d'un biofilm poly microbien (Angel D, 2016).
Scene 22 (17m 20s)
Page 22 sur 116 Dans le milieu, les microorganismes se déplacent librement et commencent à se fixer à la sur- face grâce à des interactions hydrophobes entre les cellules et les bactéries (Safe, 2018), ou grâce aux pilis et aux flagelles des microorganismes. L'adhésion est faible et réversible à cette étape. L’adhésion permanente Les structures telles que les pilis et les flagelles commencent à renforcer et à être irréversibles, ce qui constitue les premiers points fixes du biofilm. La sécrétion de la matrice protectrice composée d'EPS assure l'adhésion microbienne en enveloppant les microorganismes et en les protégeant contre la réponse immunitaire de l'hôte ou des agents antibactériens. (Scalise A, 2015 ) Prolifération microbienne Les microorganismes adhèrent irréversiblement et commencent à se reproduire, sous la super- vision d'un mécanisme appelé quorom-sensing. C'est un moyen de contrôler l'expression gé- nique en fonction de la densité de la population cellulaire. Avec la sécrétion des molécules par quorom-sensing, d'autres microorganismes sont attirés et se rassemblent dans le biofilm afin de créer des micro-colonies. Au cours de cette étape, toutes les bactéries se trouvent au même stade de croissance. En raison de l'absence de nutriments, la prolifération des bactéries est presque nulle, les bactéries se débarrassent de tous les éléments inutiles qui consomment de l'énergie, tels que les flagelles. Étant donné que la majorité des antibiotiques agissent sur la phase de multiplication, leur efficacité diminue considérablement en l'absence de celle-ci. (Angel D, 2016) La maturation L'épaisseur de l'EPS commence à augmenter et le biofilm se transforme en un écosystème aux fonctions structurelles qui relient les colonies. Les méthodes classiques de traitement des plaies sont moins efficaces à cette étape de formation du biofilm. La dispersion Les bactéries commencent à se décomposer grâce à des phénomènes de stress mécanique ou de manque de nutriments, puis s'installent dans de nouvelles régions du lit de la plaie. Les biofilms mettent en place diverses stratégies grâce aux EPS afin de préserver les microorga- nismes contre le système immunitaire, les antimicrobiens et le stress environnemental. 4.2. Diagnostic des plaies infectées Les plaies infectées ont été diagnostiquées principalement à partir de critères cliniques tels que l'éva- luation du patient, des tissus qui entourent la plaie et de la plaie elle-même, afin de repérer les signes et.
Scene 23 (18m 26s)
Page 23 sur 116 les symptômes d'une infection et les facteurs qui pourraient accroître son risque (Moffatt C, 2008 ). Les plaies chroniques ont déjà été mentionnées comme étant plus susceptibles d'être infectées que les plaies aigües. Toutefois, des systèmes de notation et des critères d'identification sont disponibles afin de simplifier le diagnostic d'infection pour les plaies aigües. En revanche, en ce qui concerne les bles- sures chroniques, les systèmes d'évaluation restent en attente. Il est crucial de repérer et de distinguer les symptômes d'une infection locale, diffuse ou généralisée (Angel D, 2016). 4.3. Problème de cicatrisation et traitement de cicatrisation innovants Problèmes de cicatrisation Infection : Les plaies infectées provoquent une inflammation et une dégradation des tissus. (Lanza, 2014) Ischémie : Un apport sanguin insuffisant, souvent observé dans les plaies diabétiques et les ulcères de pression, ralentit la guérison. (Lanza, 2014) Inflammation excessive : Une réponse inflammatoire prolongée empêche la progres- sion vers les phases de prolifération et de remodelage. Cicatrices hypertrophiques et chéloïdes : Production excessive de collagène entraî- nant des cicatrices épaisses et surélevées. Maladies systémiques : Conditions médicales comme le diabète et les troubles im- munitaires qui entravent le processus de cicatrisation. (Guo, 2010) Nutrition insuffisante : Carences en vitamines et minéraux essentiels (ex. : vitamine C, zinc) retardant la cicatrisation 4.4. Traitements innovants : Thérapie par cellules souches : Les cellules souches peuvent se différencier en différents types de cellules nécessaires pour la cicatrisation, améliorant ainsi la régénération des tissus. (Frykberg, 2015) -Exemple : L'utilisation de cellules souches mésenchymateuses pour traiter les ulcères diabé- tiques a montré des résultats prometteurs. Facteurs de croissance : Les applications topiques de facteurs de croissance, comme le PDGF (platelet-derived growth factor), peuvent accélérer la cicatrisation en stimulant la proli- fération cellulaire. (Cullen, 2002) Exemple : Regranex, une pommade contenant du PDGF, est utilisée pour les ulcères diabé- tiques..
Scene 24 (19m 31s)
Page 24 sur 116 Thérapies à base de matrice extracellulaire (MEC) : Les matrices de collagène ou de peau artificielle peuvent servir de support pour la croissance cellulaire et le dépôt de nouveaux tis- sus. (Guo, 2010) Exemple : Apligraf, un produit à base de cellules vivantes, est utilisé pour traiter les ulcères veineux et diabétiques. Thérapies génétiques : Les thérapies visant à modifier l'expression des gènes impliqués dans la cicatrisation peuvent aider à réguler les processus inflammatoires et de régénération. (Frykberg, 2015) Exemple : L'utilisation de vecteurs viraux pour introduire des gènes promoteurs de la cicatri- sation dans les cellules locales. Nanotechnologie : Les nanoparticules peuvent être utilisées pour délivrer des médicaments, des facteurs de croissance, ou des gènes directement aux sites de plaies, augmentant l'efficaci- té du traitement. (Martin, 1997) Exemple : Les nanoparticules d'argent pour leurs propriétés antimicrobiennes et leur capacité à promouvoir la cicatrisation. Thérapie par pression négative : Cette technique utilise une aspiration pour enlever les fluides de la plaie et augmenter le flux sanguin local, ce qui favorise la formation de nouveaux tissus. (Frykberg, 2015) Exemple : Le système de thérapie par pression négative (TPN), comme le V.A.C. Therapy, est largement utilisé dans le traitement des plaies complexes. Bio printing : L'impression 3D de tissus biologiques permet de créer des structures de peau qui peuvent être appliquées sur les plaies pour accélérer la cicatrisation. (Frykberg, 2015) Exemple : L'impression 3D de greffes de peau personnalisées pour les brûlures graves. Pansements bioactifs : Contiennent des composants biologiques comme le collagène ou l'acide hyaluronique pour soutenir la régénération des tissus. (Cullen, 2002) Partie2 : les pansements pour le traitement des plaies 1. Histoire du soin des plaies et du pansement.
Scene 25 (20m 36s)
Page 25 sur 116 En 1962, le Professeur Winter a mis en évidence la base essentielle de la cicatrisation. Il a démontré que maintenir la plaie dans un environnement humide favorisait la migration des cellules et augmentait la vitesse de cicatrisation de manière deux fois plus rapide ( NEVILLE AM, 1994). Devant ce principe, tout pansement a pour but de générer un microclimat humide, tout en étant à la fois perméable aux échanges gazeux, imperméable aux liquides, capable de gérer l'exsudat, confortable et stérile, sans s'adhérer à la plaie. Depuis le postulat de M.Winter1, différentes familles de pansements ont émergé en réponse à ces attentes (INES., 2024). 2. L’intérêt et classification des pansements 2.1. Le panssemnt Le « pansement » est un dispositif médical utilisé pour ” couvrir, protéger, absorber les sécrétions et favoriser la cicatrisation des plaies ”. Selon le Dictionnaire Larousse, le pansement est “ l’action de panser une plaie. C’est le “ Recouvrement d’une plaie au moyen de compresses stériles, fixées par un bandage ou de l’adhésif ”. Dans le but de favoriser sa guérison et par conséquent, la protéger contre une contamination extérieure [3]. 2.2. Intérêt du pansement : Pour que le processus de cicatrisation s'effectue suffisamment rapidement et correctement (en fonction de l'âge de la personne), certaines conditions physico-chimiques indispensables doivent être rassemblées. Ainsi la température, le pH et le taux d'hydratation de la plaie sont autant de facteurs qui influencent la vitesse et la qualité de guérison d'une plaie. En 1962, Winter démontre que la cicatrisation d'une plaie recouverte par un pansement synthétique semi-occlusif est 30% plus rapide par rapport à une plaie conservée à l'air libre [3]. 2.3. Les types de pansements : Suivant la définition de la haute autorité de santé (HAS), les pansements et articles pour pansements, comprennent d'une part les pansements primaires, placés au contact direct.
Scene 26 (21m 41s)
Page 26 sur 116 de la plaie, et d'autre part les pansements secondaires, incluant les compresses et les matériels de fixation et de maintien (bandes, sparadraps). Les pansements primaires présentent des caractéristiques variables suivant leur nature : hydrocolloïdes, hydrocellulaires, hydrogels, hydrofibres, alginates.... Leur utilisation est en fonction de l'état de la plaie (nécrotique, fibrineuse, bourgeonnante ou en voie d'épidermisation) et du niveau d'exsudat. Les caractéristiques idéales de ces pansements comprennent entre autre, le maintien d'un milieu humide en faveur d'un renouvellement cellulaire de qualité (absorption des exsudats en excès et hydratation des plaies trop sèches), la possibilité d'échanges gazeux et la promotion du débridement. Ces pansements doivent également s'adapter aux différents stades de guérison physiologique de la plaie, et surtout respecter son écosystème. Ils créent ainsi le microclimat nécessaire à une cicatrisation optimale. En l'absence de signe infectieux, les pansements primaires peuvent être laissés sur la plaie jusqu'à saturation, la fréquence de réfection peut ainsi varier entre deux, trois et cinq jours. Ils sont utilisés pour les plaies et les brûlures et ont été classées en pansements traditionnels, biologiques et artificiels. [3] A. Pansements traditionnels L'exemple le plus célèbre de cette catégorie est la gaze, qui a été découverte depuis le milieu des années 1970 (Benedetti, 2021). Ces matériaux ont été caractérisés avec leur faible coût, leur facilité d'utilisation et de fabrication. Les pansements composés en gaze ou en gaze de coton possède beaucoup de capacité d'absorption des exsudats de la plaie qui provoque une déshydratation rapide et favorise la croissance bactérienne et la contamination. En outre, à la fin du traitement, le retrait du couvercle est un peu difficile qui provoque des saignements ou des dommages à la flore épithéliale renouvelée..
Scene 27 (22m 46s)
Page 27 sur 116 Ainsi, de nombreuses attentions ont été exercé pour remédier à ces inconvénients en greffant la composite de gaze et de coton avec une surface interne non adhésive fabriqué pour soulager la douleur ou minimiser les dommages à la peau renouvelée lors de l'enlèvement des pansements (MAGALHÃES, 2020). Des composites avancés en gaze de coton ont été récemment développés pour répondre à toutes les exigences des pansements typiques. La gaze de coton était enduite avec des nanocomposites de chitosane-Ag-ZnO (Bolognia, 2018). Le traitement de la membrane de gaze de coton avec chitosan-Ag-ZnO augmente la capacité de gonflement et améliore activité antibactérienne contre Escherichia coli et Staphylococcus aureus. (MAGALHÃES, 2020) B. Pansements biologiques (bioactifs) Les pansements biologiques appelés «auto-greffage» sont considérés comme les matériaux les plus appropriés pour la guérison complète de blessures et brûlures profondes et chroniques. Cette méthode dépend du don de peau normale et fraîche provenant de corps étrangers par exemple : humains, animaux ou cadavres (MONTEIRO-RIVIERE, 1991). De tels matériaux ont une structure de type collagène, y compris l'élastine et les lipides, qui sont biodégradable, biocompatible avec une très faible toxicité. Dans certain cas on leur associe des agents antibactériens ou des facteurs de croissance ( DRÉNO B, 2009). Ces pansements bioactifs auraient un intérêt pour les plaies atones, sans évolution depuis au moins 3 semaines, au stade de bourgeonnement. Cependant leur efficacité est controversée car aucune preuve scientifique ne valide leur efficacité face aux pansements standards. Ces pansements sont également particulièrement onéreux (VENUS M, 2010) - En fonction de leurs matériaux et de leurs propriétés, les pansements actifs appartiennent à différentes classes Pansements artificiels.
Scene 28 (23m 51s)
Page 28 sur 116 Les pansements artificiels sont fabriqués à partir de matériaux synthétiques et Présentent des caractéristiques variables suivant leur nature on trouve : Les films, les mousses, Les hydro colloïdes, les hydrogels, les alginates... Leur utilisation est en fonction de l'état de la plaie et du niveau d'exsudat. En l'absence De signe infectieux, les pansements peuvent être laissés sur la plaie jusqu'à saturation, la Fréquence de réfection peut ainsi varier entre deux, trois et cinq jours (LAVERDET, 2018) Alginates : ces pansements sont composés majoritairement (> 50 %) d’alginates, avec ou sans carboxyméthylcellulose (CMC). Les alginates sont des polymères d’acides alginiques obtenus à partir d’algues ( DIPIETRO LA , 1995), Ils existent sous forme de compresses ou de mèches Pansements qui ont un forte capacité d'absorption des exsudats (environ 15 fois leur poids) Hydro cellulaires : Pansements hydrocellulaires sont composés de trois couches : • interne (couche de transfert non adhérente au contact des exsudats, adhésive sur peau saine, face microperforée en polyuréthane ou silicone) ; • centrale (couche absorbante en non-tissé permettant le transport des exsudats, mousse de polyuréthane, hydrophile) ; • externe (film de polyuréthane). Ils ont un haut pouvoir absorbant, n’adhèrent pas à la plaie, respectent les néobourgeons, ne se délitent pas et maintiennent un milieu humide (DARBY IA L. B., 2014) Figure 5 Pansement hydro cellulaire (BARANOSKI S. A. E., 2016).
Scene 29 (24m 45s)
Page 29 sur 116 •Hydro colloïdes : ce sont des pansements constitués de polymères absorbants, dont les propriétés sont liées à la présence de carboxyméthylcellulose. Ils existent sous forme de plaques adhésives, de poudres ou de pâtes. • Hydrogels : les hydrogels sont des gels contenant plus de 50 % d’eau. Ils sont principalement destinés à assurer l’humidification des plaies. Ils existent sous forme de plaques, de compresses imprégnées et de gels. • Pansements vaselinés : ce sont des pansements constitués d’une trame, imprégnée ou enduite de vaseline. Leur retrait est parfois douloureux, car ils adhèrent peu à peu à la plaie. • Interfaces : les pansements interfaces sont constitués d’une trame enduite de polymèresde différents types, tels que du gel de silicone. Ils se distinguent des simples pansements gras par une adhérence faible, qui ne s’accroît pas tout au long de l’utilisation au contact direct de la plaie (absence de migration de la substance imprégnée ou enduite), afin de limiter le traumatisme et la douleur induits par le retrait du pansement. • Pansements au charbon actif : utilisent différents supports auxquels a été ajouté du charbon actif pour réduire les exsudats modérés et absorber les mauvaises odeursissues des plaies. Ils ont une activité antibactérienne et sont disponibles sous la forme de plaques et de compresses (DARBY IA L. B., 2014) • Pansements à l'argent : ils sont constitués de différents supports (crèmes, compresses, plaques, etc.) auxquels a été ajouté de l’argent sous des formes physico-chimiques variées, théoriquement à visée antibactérienne. • Pansements à base d'acide hyalorunique : ils contiennent de l’acide hyaluronique (constituant naturel du derme) à des concentrations variables. Ils existent sous diverses formes (crèmes, compresses, sprays, etc.) ( DIPIETRO LA , 1995) 2.4. Traitement des infections des plaies chirurgicales.
Scene 30 (25m 51s)
Page 30 sur 116 a) Traitement curatif : le traitement des ISO est surtout basé sur l’antibiothérapie après avoir identifié le germe et réalisé l’antibiogramme. Dans certains cas, le traitement peut être chirur- gical. Il s’agit de supprimer le foyer septique par des moyens physiques (drainage, mise à plat, lâchage des sutures ( DIPIETRO LA , 1995) . b) Traitement préventif : l’antibioprophylaxie a une place considérable dans la prévention des ISO, elle répond à des normes qu’ils convient à respecter. La prévention de l’ISO repose sur des techniques rigoureuses de désinfection de la peau, des mains des opérateurs, le champ opératoire…etc. (Al-Hamdani, 2021). Pour prévenir les infections des plaies opératoires, il faut limiter le plus possible : - La durée de séjour hospitalier préopératoire et proposer les explorations préopératoires en Ambulatoire ; - La préparation cutanée du patient soit une procédure qui comprend (un douche la veille de L’intervention, épilation par tondeuse ou crème dépilatoire de la zone à opérer) ; - Eviter les injections des substances ou médicaments dans le système de drainage et Privilégier les systèmes d’aspiration ; - Dépister les infections au bon moment. 3. Bactéries de la flore cutanée 3.1. Flore commensale La flore cutanée normale est une flore constituée de 102 à 106 bactéries/cm2, variant en fonc- tion de l’humidité, du pH et de la température. Elle est constituée d’une flore résidente com- prenant des staphylocoques à coagulasse négative, des corynebactéries et d’une flore transi- toire : staphylocoques dorés et entérobactéries (Angel D, 2016). Flore résidente Staphylocoques : - Staphylococcus epidermidis (face, narines, creux axillaires, mains) - Staphylococcus haemolyticus (zones humides des bras, des mais, des espèces interdigitaux) - Staphylococcus hominis (creux axillaires, plis inguinaux).