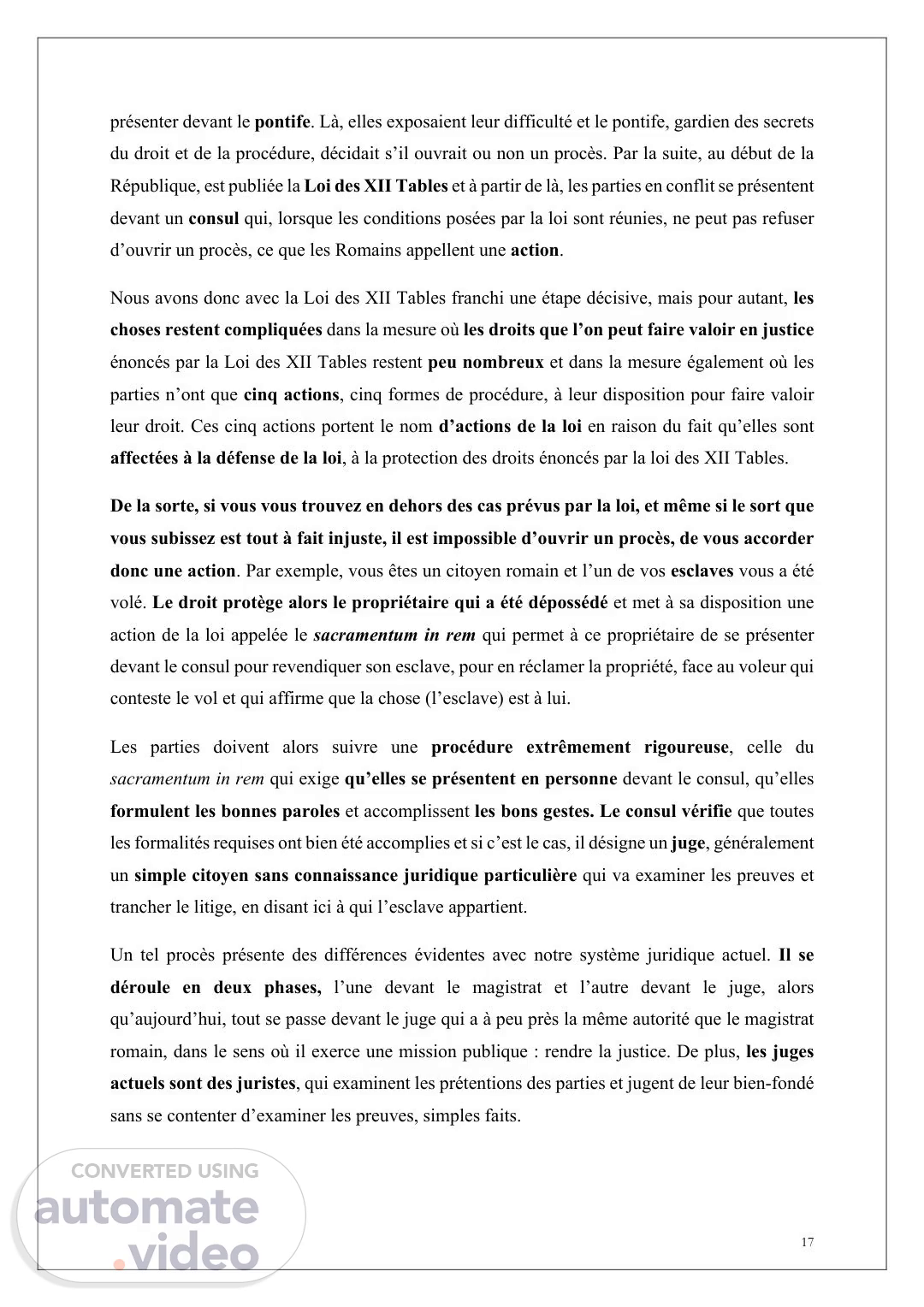
Microsoft Word - Introduction historique au droit _ YS (1).docx part 2
Scene 1 (0s)
17 présenter devant le pontife. Là, elles exposaient leur difficulté et le pontife, gardien des secrets du droit et de la procédure, décidait s’il ouvrait ou non un procès. Par la suite, au début de la République, est publiée la Loi des XII Tables et à partir de là, les parties en conflit se présentent devant un consul qui, lorsque les conditions posées par la loi sont réunies, ne peut pas refuser d’ouvrir un procès, ce que les Romains appellent une action. Nous avons donc avec la Loi des XII Tables franchi une étape décisive, mais pour autant, les choses restent compliquées dans la mesure où les droits que l’on peut faire valoir en justice énoncés par la Loi des XII Tables restent peu nombreux et dans la mesure également où les parties n’ont que cinq actions, cinq formes de procédure, à leur disposition pour faire valoir leur droit. Ces cinq actions portent le nom d’actions de la loi en raison du fait qu’elles sont affectées à la défense de la loi, à la protection des droits énoncés par la loi des XII Tables. De la sorte, si vous vous trouvez en dehors des cas prévus par la loi, et même si le sort que vous subissez est tout à fait injuste, il est impossible d’ouvrir un procès, de vous accorder donc une action. Par exemple, vous êtes un citoyen romain et l’un de vos esclaves vous a été volé. Le droit protège alors le propriétaire qui a été dépossédé et met à sa disposition une action de la loi appelée le sacramentum in rem qui permet à ce propriétaire de se présenter devant le consul pour revendiquer son esclave, pour en réclamer la propriété, face au voleur qui conteste le vol et qui affirme que la chose (l’esclave) est à lui. Les parties doivent alors suivre une procédure extrêmement rigoureuse, celle du sacramentum in rem qui exige qu’elles se présentent en personne devant le consul, qu’elles formulent les bonnes paroles et accomplissent les bons gestes. Le consul vérifie que toutes les formalités requises ont bien été accomplies et si c’est le cas, il désigne un juge, généralement un simple citoyen sans connaissance juridique particulière qui va examiner les preuves et trancher le litige, en disant ici à qui l’esclave appartient. Un tel procès présente des différences évidentes avec notre système juridique actuel. Il se déroule en deux phases, l’une devant le magistrat et l’autre devant le juge, alors qu’aujourd’hui, tout se passe devant le juge qui a à peu près la même autorité que le magistrat romain, dans le sens où il exerce une mission publique : rendre la justice. De plus, les juges actuels sont des juristes, qui examinent les prétentions des parties et jugent de leur bien-fondé sans se contenter d’examiner les preuves, simples faits..
Scene 2 (1m 5s)
18 Ce système des actions de la loi perdure même après l’institution du préteur. C’est alors ce magistrat qui remplace le consul : il écoute les parties, examine si les conditions posées par la loi sont remplies, ouvre le procès lorsque c’est le cas, et contrôle le bon accomplissement de toutes les formalités, avant de désigner le juge. Ce système fonctionne bien au départ car il suffit à régler les problèmes juridiques qui se posent entre les citoyens romains. Quelques droits protégés et cinq actions de la loi suffisent dans l’immense majorité des cas, lorsque la vie juridique romaine est encore peu développée. Cependant, au cours du IIIe siècle, la petite cité romaine des origines qui a déjà considérablement agrandi son territoire, se lance dans une politique de conquête à grande échelle, au-delà de la péninsule italienne et dans le bassin méditerranéen. Les batailles que mène Rome à cette époque sont victorieuses et la République romaine parvient ainsi à accroître considérablement son territoire, ce qui va amener de profonds bouleversements politiques, économiques et même juridiques. Notamment, les étrangers que l’on appelle à Rome des pérégrins, sont de plus en plus nombreux sur le territoire romain et ils font des affaires avec des citoyens romains. Tout cela crée des besoins juridiques nouveaux, des litiges nouveaux, que le vieux droit civil ne permet plus de résoudre. Si Rome veut demeurer riche et puissante, si elle veut continuer de favoriser le commerce et donc la présence d’étrangers sur son territoire, elle doit d’abord faire évoluer la fonction du préteur lui-même, dont l’accès n’est réservé qu’aux seuls citoyens. Pour répondre aux besoins nouveaux. Rome institue en 242 av. notre ère un autre préteur, le préteur pérégrin, compétent pour tous les litiges qui intéressent les étrangers (l’autre préteur, le premier, prend alors le nom de préteur urbain). Rome doit aussi et surtout faire évoluer son droit. C’est ce que fait la République en accordant de nouveaux pouvoirs au préteur, en 150 av. notre ère. A cette date, une nouvelle procédure est créée, remplaçant celle des actions de la loi et que l’on appelle la procédure formulaire. En dehors de ses particularités techniques, elle permet surtout au préteur de s’affranchir des limites du vieux droit civil et de créer du droit en ouvrant des actions dans des cas nouveaux. Chaque fois que des parties se présentent avec un problème nouveau, sans solution jusqu’alors, le préteur est maître d’ouvrir une action, et alors ce problème nouveau qui n’était jusque-là qu’un simple fait ignoré par le droit, devient un nouveau droit protégé parce que dans ce cas, un procès a été accordé..
Scene 3 (2m 10s)
19 C’est donc dans ce système l’action qui crée le droit. C’est parce qu’une action a été accordée, qu’un procès a été ouvert, qu’un nouveau droit, parce qu’il est désormais sanctionné, protégé en justice, peut exister. Il s’agit là d’un processus tout à l’opposé de notre système actuel. Aujourd’hui, au contraire, dans toute l’Europe continentale, le droit préexiste. Il est créé par le législateur. Et le juge qui tranche un litige ne fait qu’interpréter et appliquer ce droit. Le droit vient d’en haut, en quelque sorte et le juge, placé dans la hiérarchie à un niveau inférieur au législateur, se contente de l’appliquer. Au contraire à Rome, dans le système de la procédure formulaire le droit vient d’en bas, en quelque sorte, des problèmes que rencontre la pratique, que rencontrent les parties au quotidien. C’est un système qui ressemble alors par certains traits à celui des pays de Common law, comme l’Angleterre ou les Etats-Unis. Ces pays n’ont pas de code, leur droit n’est pas codifié pour l’essentiel (il y a des exceptions selon les domaines), et il évolue sans cesse en fonction des décisions rendues par les juges. Bien-sûr, les juges des pays de Common law n’ont pas grand-chose de comparable avec le préteur, qui est un homme politique élu, une sorte de ministre de la Justice. Ce sont là les limites de la comparaison, mais malgré tout, dans le processus de création du droit, les deux systèmes sont assez comparables. Quelles sont les particularités techniques de cette procédure formulaire ? Il s’agit d’abord, contrairement à la précédente, d’une procédure écrite. En effet, le préteur rédige une courte formule écrite dans laquelle il reprend les prétentions des parties, leur demande et dans laquelle il donne l’ordre au juge de juger. Il s’agit ensuite d’une procédure beaucoup plus souple, et c’est tout l’intérêt, car le préteur n’est plus tenu par le droit civil et les cinq actions de la loi. Il a la possibilité d’innover, de demander au juge dans sa formule de statuer sur des faits nouveaux, qui une fois l’action ouverte deviennent des droits nouveaux (ce n’est pas le jugement qui compte ici puisqu’il est rendu par un simple citoyen, mais bien l’ouverture de l’action par le préteur, homme doté d’une autorité publique, dans le processus de création du droit). Au commencement, à partir de 150, le préteur va agir avec prudence. D’abord, il va reprendre les anciennes actions de la loi mais dans le cadre de la procédure nouvelle, la procédure formulaire. Ces actions existent et il ne va pas se priver de continuer à les utiliser, et dans la nouvelle procédure, ces anciennes actions de la loi modernisées en.
Scene 4 (3m 15s)
20 quelque sorte vont prendre le nom d’actions civiles parce qu’elles sont fondées sur le vieux droit civil. Mais, aux côtés de ces actions qui restent traditionnelles, si ce n’est dans la procédure, le préteur va aussi ouvrir des procès dans des cas nouveaux, créer des actions nouvelles, que l’on appelle des actions prétoriennes. Ces actions sont plus ou moins nouvelles. L’on peut à titre d’exemple, distinguer deux catégories d’actions prétoriennes : - Certaines s’inspirent des actions de la loi. Par exemple, imaginons qu’un pérégrin se fasse voler son esclave et qu’il veuille en réclamer la propriété en justice. Ce cas était bien prévu par le droit civil, mais un problème se pose ici : la victime du vol n’est pas un citoyen mais un étranger, le droit civil ne lui est donc pas accessible. S’inspirant du droit civil, le préteur a tout de même le pouvoir d’accorder ici une action. Toutes les conditions sont ici remplies pour que le droit civil s’applique, sauf une : la citoyenneté. Le préteur va alors utiliser le procédé de la fiction. Il va demander au juge, dans sa formule, de juger comme si le pérégrin était un citoyen. Nous avons là une action prétorienne que l’on appelle fictice car elle repose sur une fiction. - Mais certaines actions prétoriennes sont totalement nouvelles et n’ont absolument rien à voir avec le droit civil… On les appelle alors les actions in factum, parce qu’elles reposent sur de simples faits, ignorés du droit, qui deviennent toutefois du droit une fois l’action ouverte, nous le savons désormais. Ainsi le préteur reconnaît sans cesse des droits nouveaux grâce à la procédure formulaire. Se pose toutefois un dernier problème : comment les citoyens et les pérégrins peuvent être avertis de ces droits nouveaux que reconnaît le préteur en ouvrant des actions ? Comment garantir la même connaissance du droit qu’avec la publication de la Loi des XII Tables ? Chaque année, à son entrée en charge, le préteur publie un document officiel, source du droit absolument essentielle que l’on appelle l’édit du préteur. Cet édit reprend la liste des actions qui ont été accordées par le préteur précédent (la liste des droits nouveaux qu’il a protégés) et cet édit est complété au fur et à mesure, pendant l’année où le préteur exerce ses fonctions, par la liste des actions nouvelles qu’il accorde à son tour. Le préteur suivant reprendra cette même liste et la complètera à son tour, et ainsi de suite… Ainsi se forme le droit prétorien, la source du droit la plus importante sous la République, avec la jurisprudence même si elle n’en est encore qu’à ses débuts. Nous l’avons dit, le.
Scene 5 (4m 20s)
21 système du droit prétorien et de la procédure formulaire est tout à fait à l’opposé du nôtre. Pourtant, notre vocabulaire a gardé trace de l’importance de ce système. SECTION III : L’EMPIRE Sous l’Empire, il s’agira d’étudier les institutions impériales (§ 1) avant d’aborder les sources du droit à l’époque impériale (§ 2). § 1. LES INSTITUTIONS IMPERIALES Il convient de noter que l’Empire se subdivise en deux périodes : - de 27 av. notre ère à 284 de notre ère, c’est la période du haut-Empire ou encore du principat. L’empereur n’est encore qu’un princeps, que le premier d’entre tous les citoyens. D’ailleurs, théoriquement, la République est maintenue, elle est censée toujours exister, alors que l’Empereur concentre tous les pouvoirs entre ses mains (A). - puis de 284 à 476 pour l’Occident, c’est la période du bas-Empire ou encore du Dominat. L’empereur est désormais le maître et il exerce un pouvoir beaucoup plus centralisé, autoritaire et sans partage (B). A. Le haut-Empire Le Haut-Empire conserve de manière fictive l’apparence de la République, si bien que les institutions républicaines (Sénat, comices, magistrats) sont maintenues. L’Empereur n’apparaît que comme le premier d’entre tous, le princeps. En réalité, en 27 av. notre ère, le Sénat lui a confié des pouvoirs importants : - l’imperium des magistrats, mais sans limite de temps ni limite géographique (l’on appelle cet imperium l’imperium proconsulaire), - la puissance tribunicienne, soit le pouvoir qu’avaient les tribuns de la plèbe d’empêcher l’exécution des décisions des magistrats, en faveur du peuple, pour la défense du peuple, - enfin l’auctoritas, le pouvoir du Sénat qui permet d’augmenter la valeur des actes juridiques et qui s’incarne dans un titre que reçoit l’empereur, le titre d’Auguste..
Scene 6 (5m 25s)
22 Doté de tels pouvoirs, l’empereur vide les institutions républicaines de leur substance : - les magistratures deviennent seulement honorifiques, sans réel pouvoir, - les comices ne sont plus réunis, - seul le Sénat conserve une certaine importance, une certaine influence morale, mais c’est l’empereur qui choisit les sénateurs et qui peut donc compter sur un Sénat particulièrement docile. Dotée d’une telle organisation, beaucoup mieux adaptée à l’immensité du territoire qu’elle domine, Rome connaît une période d’apogée, jusqu’à la fin du IIe siècle avant de connaître rapidement une période de crise à partir du IIIe siècle et pour des raisons multiples : - La pax romana n’a pas eu d’heureuses conséquences car la guerre et la conquête étaient les moteurs de l’économie romaine. Rome entre donc dans une période de grave crise économique dont elle ne se relèvera pas, du moins en Occident, - Même si Hadrien, lorsqu’il décide la pax romana, renforce la protection des frontières de l’Empire, parfois au moyen de fortifications, cela ne suffit pas et Rome doit faire face à des menaces aux quatre coins de l’Empire, voire à des invasions, - Les empereurs ne sont jamais parvenus, depuis les débuts de l’Empire, à régler le problème de leur succession. Bien souvent, ils ont fait le choix d’adopter celui qu’ils considéraient comme le meilleur, le plus apte à leur succéder, mais jamais aucun principe n’a été posé de manière ferme, si bien qu’à la mort d’un empereur, s’ouvre une période d’incertitude, de contestation, qui débouche parfois sur une grave crise politique. Ainsi, au cours du IIIe siècle, après la mort du dernier empereur issu de la dynastie des Sévères, Sévère Alexandre, en 235, s’ouvre la plus grave crise de succession de l’Empire : des empereurs s’auto- proclament un peu partout dans l’Empire et il n’y a plus de pouvoir légitime ni même effectif. Cette situation dure jusqu’à ce qu’un nouvel empereur parvienne à restaurer l’autorité impériale : l’empereur Dioclétien, qui inaugure à partir de 284, une nouvelle période de l’Empire, le Bas-Empire. B. Le bas-Empire Pour restaurer son autorité, l’Empereur ne se présente plus désormais comme le premier d’entre tous mais comme le dominus, le maître. Non seulement son pouvoir devient nettement plus.
Scene 7 (6m 30s)
23 autoritaire, et les institutions sont réorganisées en ce sens, mais surtout il change de nature, devenant sacré, comme si l’empereur était un dieu de son vivant. Toutes les institutions républicaines qui avaient survécu au principat perdent définitivement leur importance, même le Sénat, et l’Empereur préfère désormais s’appuyer sur une administration, sur des fonctionnaires sans autorité propre, sinon celle qu’il leur délègue, choisis par lui, dévoués et librement révocables et qui ne font qu’exécuter ses volontés. Il faut surtout retenir de cette période, outre ces considérations générales, deux faits marquants, que l’on doit à l’empereur Constantin (306-337) : - Constantin est le premier empereur de Rome à se convertir au christianisme et sous son règne, le christianisme devient religion autorisée, religio licita, à partir de 313 (Edit de Milan), puis les progrès du christianisme sont tels qu’il devient même la seule religion autorisée sous l’Empire à partir de 380 (Edit de Thessalonique). - Sous le règne de Constantin, l’Empire amorce également son partage, car en 324, Constantin crée une nouvelle ville, Constantinople, sur les terres de l’ancienne cité grecque de Byzance (aujourd’hui Istanbul). Cette cité deviendra la nouvelle capitale de l’Empire romain d’Orient, le partage entre empire romain d’Orient et d’Occident devenant définitif en 395. Les deux empires connaîtront un destin très différent puisque l’Empire d’Occident cesse d’exister en 476, lorsque le dernier empereur romain est assassiné par un chef barbare ; tandis que l’Empire romain d’Orient perdurera encore 1000 ans, jusqu’en 1453 et son invasion par les Turcs. § 2. LES SOURCES DU DROIT A L’EPOQUE IMPERIALE L’évolution du pouvoir sous l’Empire marque profondément les sources du droit. Les sources anciennes ne disparaissent pas, mais elles perdent de leur importance car, au triomphe de l’absolutisme impérial dans le domaine politique, répond le quasi-monopole législatif de l’Empereur. A. La coutume Si l’Empereur devient la source essentielle du droit, la coutume ne perd toutefois pas toute son importance. On la trouve encore appliquée localement, à titre d’usage ancestral et à la condition qu’elle respecte les principes du droit de la cité romaine, du droit civil, du droit prétorien, du droit issu de la loi, principes qui lui sont supérieurs..
Scene 8 (7m 35s)
24 Surtout, la coutume fait l’objet d’une théorie au Bas-Empire qui sera redécouverte au moyen âge et qui reste à la base de nos réflexions modernes sur l’application d’un droit coutumier. Cette théorie élaborée au Bas-Empire permet d’expliquer la force obligatoire des usages souvent répétés qui forment la coutume. Plusieurs arguments sont avancés : - l’ancienneté de la coutume (vetustas), sans que les auteurs précisent combien de temps, ni combien d’actes étaient nécessaires pour établir cette ancienneté, - le consentement des intéressés, car les actes répétés supposent le consentement de ceux qui les accomplissent, et l’acceptation tacite de ceux qui les laissent faire. Il y a donc à la base de la coutume un consentement général (consensus omnium), - Pour recevoir force obligatoire, la coutume doit être rationnelle, raisonnable. Dotée de telles caractéristiques, la coutume doit recevoir force obligatoire et va parfois devoir se combiner avec d’autres sources du droit, la loi notamment. La coutume est bien acceptée en tant que source du droit quand elle précise un point que la loi avait laissé silencieux, autrement dit, quand elle comble une lacune législative (on dit alors qu’elle est praeter legem). En revanche, la question est plus délicate lorsque la coutume va à l’encontre de la loi (lorsqu’elle est contra legem). Les juristes rappellent alors que la loi est une source du droit supérieure et que la coutume ne peut la vaincre. Car la loi traduit une volonté supérieure, celle de la cité tout entière puis celle de l’Empereur. Elle ne saurait donc être écartée par un simple usage contraire, pratiqué par quelques-uns. La réflexion politique en était là lorsqu’au Bas-Empire, il a été avancé l’idée fondée sur la pensée d’Aristote, reprise par Cicéron et selon laquelle la coutume reposait sur un consentement général (le consentement exprès de ceux qui pratiquent l’usage en question et l’acceptation tacite des autres). Alors, coutume et loi ont en effet le même fondement, la volonté populaire, exprimée formellement par la loi et tacitement par la coutume. Pourquoi dès lors, reconnaître une autorité supérieure à la loi et ne pas admettre que la coutume puisse la vaincre, notamment lorsque la loi est tombée en désuétude, demandent les auteurs ? Nous avons là une idée-clé de la réflexion politique, qui permet d’expliquer le partage entre deux conceptions de la production du droit : entre 1°) le droit « venu d’en haut », produit du.
Scene 9 (8m 40s)
25 législateur, marqué par toute la puissance de l’État, droit qui s’incarne dans la loi, qui s’impose aux citoyens et qui peut se montrer parfois écrasant ; et 2°) le droit « venu d’en bas », des citoyens, de la pratique, un droit moins « lourd », quand l’État se veut régulateur avant tout, et ne tend pas à s’imposer dans tous les aspects que peuvent revêtir les relations sociales. B. La jurisprudence La jurisprudence, qui était apparue à la fin de la République, se développe encore. Elle reste fidèle à sa méthode, préoccupée autant de pratique que de théorie. Les jurisprudents poursuivent en effet leur activité de praticiens (ils donnent des consultations, rédigent des actes comme des contrats, aident les parties, les avocats et les juges pendant les procès) et composent des œuvres doctrinales. Nous savons que ces œuvres ont été nombreuses mais seules les Institutes de Gaius (IIe siècle) nous sont parvenues. C’est par leur travail qu’apparaissent les premières définitions de ce qu’est le droit, définitions teintées de morale (notion d’équité), comme celle que livre Celse, au début du IIe siècle, affirmant que le droit est l’art de ce qui est bon et équitable : « Ius est ars boni et aequi ». Au siècle suivant, Ulpien livre ce qu’il appelle les trois préceptes fondamentaux du droit : vivre en honnête homme (honeste vivere), ne pas causer de tort à son prochain (alterum non laedere) et donner à chacun ce qui lui est dû (suum cuique tribuere), ce dernier précepte correspondant à la mise en œuvre du principe d’équité. C’est aussi par leur travail qu’apparaissent les premières règles d’interprétation du droit. Il est ainsi possible d’interpréter le droit selon sa lettre (selon ses verba) ou selon son esprit (selon l’esprit de la loi, sententia legis). Le juriste peut aussi ne suivre ni l’un ni l’autre et se livrer à une interprétation créatrice, sur le fondement de l’équité le plus souvent, ce qui ne va pas sans danger et peut aller jusqu’à la dénaturation du texte. Nous verrons au cours de l’histoire les juges souvent revendiquer ce pouvoir, et l’État chercher à le leur enlever. Ainsi, dans leurs écrits et leurs consultations, les jurisconsultes ont complété la loi et l’édit du préteur par leurs interprétations, en même temps qu’ils ont posé des règles nouvelles, en cas de silence de la loi ou de l’édit du préteur. Comment de telles solutions émanant de simples particuliers ont-elles pu devenir source du droit ? D’abord parce que les premiers à avoir interprété la « loi » ont été les pontifes, et qu’un grand prestige était attaché à leurs fonctions, prestige dont bénéficient ceux qui par la suite, n’étant.
Scene 10 (9m 46s)
26 plus pontifes, se livrent à la même activité. De plus, les premiers jurisconsultes sont issus de l’aristocratie romaine. Ils ont souvent occupé des magistratures prestigieuses, sont connus et respectés, ce qui ajoute du prestige social à celui lié à leur activité. Pour ajouter à cette autorité naturelle, en quelque sorte, Auguste crée en faveur de quelques auteurs ce que l’on appelle le jus publice respondendi, leur accordant la faculté de donner des consultations en vertu de l’autorité du Prince, ex auctoritate principis. Ses successeurs ont renouvelé la mesure et ainsi, sous le haut-Empire, une trentaine d’auteurs ont obtenu ce privilège, soit à peu près la moitié des jurisconsultes connus de l’époque. Les opinions de ces auteurs n’avaient pas alors la même valeur que le droit impérial, n’avaient pas d’autorité officielle mais elles avaient tout de même une grande autorité de fait, à tel point que les juges s’y conformaient souvent lors des procès. Ce système marque en tout cas le début de la mainmise de l’Empereur sur la jurisprudence. En effet, à partir de là, il y a des juristes officiels dont les opinions s’imposent en vertu de l’autorité, non pas des jurisprudents, mais de l’Empereur. C’est un premier stade vers l’unification des sources du droit au profit de l’Empereur. Malgré tout, la jurisprudence garde pendant toute la période du Haut-Empire une grande influence et une grande force créatrice, surtout du fait du déclin de l’édit du préteur, qui n’évolue plus et qui perd donc son importance, d’autant plus que la procédure est réformée pendant l’Empire, la majorité des procès n’étant plus réglés par le préteur mais par un fonctionnaire délégué de l’Empereur. La seconde étape est marquée par l’intégration des juristes dans les bureaux de l’administration impériale. Celle-ci se fait progressivement mais devient tout à fait certaine dès les débuts du Bas-Empire. La jurisprudence devient alors anonyme, apparaissant comme l’œuvre de l’Empereur (dans la législation impériale) alors qu’elle reste celle des jurisconsultes. Nous n’avons ainsi pas conservé de noms d’auteurs juridiques importants depuis le début du IVe siècle. Dans le même temps, les empereurs continuent de fixer l’autorité de la jurisprudence classique. Le jus publice respondendi est ainsi complété, en 426, par la loi des citations. Elle confirme l’autorité accordée à certains jurisconsultes classiques, mais à seulement cinq (05) d’entre eux : Gaius, Papinien, Paul, Ulpien et Modestin, les seuls dont les œuvres pourront faire autorité devant les tribunaux et même, s’imposer au juge quand la majorité de ces cinq (05) auteurs sont du même avis. La loi des citations substitue donc à la libre appréciation des opinions par le juge un système automatique fondé sur la majorité. Un tel système est.
Scene 11 (10m 51s)
27 évidemment déplorable car la valeur d’une opinion juridique n’est pas fonction du nombre de ceux qui y souscrivent. La solution adoptée constitue alors un aveu de la médiocrité du personnel judiciaire à qui l’on ne pouvait laisser le soin de décider par lui-même de la valeur d’une opinion. La mainmise de l’empereur sur la jurisprudence se confirme encore avec le développement d’une autre source du droit : les constitutions impériales. C. Les constitutions impériales Les constitutions impériales vont progressivement remplacer la loi, dans la mesure où les assemblées populaires qui votaient la loi sous la République ne sont progressivement plus réunies sous l’Empire. Bien sûr, au départ, l’Empereur agit avec prudence et même s’il ne réunit plus les assemblées populaires pour le vote de la loi, il refuse de se placer au-dessus du Sénat, puisque la fiction républicaine est maintenue. Les décisions du Sénat, les sénatus-consultes, ont alors une certaine importance, à ceci près que les sénateurs sont choisis par l’Empereur et qu’il prononce, avant le vote de toute mesure législative, un discours, l’oratio principis, un discours qui oriente à tel point le vote du Sénat que celui-ci ne contrarie jamais les projets de l’Empereur et vote le texte soumis par lui. Peu à peu, au fur et à mesure que grandit l’autorité impériale, les constitutions impériales s’imposent et finissent par remplacer la loi. Il arrive donc parfois que l’on parle de loi pour faire référence à ces constitutions impériales, car même si leur source n’est pas du tout la même (une assemblée populaire contre la volonté unique de l’Empereur), leur autorité devient progressivement tout à fait comparable. Nous devons cette analyse des constitutions impériales au jurisconsulte Ulpien qui, au IIIe siècle, affirme : « Quod principi placuit legis habet vigorem », ce qui plaît au Prince a force de la loi, la volonté du Prince (autrement dit, les constitutions impériales) ont la même force que la loi, formule dont se servira plus tard le roi de France sur les conseils de ses légistes formés au droit romain, afin d’imposer son autorité et son pouvoir législatif. Les constitutions impériales deviennent ainsi peu à peu la source essentielle, voire exclusive du droit. Parmi ces constitutions impériales, l’on distingue selon la portée de la mesure prise par l’Empereur :.
Scene 12 (11m 56s)
28 - les édits, à portée générale, applicables à tout l’Empire, - les décrets, qui s’adressent à quelques citoyens seulement, qui précisent la solution voulue par l’empereur afin de régler une affaire particulière, - les rescrits, qui sont des réponses à des consultations demandées par des particuliers ou des fonctionnaires, en dehors de tout procès, - enfin, les mandats, instructions à caractère administratif. Tous ces textes ne sont pas préparés par l’empereur lui-même mais par l’administration impériale et plus précisément par des juristes fonctionnaires. Au Bas-Empire, ces juristes sont souvent ces jurisconsultes qui animaient une jurisprudence féconde à l’époque précédente, sous le Haut-Empire, et qui sont désormais le plus souvent employés par l’administration. Ainsi, leur nom nous échappe et leurs personnes s’effacent en quelque sorte derrière celle du Dominus. Les constitutions impériales sont rapidement si nombreuses que l’idée fait son chemin de les rassembler dans des recueils. Ce sont les premiers « codes » qui paraissent à Rome. A la fin du IIIe siècle, deux auteurs, Gregorius et Hermogenius, rassemblent ainsi des rescrits impériaux concernant le droit privé (Code Grégorien, vers 291 et Code Hermogénien, censé le compléter, au début du IVe siècle). Le but de ces recueils est alors de mettre à la disposition des juristes des textes importants et de fournir directement le texte applicable, plutôt que son analyse ou son commentaire que l’on trouvait dans les ouvrages des jurisprudents. Là réside leur originalité. Mais ces recueils demeurent privés, établis par des particuliers. La version des textes qu’ils citent ne peut être considérée comme officielle et ces recueils ne confèrent donc pas aux textes qu’ils rapportent une autorité nouvelle. Ainsi, une commission de hauts fonctionnaires est désignée en 435, avec pour mission de rassembler les constitutions impériales, les classer par matières et par ordre chronologique… Surtout, les juristes reçoivent le pouvoir de changer la loi en ce qu’ils peuvent supprimer les développements qui leur paraissent inutiles, mettre fin aux contradictions, modifier ce qui ne leur paraît plus adapté aux besoins de l’époque. Ce travail de modification du droit porte le nom d’interpolation. Les fonctionnaires reçoivent la mission d’interpoler les textes pour les mettre à jour. Achevé en 437, le Code Théodosien est publié en 438, c’est-à-dire qu’il.
Scene 13 (13m 1s)
29 est promulgué par l’Empereur. Il a donc valeur officielle et les dispositions qu’il contient peuvent être alléguées en justice, dans la forme que lui ont donnée les compilateurs. En Orient, ce Code Théodosien va demeurer le code officiel jusqu’à la nouvelle compilation ordonnée par l’Empereur Justinien dont la publication commence en 534. Mais en Occident, il va connaître un destin bien différent car l’Empire romain d’Occident s’effondre en 476, soit quelques années après la publication du Code Théodosien et ce, bien avant la compilation de Justinien. Ainsi, ce Code Théodosien va en Occident survivre à l’Empire et dans les royaumes barbares qui lui succèdent, il demeure la source essentielle de la connaissance du droit romain. D. Les compilations de Justinien A l’avènement de l’empereur Justinien en 527 (il règnera jusqu’en 565), la codification réalisée au Ve siècle se révèle déjà incomplète. De nouvelles constitutions impériales ont été adoptées et surtout, il paraît nécessaire de mieux recueillir la doctrine de l’époque classique, dont on a vu qu’elle avait progressivement été oubliée, pour ne retenir à peine que quelques noms… Une œuvre importante restait donc nécessaire qui fasse à la fois appel à la science des juristes et à l’autorité de l’Empereur. La compilation justinienne répond à cette double exigence. La compilation justinienne marque d’abord le souci de la restauration de l’autorité impériale et de la splendeur passée de l’Empire, souci global, poursuivi tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. - A l’extérieur, tentant de restaurer l’unité impériale de l’âge d’or de l’Empire romain, Justinien s’attache en effet à faire la reconquête de certaines terres d’Occident contre les tribus barbares qui ont succédé à l’Empire romain. - Le même souci inspire l’œuvre intérieure de l’Empereur qui réorganise le gouvernement de l’Empire, l’administration des provinces et redéfinit les relations avec l’Église catholique. C’est dans cet ensemble qu’il faut situer le travail juridique considérable effectué sous son impulsion, travail destiné à assurer la pérennité du droit romain et à restaurer son prestige. Justinien choisit pour mener à bien cette entreprise un professeur de l’École de droit de Constantinople, Tribonien, devenu haut-fonctionnaire, lequel s’entoure de juristes, professeurs,.
Scene 14 (14m 6s)
30 avocats, hauts-fonctionnaires, avec qui il mène à bien à partir de 528, un énorme travail de compilation. L’Empereur fait d’abord rassembler les constitutions impériales dans un Code (1), puis il fait réunir ce qui, dans la jurisprudence classique, peut donner matière à un grand traité de droit privé et de droit pénal, ce qui aboutira au Digeste (2). Un manuel destiné aux étudiants, les Institutes, complète le travail (3). Mais après la publication du Code, Justinien promulgue encore de nombreuses constitutions, dont les plus importantes prennent place dans un dernier recueil, les Novelles (4). Ces quatre recueils forment l’ensemble des compilations de Justinien, désignées depuis le moyen âge sous le nom de Corpus juris civilis. 1. Le Code Depuis la dernière œuvre du même genre, le Code Théodosien de 438, de nombreuses constitutions impériales importantes ont été prises. Ce qui justifie la reprise du travail déjà accompli. La commission présidée par Tribonien commence à travailler en 528 et travaille vite car elle bénéficie des codes antérieurs, Grégorien, Hermogénien et Théodosien, dont elle s’inspire pour sélectionner les textes anciens et ne retenir que les plus importants, tout en les modifiant, en les interpolant pour les mettre en harmonie avec le droit du VIe siècle. Il a fallu aussi ajouter les constitutions importantes depuis le Code théodosien. Le Code est publié une première fois en 529, puis réédité en 534 (ajout de nouvelles constitutions). Il est divisé par matières, les constitutions étant présentées par ordre chronologique. Il s’agit d’un recueil officiel, qui fait foi devant les tribunaux. 2. Le Digeste Le Digeste, connu également sous son nom grec de Pandectes, est une compilation d’extraits de jurisconsultes classiques. C’est une œuvre plus considérable que le Code et qui a demandé un immense travail pour les raisons suivantes : - Il n’existait aucune œuvre antérieure du même genre dont on pouvait s’inspirer. - De plus, la masse de la jurisprudence est énorme, s’échelonnant du IIe s. av. notre ère au IIIe s. ap., et les œuvres étaient difficiles à connaître..
Scene 15 (15m 11s)
31 - Tant d’œuvres d’époques, d’auteurs, de genres si différents contenaient des points de vue divergents, des contradictions, des solutions vieilles et dépassées. Ainsi, le 15 décembre 530, par la constitution Deo auctore, Justinien charge Tribonien et ses collaborateurs de la préparation du Digeste. La constitution précise le but à atteindre et les moyens à employer. Ainsi : - La commission doit rassembler l’immense masse de la jurisprudence classique, 1400 ans de droit romain, dit Justinien, soit quelques 1500 recueils d’une quarantaine d’auteurs différents. - Les commissaires doivent aussi faire cesser les contradictions, corriger les textes, éliminer les solutions désuètes, en pratiquant des interpolations. - Les commissaires doivent aussi grouper les textes par matières, lesquelles seront subdivisées en livres. - Il est enfin précisé que l’œuvre aura autorité de loi impériale. Elle est publiée en 533 par la constitution Tanta. Malgré tout, le Digeste n’a pas immédiatement connu un grand succès auprès des praticiens, apparaissant plutôt comme un livre d’école. Il en ira différemment au moyen âge. 3. Les Institutes Si le Digeste constitue une œuvre d’ensemble, les Institutes sont un bref manuel d’enseignement que rendaient nécessaires la compilation du Code et du Digeste. Ce manuel est préparé en même temps que le Digeste par Tribonien, assisté de deux autres juristes, tous deux professeurs de droit (Dorothée et Théophile). L’ouvrage emprunte beaucoup aux Institutes de Gaius pour le plan notamment, mais pour le contenu, il résume le Digeste, sous la surveillance de Tribonien. Il s’agit là d’une œuvre écrite par des professeurs et faite pour l’enseignement. Les Institutes sont donc plus simples que le Digeste et plus théoriques que le Code. Les notions générales, les définitions, les classifications sont nombreuses, et les controverses doctrinales ne sont pas oubliées car les Romains les considéraient comme excellentes pour la formation de l’esprit juridique..
Scene 16 (16m 16s)
32 Le recueil est publié en novembre 533, un mois avant le Digeste et entre en vigueur comme manuel d’enseignement en même temps que lui, en décembre 533. Beaucoup plus simple que le Digeste, il connaît un grand succès. 4. Les Novelles La seconde édition du Code en 534 n’arrête pas l’activité législative de Justinien, et de nombreuses constitutions, dont certaines sont importantes, sont promulguées entre 535 et 565. Ces constitutions nouvelles sont désignées sous le nom de Novelles et sont finalement publiées sous ce nom. Nous ne retrouvons pas le même plan méthodique, par matières, que dans les autres recueils ; les constitutions étant simplement présentées dans l’ordre chronologique. ⇒ Conclusion sur la compilation de Justinien Ainsi, la compilation justinienne apparaît comme une œuvre de synthèse et de fixation du droit : - Œuvre de synthèse car le Code, le Digeste et les Institutes réunissent en effet tout ce qui était important dans la jurisprudence classique, et ajoutent l’apport du droit post-classique et des réformes prises par Justinien. Malgré tout, la tradition classique occupe la majeure part de la compilation, comme si Justinien avait souhaité restaurer cet âge d’or du droit romain, ce qui traduit surtout l’admiration pour ce droit, pour ce niveau atteint par la science juridique, jamais égalé par la suite, - Œuvre de fixation du droit car les textes recueillis ont valeur officielle, ne peuvent plus être contestés, sont figés dans une forme authentique et certaine. Nous avons là l’expression d’un système juridique très évolué, avec une compilation contenant un droit dépourvu de son formalisme le plus archaïque, à la fois simple et d’une technique très sophistiquée. Ses qualités expliquent qu’à partir de sa « découverte » au XIIe siècle, il soit devenu la base des droits occidentaux et qu’à la suite de la colonisation, il soit devenu également celle des droits africains des pays anciennement colonisés par la France. La compilation revêt ainsi une immense importance pour toute l’histoire des droits européens jusqu’à nos jours et, du fait de la domination coloniale, de l’histoire des droits en Afrique francophone..