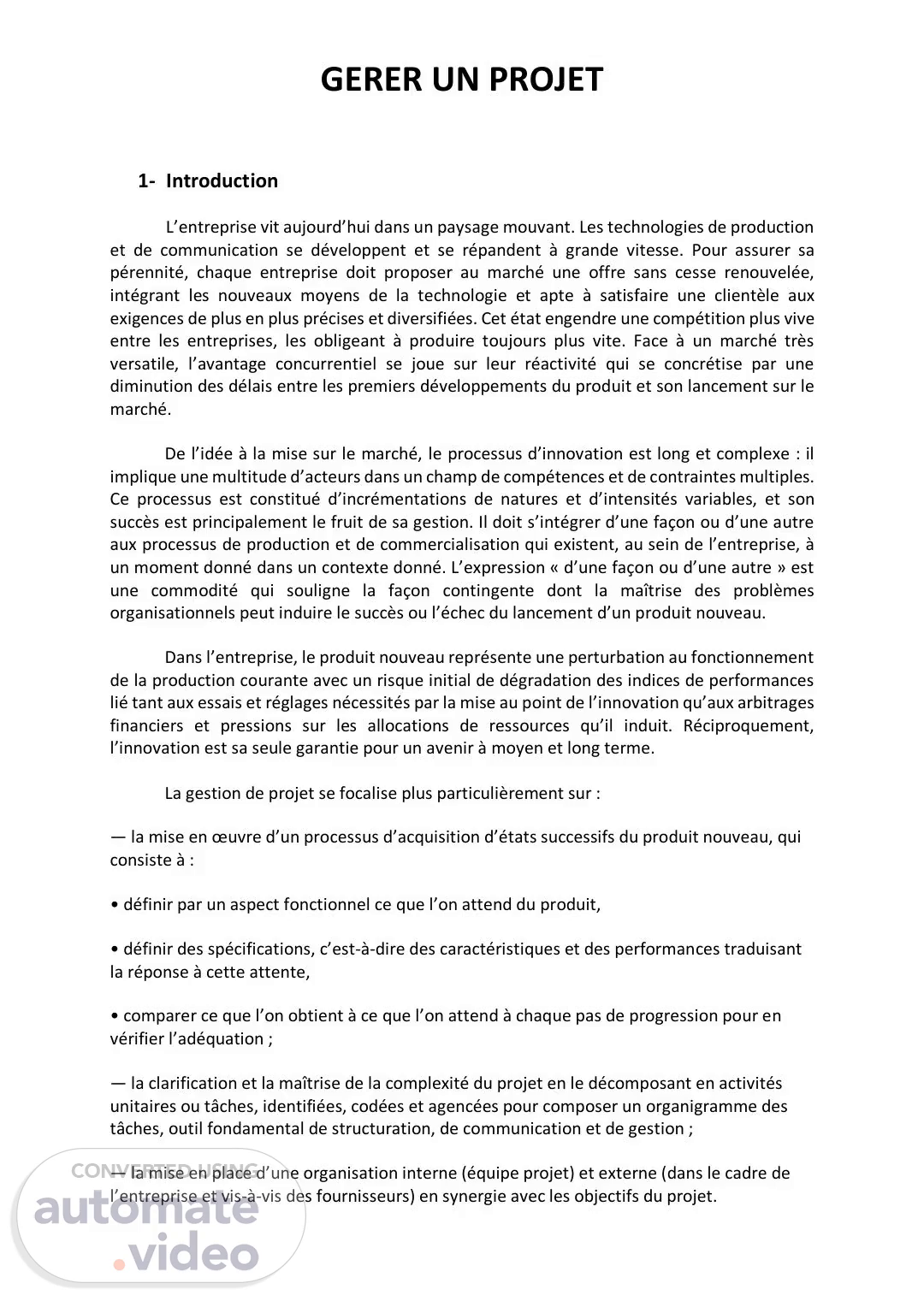Scene 1 (0s)
[Audio] GERER UN PROJET 1- Introduction L'entreprise vit aujourd'hui dans un paysage mouvant. Les technologies de production et de communication se développent et se répandent à grande vitesse. Pour assurer sa pérennité, chaque entreprise doit proposer au marché une offre sans cesse renouvelée, intégrant les nouveaux moyens de la technologie et apte à satisfaire une clientèle aux exigences de plus en plus précises et diversifiées. Cet état engendre une compétition plus vive entre les entreprises, les obligeant à produire toujours plus vite. Face à un marché très versatile, l'avantage concurrentiel se joue sur leur réactivité qui se concrétise par une diminution des délais entre les premiers développements du produit et son lancement sur le marché. De l'idée à la mise sur le marché, le processus d'innovation est long et complexe : il implique une multitude d'acteurs dans un champ de compétences et de contraintes multiples. Ce processus est constitué d'incrémentations de natures et d'intensités variables, et son succès est principalement le fruit de sa gestion. Il doit s'intégrer d'une façon ou d'une autre aux processus de production et de commercialisation qui existent, au sein de l'entreprise, à un moment donné dans un contexte donné. L'expression « d'une façon ou d'une autre » est une commodité qui souligne la façon contingente dont la maîtrise des problèmes organisationnels peut induire le succès ou l'échec du lancement d'un produit nouveau. Dans l'entreprise, le produit nouveau représente une perturbation au fonctionnement de la production courante avec un risque initial de dégradation des indices de performances lié tant aux essais et réglages nécessités par la mise au point de l'innovation qu'aux arbitrages financiers et pressions sur les allocations de ressources qu'il induit. Réciproquement, l'innovation est sa seule garantie pour un avenir à moyen et long terme. La gestion de projet se focalise plus particulièrement sur : — la mise en œuvre d'un processus d'acquisition d'états successifs du produit nouveau, qui consiste à : définir par un aspect fonctionnel ce que l'on attend du produit, définir des spécifications, c'est-à-dire des caractéristiques et des performances traduisant la réponse à cette attente, comparer ce que l'on obtient à ce que l'on attend à chaque pas de progression pour en vérifier l'adéquation ; — la clarification et la maîtrise de la complexité du projet en le décomposant en activités unitaires ou tâches, identifiées, codées et agencées pour composer un organigramme des tâches, outil fondamental de structuration, de communication et de gestion ; — la mise en place d'une organisation interne (équipe projet) et externe (dans le cadre de l'entreprise et vis-à-vis des fournisseurs) en synergie avec les objectifs du projet..
Scene 2 (2m 45s)
[Audio] 2- Contexte de l'étude# ! La première partie de l'outil étude d'opportunité concerne le contexte. Elle définit l'origine de la demande ainsi que les limites du besoin. A. Objet de la demande/du besoin Il faut définir l'origine du besoin en établissant le « pourquoi » et en restant clair, concis mais néanmoins complet. Exemple : Construction d'une annexe au bâtiment de stockage suite à l'augmentation de la capacité de production. B. Périmètre# Qu'est-ce qui est concerné par ce projet ? Imaginons l'existence de plusieurs usines, il faudra préciser de laquelle il s'agit. De même, il peut y avoir plusieurs entrepôts de stockage, produits finis, matières premières, etc. En d'autres termes, vous indiquerez à quoi est destiné le projet et quel est son impact sur l'existant. Exemple : Concerne l'usine C3 de Strasbourg. Bâtiment de stockage de produits finis (PF). Modification de la route d'accès aux camions. C. Volumétrie! On donne ici l'étendue ou l'état chiffré avant le projet (quantités, dimensions…). Il ne s'agit que des installations actuelles et non du projet futur. Exemple : Le stockage actuel est de 1 420 m2 avec une capacité de stockage de six jours de production moyenne (PF). 3- Description de l'existant# ! La deuxième partie est un état des lieux qui permet une présentation générale de ce qui existe déjà sur le même thème. Il s'agit notamment de l'organisation, des fonctionnalités ainsi que des réalisations techniques actuelles. Enfin, la conclusion mettra en évidence les points forts et les points faibles de l'existant. À éviter : Il est très facile, dans cette section, de parler du projet à venir. Ce n'est pourtant pas son objectif : il ne s'agit que de l'existant, de la situation actuelle. A. Présentation générale des réalisations existantes On apportera des informations sur les installations existantes, en interne ou en externe, et les précédentes réalisations ainsi qu'une justification du choix qui a été fait. Exemple : Le stockage actuel a donné satisfaction tant que la capacité de l'usine n'a pas dépassé 12 t/j. Actuellement, nous produisons 17 t/j et sommes obligés de stocker chez un prestataire externe. 2.
Scene 3 (5m 3s)
[Audio] Afin de réduire le risque de contamination et le coût du stockage chez le prestataire externe, la solution de l'addition d'un stockage supplémentaire a été envisagée. ■ Organisation : Répondez à la question suivante : « Comment sommes-nous organisés aujourd'hui ? » Principe : Le but n'est pas d'expliquer ce qu'apportera le projet en matière d'organisation, mais de préciser l'organisation existante. Bien entendu, elle ne concerne que l'organisation qui sera impactée par le projet. Exemple : Organisation humaine Chef de projet : François BRECHINT. Comptabilité et secrétariat : Nadine DELARUE. Organisation terrain Transport des matières de produits finis situé côté N-E. Route d'accès pompiers longeant la partie est du bâtiment de production actuel sur 50 m. Transport des matières de produits finis en stockage chez le prestataire externe : stockage tampon (2 J maxi) en zone 4 du stockage, puis transport par camion vers Mulhouse-Dornach. Stockage extérieur : vérifications sur produits finis chaque semaine par le labo se déplaçant à Mulhouse ainsi qu'une demi-journée en moyenne pour une personne du service logistique. ■ Fonctionnalités : Ce paragraphe rappellera le ou les objectifs que doit atteindre le projet. Est-ce pour résoudre un problème ? Améliorer les conditions de travail ou la productivité ? Etc. Exemple : Amélioration des conditions de stockage. Parer à l'augmentation de capacité de l'entreprise. Rester aux normes de sécurités et règles de stockage établies par le client. Réduction du risque de contamination produit par le stockage en externe. Réduction des coûts de transport et de stockage. B. Conclusions sur le système existant# Les parties « Points forts » et « Points faibles » présentent en quelques phrases l'argumentaire en faveur et en défaveur du projet. ■ Points forts : Une des questions à se poser dans cette rubrique est la suivante : « Quels sont les points principaux en faveur du projet ? » Exemple : Impact réduit sur l'interférence avec la production grâce à la méthode de construction. Résolution des problèmes de stockage ■ Points faibles : Il en est de même pour les points faibles : « Quels sont les points en défaveur du projet ? » 3.
Scene 4 (7m 18s)
[Audio] Exemple : Coût particulièrement élevé dû au type de construction. Principe : Il faut que le lecteur de l'étude d'opportunité comprenne l'intérêt du projet ainsi que les risques et les limitations. Il est donc nécessaire de connaître le destinataire du document pour qu'il puisse comprendre le ou les objectifs du projet en quelques lignes. Plus nombreux seront les détails et plus il y aura de questions. 4- Présentation des fonctionnalités souhaitées La troisième partie de l'outil est consacrée à la présentation des attentes faisant l'objet de la demande de projet. Y seront évoquées les fonctionnalités de base attendues, celles qui pourraient se présenter de façon optionnelle, ainsi que les contraintes associées. Dans les paragraphes abordant les fonctionnalités, seront précisés les fonctions et objectifs du projet. Les possibilités non obligatoires, nécessitant une concertation avant le lancement des travaux, seront notées dans la partie optionnelle. A. Fonctionnalités de base# Il sera mentionné dans ce paragraphe le principal but à atteindre. Exemple : Stockage de 17 t de PF. B. Fonctionnalités optionnelles# Seront précisés ici les buts secondaires Exemple : Possibilité d'agrandissement des bureaux logistique. C. Choix techniques# On expliquera ici les grandes lignes des choix techniques. Principe : Tout projet est confronté à une multitude de possibilités. Néanmoins, les décisions concernant les choix techniques doivent rapidement être prises. Même si toutes les options n'ont pas encore été arrêtées, une première ébauche donnera la ligne directrice et les éventuelles autres décisions techniques restant encore à prendre. Exemple : Murs extérieurs : structure métallique recouverte de bardage vertical isolé par l'extérieur. Couleur gris clair avec bandeau bleu (idem à l'actuel) extérieur, peau intérieure beige (RAL 1004). Mur coupe-feu entre le bâtiment existant et le nouveau stockage. Le mur dépassera la base du toit d'un mètre pour éviter la propagation des flammes. toit plat avec parapet recouvert d'un panneau sandwich isolant. Puits de lumière. Sol : sol en béton recouvert de peinture époxy. Ouvertures extérieures : trois portes translucides camion avec quais hydrauliques. Ouvertures intérieures : deux ouvertures de 6 m de large, une pour l'entrée et une pour la sortie des chariots élévateurs, chaque ouverture étant munie d'une porte coupe-feu ouverte en permanence. Porte latérale (coupe-feu) pour entrée piétons de chaque côté de chaque ouverture. 4.
Scene 5 (9m 57s)
[Audio] D- Contraintes : Préciser les contraintes revient à se poser les questions suivantes : Quels sont les échéances importantes et les événements à ne pas négliger ? Quels sont les risques financiers, humains, techniques… ? Exemple : Le projet fait état de plusieurs dates clés : Mi-juillet : ouverture de la façade nord du stockage PF actuel pendant quatre jours. Un dépassement de plus de deux semaines reviendrait à prendre des risques en matière d'hygiène et de sécurité. Septembre : la reprise d'activité intervenant généralement au mois d'octobre, le chantier devra se terminer idéalement en septembre. En outre, l'usage de la route d'accès pompiers pour les camions pendant les périodes de pluie ne nous permet pas d'envisager le trafic sur ce tronçon au-delà de septembre. Janvier : afin de respecter les contraintes ci-dessus, une approbation du projet est nécessaire avant le mois de février. 5- ENJEUX La quatrième et dernière partie de l'étude d'opportunité concerne les enjeux. Il s'agit de définir les gains attendus tant sur le plan qualitatif et organisationnel que quantitatif. Une analyse des risques (humains, techniques et financiers) viendra compléter cette quatrième partie avant que ne soit conclue l'étude d'opportunité. A. Gains attendus# Cette rubrique va exposer la plus-value apportée par le projet. Elle n'est pas à négliger. Les gains se chiffrent en euros mais ils peuvent également, le cas échéant, se chiffrer en satisfaction ou en amélioration des conditions de travail. Il est à noter qu'il peut tout autant s'agir de gains négatifs. Par exemple, que penser d'une nouvelle norme de sécurité qui générerait une perte de production ? Ce gain peut se calculer en prenant un projet ayant atteint sa maturité en tant que référence. Enfin, chiffrez vos gains en valeurs annuelles. Exemple : Réduction des coûts de transport estimée : 25 000 € l'année 1 + 8 % par an (à partir de l'année 2) pour l'augmentation de production prévue. Réduction des coûts de stockage : 15 000 € l'année 1 + 8 % par an (à partir de l'année 2) pour l'augmentation de production prévue. Coûts supplémentaires : 12 800 € la première année (année 0) uniquement dus à la gêne occasionnée par les travaux et à la nécessité d'augmenter le stockage chez le prestataire externe pendant 1 mois. Total des gains estimés année 0 : – 2 800 € pour une utilisation dès le mois d'octobre (la réduction des coûts de transport et de stockage ne se calculant que sur les trois derniers mois de l'année). Année 1 : 40 000 € ; Année 2 : 43 200 €… Coût de la construction (estimation) : 300 000 €. Retour sur investissement estimé sur année 1, sans amortissement : 300 000/40 000 = 7,5 ans. 5.
Scene 6 (12m 55s)
[Audio] En pratique : Principe : Les gains engendrent souvent des coûts préliminaires qu'il ne faudra pas oublier. Par exemple, l'arrêt d'une ligne de production pendant plusieurs jours pour procéder à une installation, puis sa montée en charge progressive pendant les deux mois suivants, génèrent une baisse de production initiale qu'il faudra chiffrer. Astuce : Voici un petit conseil qui ne manquera pas de vous être utile. Évitez, dans ce document, de donner trop d'informations quant à vos méthodes de calcul des gains ; préférez archiver ces renseignements ailleurs de manière à pouvoir, le cas échéant, en disposer rapidement. Il sera toujours temps de dévoiler vos calculs à ce moment-là. ■ Aspects qualitatifs Les aspects qualités attendus par le projet ou, au contraire, perdus à cause du projet sont à décrire ici. Cela peut également correspondre aux aspects qualitatifs qui apparaissent au cours de la réalisation. Exemple : Prise en compte du problème d'hygiène lors de la construction et notamment au moment de l'ouverture de la façade nord du stockage PF. Mise en place d'une cloison en bois sous forme de SAS. Sol peinture époxy pour nettoyage facile. Le bâtiment devant être en surpression, aucune voie d'air ne peut être acceptée. En outre, concernant les quais camions, il est prévu des sas d'étanchéité gonflables. Seules les deux sorties de secours seront en relation directe avec l'extérieur. ■ Aspects organisationnels D'un point de vue pratique, vous chercherez à répondre aux questions suivantes : Comment allons-nous nous organiser en tant qu'équipe projet ? Quel sera l'impact du projet sur l'organisation de l'entreprise en général ? Il est possible qu'il faille, par exemple, détourner la circulation ou fermer l'entreprise, ou une partie, pendant quelques jours. Il est fortement conseillé de ne pas négliger cet impact car il peut être déterminant sur l'acceptation du projet ou du choix de la solution. Faire apparaître ici un 6.
Scene 7 (14m 46s)
[Audio] organigramme ou un planning d'une partie des travaux peut s'avérer intéressant si l'organisation est complexe. Exemple : Organisation humaine Chef de projet : François BRECHINT. Comptabilité et secrétariat : Nadine DELARUE. Organisation terrain Ouverture de la façade nord du stockage PF actuel pendant quatre jours. Mise en place de bâches de protection + gardiennage de nuit. Idéalement pendant le mois de juillet, plus faible en activité. Modification de la route d'accès aux camions. Pas d'impact particulier, il sera nécessaire pendant ces travaux (environ trois semaines) d'utiliser la route d'accès pompiers ■ Aspects quantitatifs L'étendue chiffrée du projet dans le contexte global de l'entreprise sera présentée ici. Exemple : Dans le cas de notre bâtiment, nous dirons peut-être : Bâtiment de 850 m2 situé au nord-est du bâtiment de stockage actuel. Le stockage total sera donc de 1 420 m2 + 850 m2 = 2 270 m2. La capacité de stockage sera de neuf jours. B. Analyse des risques# ■ En cas de non-réalisation du projet Risques humains – Si le projet ne se réalise pas, il se pourrait qu'il puisse y avoir un impact sur le personnel (horaires, conditions de travail, augmentation/diminution du personnel…). Exemple : Gestion difficile du stock, risque d'augmentation des heures supplémentaires du personnel le plus qualifié. Risques techniques – Il s'agit des contraintes techniques induites par la non-réalisation du projet. Il se trouve que, dans un certain nombre de cas, ce paragraphe restera sans objet, notamment si le projet n'est pas technique. Exemple : Arrêt des lignes de production, chômage technique, réduction des vitesses de ligne. Risques financiers – Cet aspect peut signifier donner une indication chiffrée en cas de noninvestissement. Néanmoins, à ce stade du projet et suivant la complexité du calcul, il peut sembler difficile d'estimer ce montant, pourtant déterminant pour la réalisation du projet. Astuce : Il est fortement recommandé d'associer les acteurs du contrôle de gestion ou de la comptabilité de votre entreprise pour réaliser ce calcul car l'aspect financier est bien mieux maîtrisé par la direction que par le chargé de projet. Cela vous assurera la validité des chiffres et vous évitera les remarques telles que : D'où tenez-vous ce chiffre ? Avez-vous tenu compte du tableau n°… ? Etc. 7.
Scene 8 (17m 24s)
[Audio] Exemple : Saturation de la production prévue au mois de décembre 2014, mois traditionnellement le plus chargé de l'année : Pic de production au mois de décembre 2013 : pic de 18,55 t/j (source : rapports de production). Augmentation prévue : 8 %/an (source : plan d'investissement sur 5 ans daté du 15/03/13). Pic prévisionnel décembre 2014 : 21,64 t/j.C'est en décembre que les stocks sont traditionnellement les plus hauts. En décembre 2013, ce pic a pu être absorbé par un stockage chez un prestataire externe. Le stockage sera de nouveau à saturation en décembre 2014 avec encore plus 10 % qu'en 2013 à cause de l'augmentation des cadences de production. ■ Risques liés au projet Il existe de fortes chances pour que les risques liés à un projet aient une importance toute particulière pour les utilisateurs. Le service maintenance qui s'imagine devoir résoudre les problèmes qu'il n'aurait jamais eus s'il n'y avait pas eu de projet ou encore le service qualité qui s'inquiète de l'hygiène ou de l'impact qualité du produit. Le service financier ou les ressources humaines peuvent également être concernés par cet aspect. Principe : Prenez en compte l'avis des différents départements avant de finaliser ce document. Risques humains – Les risques peuvent être d'ordre humain : modification des conditions de travail, problèmes liés au recrutement du personnel… Exemple : Recrutement de nouveaux personnels. Risques techniques – Les risques peuvent également être techniques, domaine que vous maîtriserez probablement mieux. Nous noterons que le risque technique peut inclure la défaillance de l'installateur spécialisé. Exemple : Technique bien maîtrisée tant en externe qu'en interne. Sous-dimensionnement du bâtiment de stockage. L'agrandissement prévu permettra d'absorber 40 % de production supplémentaire sans faire appel au stockage externe. Conformément aux capacités futures de production, les lignes de production n'ont pas la capacité de produire plus de 30 % maximum. Seule une nouvelle ligne de production (non prévue au plan d'investissement sur 5 ans) pourra rendre ce stockage insuffisant. Néanmoins, cette nouvelle ligne de production ne pourra se situer dans notre usine actuelle à cause de l'enclavement de la zone industrielle. Risques financiers – Enfin, les risques liés au projet peuvent être financiers. Il peut s'agir du coût lié au projet ou à son impact sur la production. Exemple : Coût de la construction. ■ Alternative(s) au projet Tout projet a son alternative. Dans la liste des solutions possibles, il faudra être le plus exhaustif possible, et ce même si certaines solutions semblent mauvaises au premier abord. 8.
Scene 9 (20m 13s)
[Audio] Exemple : Location d'un nouveau stockage chez un prestataire externe – Nous ne recommandons pas cette solution pour des raisons d'hygiène et de coûts. En outre, il n'y a pas de stockage adéquat à moins de 40 km. Installation de tentes sur le parking camion – Nous ne recommandons pas cette solution pour des raisons d'hygiène. Coût estimé pour 450 m2 : 6 K€ plus perte de places de parking. Autorisation communale nécessaire. Juste à temps : actuellement, 30 % de l'espace de stockage est utilisé à des fins de production, 15 % pour les pièces en attente de contrôle qualité et 10 % pour les rebuts de production. Les 45 % restants sont des attentes de mise en camions pour livraisons groupées, ainsi que des productions tampon pour les commandes urgentes et habituelles du client. Une étude avait permis d'optimiser les temps d'attente entre la production et la livraison, mais aujourd'hui nous n'avons aucune latitude d'action. ■ Conclusion La conclusion vous permet d'appuyer votre propre opinion sur le sujet, tout en restant objectif. N'hésitez pas à reprendre quelques arguments du document. Principe :Il est à noter que certaines personnes commencent par lire la conclusion si bien qu'elle doit encourager l'envie de lire l'ensemble du document. Il est nécessaire que vous fassiez apparaître votre conviction à réaliser ce projet. A contrario, si vous n'êtes pas convaincu, vous devez en faire part dans votre conclusion. Exemple : Ce projet a pour but de résoudre les difficultés actuelles de stockage. Ne pas réaliser ce projet rapidement pourrait mettre l'entreprise dans une situation périlleuse quant à la livraison des clients, l'augmentation de productivité engagée depuis deux ans et, de ce fait, empêcher la réalisation des objectifs budgétaires sur 5 ans. 6- Étude de faisabilité Nous venons de voir, lors de la précédente étude d'opportunité, le projet que vous souhaitiez lancer avait un sens et la direction en charge de tous les projets a donné son accord pour passer à l'étape suivante : l'étude de faisabilité. À ce titre, il convient de rassembler des informations susceptibles de vous aider à mieux délimiter le contour du projet. Ainsi, l'étude de faisabilité est un document de synthèse permettant de qualifier la faisabilité d'un projet et, notamment, d'en apprécier la situation existante d'un point de vue fonctionnel, financier et technique. Cet outil permet de présenter la demande de projet, d'identifier les objectifs recherchés, de faire un bilan, de présenter les solutions envisageables et de faire des propositions. L'objectif est de permettre aux décideurs de pouvoir situer le projet dans l'environnement de l'entreprise et d'en mesurer l'impact lors de la mise en œuvre. En pratique : Astuce : des informations synthétiques et claires seront suffisantes à cette étape du projet. À éviter : Une description détaillée de la solution n'est pas utile ; en effet, des précisions seront apportées ultérieurement au cours du processus projet et, notamment, dans le cahier des charges. L'exemple utilisé pour illustrer cet outil concerne la mise en place d'une évolution applicative relative au système d'information décisionnelle. 9.
Scene 10 (23m 21s)
[Audio] 6.1- Présentation de la demande de la maîtrise d'ouvrage La première partie de l'étude de faisabilité concerne la demande formulée par la maîtrise d'ouvrage. Elle permet de bien définir l'expression des besoins par le rappel de la demande tout en délimitant le projet. A. Rappel de la demande de l'utilisateur Il s'agit de rappeler, succinctement, le besoin que le demandeur a exprimé. Quelques indications comme la date de la demande, le support, le contexte, une référence à un document ou à un autre projet, peuvent apparaître en tant que compléments. Exemple : Au cours d'un entretien le 23 avril 2013, M. DUMONT (responsable de production) signale que la production est souvent arrêtée suite à un manque de pièces. Dans ce cadre, il souhaiterait être informé de la consommation réelle de pièces de manière à pouvoir anticiper les commandes. B. Contour du projet Le contour du projet a pour objectif de préciser le périmètre dans lequel s'inscrit la démarche. Que ce soit une zone d'intervention (usine de production), un périmètre fonctionnel (consommation de produit semi-fini) ou encore l'identification d'une démarche ou procédure (déclenchement des commandes de pièces), il est important de pouvoir cerner le cadre du projet de manière synthétique. Un graphique, un plan ou un synopsis commenté est souvent plus significatif que de longues explications. Exemple : La production a été arrêtée à cinq reprises au cours de la dernière année écoulée. En fixant une quantité minimum en stock basée sur la consommation mensuelle moyenne du produit, il sera possible d'anticiper le réapprovisionnement du produit et, ainsi, d'assurer une continuité de production. Cette démarche doit être appliquée pour tous les articles produits. 10.
Scene 11 (25m 11s)
[Audio] 6.2- Objectifs recherchés Dans cette rubrique, il s'agit d'exposer les objectifs recherchés par le projet. Ceux-ci peuvent être de nature diverse. Les titres des paragraphes ci-après sont cités en tant qu'exemples et devront être adaptés en fonction de la demande présentée. A. Réponse à un besoin La raison d'existence d'un projet est de répondre à un besoin. Si ce dernier est mal exprimé ou non défini, il sera difficile d'atteindre un quelconque objectif. À éviter : Attention aux : « Faites au mieux » ou « Vous avez carte blanche » (sous-entendu « Mais attention si je ne suis pas satisfait »). Fuyez ces projets, car vous n'arriverez jamais à satisfaire la maîtrise d'ouvrage, ou recadrez précisément les objectifs. Exemple : Supprimer les périodes de chômage technique dues à une capacité de stock insuffisante. Amélioration du fonctionnement de la productivité Plus précise dans les objectifs recherchés et spécifique au projet, cette rubrique vient apporter un complément d'information. Exemple : Par la mesure périodique de la consommation de pièces, il sera possible d'anticiper les commandes auprès des fournisseurs et, ainsi, d'assurer une continuité de la production. Cette amélioration permettra de réduire les coûts fixes liés à la non-productivité du site. 6.3- Bilan de l'existant A. Présentation générale du système existant Après avoir défini les objectifs, un état des lieux permet de fixer un point de départ au projet. Historique et environnement du système existant – Dans le cas où le projet viendrait remplacer ou compléter un système existant, il serait opportun de présenter brièvement la chronologie de mise en place du système actuel ainsi que son environnement. Exemple : Système actuel : le magasinier réalise sa commande de pièces après avoir entamé la dernière palette en stock. Raisons amenant à étudier la refonte du système existant – Cette rubrique permet de préciser l'origine de la demande. Exemple : Un audit comptable a mis en évidence des ratios de coûts de structure plus élevés que dans d'autres entreprises du même secteur de production. Une analyse plus précise a permis d'identifier de nombreuses périodes de non-production. 11.
Scene 12 (26m 16s)
[Audio] Démarche d'étude retenue – En quelques mots, il s'agit d'expliquer la démarche d'étude du système existant. Exemple : une visite du site de production avec présentation du circuit des flux entrant et sortant a permis d'identifier les différentes actions relatives au processus de production. B. Analyse et bilan du système existant Analyse et bilan de l'existant sur le plan du métier – Une approche fonctionnelle du système existant se traduira par un état des lieux. Exemple : De nombreuses ruptures d'alimentation de la chaîne de production entraînent des périodes de chômage technique. Le processus de déclenchement des achats nécessite d'être revu. Analyse et bilan de l'existant sur le plan économique – En complément de la rubrique précédente, il s'agit de préciser les coûts financiers de la situation existante. Chiffres, tableaux, graphiques peuvent bien entendu venir appuyer ce bilan. Exemple : Le ratio Nombre de jours de production/Nombre de jours travaillés est de 0,93. Cela se traduit par une augmentation des frais de structure que nous avons estimée à 3,62 %/an des coûts fixes de fonctionnement de l'entreprise. Analyse et bilan de l'existant sur le plan technique – L'analyse sur le plan technique viendra compléter et clore l'état des lieux du système existant. On y précisera notamment les matériels, les locaux, l'architecture et toutes contraintes techniques concernées par le projet. Les avantages et inconvénients peuvent venir illustrer cet aspect. Exemple : L'absence de matériel portable sur le lieu de stockage génère un décalage entre le constat « dernière palette entamée » et la commande réelle qui est liée à la réactivité du magasinier. C. Conclusions sur le système existant Bilan général sur le système existant – Cette rubrique reprend en synthèse les différents points abordés précédemment. Exemple : Lié à une organisation historique, le système actuel montre ses limites. En effet, le mode de fonctionnement actuel est basé sur la réactivité plutôt que l'anticipation. Points positifs et négatifs du système existant – On notera autant les lacunes que les avantages du système existant. Un inventaire exhaustif n'est pas nécessaire, seuls les plus significatifs dans le contexte du projet seront à mentionner. Exemple : Au titre des points positifs, nous pouvons signaler un mode de fonctionnement éprouvé qui a satisfait aux besoins jusqu'à aujourd'hui. Les points négatifs concernent : – les délais des fournisseurs qui ne sont pas pris en compte ; – la réactivité relative au magasinier ; – la démarche réactive. 12.
Scene 13 (28m 56s)
[Audio] Orientations pour le futur système – Après le bilan de l'existant, il peut paraître opportun de dresser les premières lignes directrices de la future solution. Exemple : Une solution basée sur l'anticipation des besoins de stock permettra d'éviter des ruptures d'alimentation de la chaîne de production. 6.4- Présentation des solutions étudiées Une description des solutions réalistes et envisageables dans le contexte de l'entreprise viendra compléter ce dossier. Vous y aborderez les principes de base, la mise en œuvre, l'aspect financier, les risques, les enjeux, pour terminer sur une conclusion, et ce pour chaque solution exposée. A. Présentation de la solution n°1 Exposé des principes de base de la solution – Cette première partie apporte une réponse quant à l'adéquation de la solution avec la stratégie de l'entreprise. Ensuite, et toujours selon le contexte du projet, les plans conceptuels, organisationnels et techniques viendront illustrer les principes de base de la solution. Exemple : La mise en place de tableaux de bord de consommation des produits permettra d'anticiper les ruptures de stock et, ainsi, d'éviter les périodes de chômage technique. Informé par des alertes, le magasinier pourra réaliser les commandes de produits en tenant compte des délais des fournisseurs, de manière à assurer une continuité de la production. Principes de mise en œuvre de la solution – L'analyse pratique se déclinera par un plan de développement, un plan de mise en œuvre et/ou encore un plan de migration si le contexte du projet s'y prête. Exemple : Réalisés à partir des données du système d'information de production, les tableaux de bord s'appuieront sur des indicateurs définis par le responsable de production et le magasinier. Une première maquette ciblant les produits de grande consommation et dépendant de délais fournisseurs supérieurs à 2 jours sera présentée aux utilisateurs. Cette présentation aura lieu début septembre pour avis avant généralisation à tous les produits. Étude de la rentabilité économique de la solution – Cette étude financière mettra en évidence les coûts de mise en œuvre et les coûts de maintenance. Un paragraphe complémentaire donnera une estimation prévisionnelle de la durée de vie du système mis en place et un éventuel calcul du retour sur investissement susceptible d'être généré à cette occasion. Exemple : Un premier chiffrage approximatif, obtenu à partir de prestations similaires obtenues auprès de divers fournisseurs, fait apparaître un coût forfaitaire de 45 000 €. La maintenance annuelle correspondante s'élève à 17 % du montant initial soit 7 650 € par an.La durée de vie du système est directement liée à la durée de vie de l'application de gestion des stocks. Dans la mesure où cette dernière vient d'être changée récemment, la pérennité est au moins assurée pour une durée de 5 ans. Le montant annuel de la non-production est de 72 352 €. En conséquence, le 13.
Scene 14 (31m 52s)
[Audio] retour sur investissement sera réalisé dès la première année de mise en place. Évaluation des risques et des enjeux de la solution – Tout projet présentant des enjeux et des risques, vous aurez l'occasion de les exposer dans cette rubrique. Parallèlement, une sensibilisation aux facteurs de succès peut également être citée. Exemple : La prestation étant réalisée forfaitairement, les risques sont quasi inexistants. Néanmoins, la contribution du magasinier lors de la définition des seuils critiques est l'un des facteurs de succès de la solution mise en place. Conclusion sur la solution proposée – Une fois exposés les principes de base de la solution, la démarche mise en œuvre, l'évaluation financière et les risques et enjeux, un avis très synthétique viendra clore la présentation . Exemple : Cette solution, simple à mettre en œuvre, présente l'avantage de pouvoir se faire dans une enveloppe budgétaire forfaitaire donc maîtrisée. Le fait que la société de service proposant cette offre soit déjà intervenue au sein de notre entreprise nous donne une garantie supplémentaire de sérieux quant aux prestations à réaliser. B. Présentation de la solution n°2 La présentation de la deuxième solution se fera selon la même structure documentaire que la première solution. C. Présentation de la solution n°3 Au besoin, une troisième solution peut venir enrichir les solutions précédemment décrites. 14.
Scene 15 (33m 19s)
[Audio] 6.5- Conclusions et propositions A. Tableaux comparatifs de synthèse des solutions proposées Un tableau de synthèse peut récapituler les différentes solutions. On y retrouvera alors toutes les informations clés permettant une prise de décision rapide. En fin de tableau, une note interne (le cas échéant) attribuée à un fournisseur peut venir moduler, pondérer, compléter chaque solution. B. Conclusions et recommandation de choix Quelques commentaires peuvent venir compléter le tableau précédent. Exemple : Lors de la préétude des solutions proposées par les sociétés du marché, il est apparu que l'offre présentée par la société PRESTAService était susceptible de répondre à nos besoins. C. Facteurs indispensables au succès du projet Enfin, un rappel du ou des facteurs de succès du projet sera repris dans ce bilan. Exemple : La bonne connaissance de la consommation quotidienne des produits de notre magasinier sera un élément déterminant dans la durée de mise en place de la solution. 15.
Scene 16 (34m 22s)
[Audio] Annexes : A. Demande formulée par la maîtrise d'ouvrage Document sur lequel la maîtrise d'ouvrage a inscrit sa requête ayant déclenché la phase d'étude de faisabilité. Exemple : Extrait du courrier adressé à M. Sylvain DUMONT, responsable de production, envoyé le 15 mars 2013. Monsieur, Aujourd'hui, les périodes de chômage technique représentent un montant de plus de 72 000 € annuels, nous vous demandons de trouver une solution permettant de réduire ces coûts. B. Planification générale du projet Basée sur la solution préconisée, cette rubrique viendra présenter un planning macroscopique prévisionnel faisant apparaître les délais et charges associés au projet 16.
Scene 17 (35m 6s)
[Audio] ! 17. 17 !.
Scene 18 (35m 11s)
[Audio] ! 18. 18 !.
Scene 19 (35m 17s)
[Audio] GESTION DE PROJET – MANAGEMENT DU PROJET 1- Éléments du management Abordé sous l'angle de son management, un projet revient à prendre en considération trois éléments : — un objectif, qui peut se décliner en termes de qualité, de coûts et d'échéances ; — des moyens, correspondant à des ressources (des hommes, des techniques, de l'information, ... de l'argent) et leur organisation propre dans le cadre du projet ; — des conditions ou des contraintes, qui limitent en général le champ de ce qu'il est possible de faire. De la façon dont seront pris en compte ces différents éléments et dont seront gérées leurs interactions, résultera la qualité du management de projet. La nature occasionnelle du projet nécessite la mise en place d'une organisation spécifique, temporaire, en général distincte de la struc- ture de l'entreprise, spécialement créée et adaptée pour le projet. Avant un début et une fin déterminés, la gestion de projet se distingue de la gestion par flux et en-cours qui caractérise la compta- bilité analytique propre à la gestion de production. Ainsi existe-t-il un antagonisme apparent entre le management de projet, qui impose une organisation et des modes de gestion décisionnels (gestion innovatrice, groupes d'intervention tournés vers l'avenir) et la gestion de production qui s'appuie sur une gestion opérationnelle (gestion bureaucratique en environnement connu et stable, focalisation sur la performance quotidienne). Ces deux types d'activité sont aussi fondamentaux l'un que l'autre pour la pérennité de l'entreprise. La grande difficulté des entreprises est de savoir concilier organisationnellement et même culturellement ces deux modes de fonctionnement et leurs méthodes de gestion associées. La finalité générique d'un projet étant la satisfaction d'un besoin, le management de projet doit avoir comme préoccupation fondamentale : 19.
Scene 20 (37m 8s)
[Audio] — une anticipation des événements, ce qui implique d'être essentiellement prévisionnel plutôt que d'effectuer un contrôle tardif a posteriori ; — une flexibilité, dans les premières phases du projet, tant dans les choix techniques que dans l'organisation, pour pouvoir prendre en compte sans difficultés les éventuelles modifications; — une vision systémique pour apporter des solutions qui intègrent non seulement le coût mais aussi les délais de réalisation, la performance technique et la disponibilité des ressources. Un projet est complexe et nécessite des arbitrages nombreux. Ceux-ci ne peuvent s'effectuer sans la mise en place d'une structure de pilotage possédant à sa tête un généraliste expérimenté ayant reçu délégation d'autorité suffisante pour prendre les décisions nécessaires à l'avancement du projet. 2- Direction du projet Pour la conduite efficace d'un projet, il convient de mettre en place pendant et pour la durée du projet, une organisation spécifique, appelée généralement structure ou équipe projet (figure 2), intégrant les différents acteurs intervenant tout au long du cycle de vie du projet. Cette organisation « non permanente » diffère selon les entreprises ; il convient cependant que cette organisation ne se limite pas à la planification technique et économique mais permette la prise en compte de l'ensemble des éléments, des métiers et des acteurs qui interviennent tout au long de la vie du produit. Dans la limite de ses attributions fixées au début du projet par la direction générale et/ou le maître d'ouvrage, le chef de projet a pour mission essentielle : — de fixer les objectifs, les orientations stratégiques, les moyens, l'organisation et le programme d'actions ; — de coordonner les actions successives et/ou concomitantes ; — de maîtriser et d'adapter en fonction des impératifs, dans tous les domaines, la stratégie, les ressources et l'organisation ; 20.
Scene 21 (39m 1s)
[Audio] — d'optimiser les allocations de ressources dans le cadre d'une vision globale du projet. Plus le projet est important et complexe, plus le nombre d'intervenants augmente et le rôle du chef de projet s'éloigne du seul domaine technique pour venir privilégier les relations humaines. L'animation et la communication deviennent alors ses deux missions clés. 3- Organisation du projet Dans l'organisation d'un projet, on trouve différentes fonctions qui, selon la taille du projet, peuvent impliquer plusieurs personnes à temps plein pour chacune d'elles ou au contraire mobiliser quelques heures d'une seule personne. L'ensemble des personnes en charge de ces fonctions est dirigé et coordonné par le chef de projet. Les membres de l'équipe projet n'appartiennent plus, à partir du moment où ils sont désignés pour prendre part au projet, à leur structure habituelle hiérarchique dite permanente par opposition à la structure non permanente du projet. Il existe schématiquement trois types de structures non permanentes. a) Dans un premier cas de figure, la structure non permanente se fond dans le fonctionnement courant de l'entreprise : les spécialistes intervenant sur le projet restent hiérarchiquement rattachés à leur responsable de spécialité. Le chef de projet transmet alors ses consignes par leur intermédiaire ; son autorité est réduite et la coordination est difficile puisque le responsable de spécialité impose en général ses priorités tant au niveau des projets qu'au niveau de l'allocation des ressources. Il s'agit d'un mode de fonctionnement fréquent mais peu efficace hormis le cas de petits projets ou de projets fortement technologiques à lots de travaux indépendants. b) Dans un deuxième cas de figure, une structure dédiée est mise en place : les intervenants du projet son rattachés, pour la durée de leur mission relative au projet, à une structure temporaire dirigée par un chef de projet rattaché fréquemment directement à la direction générale. Ce mode de fonctionnement assure une grande cohésion au projet et favorise la déclinaison stratégique des objectifs du projet à tous les niveaux opérationnels. En revanche, il présente souvent des problèmes d'optimisation des charges de travail (perte d'efficience au niveau de l'entreprise) et rend délicats la capitalisation du savoir faire et le retour d'expériences. c) Le troisième cas consiste en une combinaison des deux formules précédentes pour en tirer les avantages respectifs : cette structure dite matricielle (figure 3) allie l'efficacité (optimisation du résultat) pour le projet et l'efficience (optimisation des moyens) pour l'entre- prise. Très séduisant conceptuellement, ce mode d'organisation qui subordonne chaque membre de l'équipe projet à deux autorités distinctes est parfois difficile à vivre. En conséquence, il apparaît clairement que l'organisation permanente propre à l'entreprise et l'organisation temporaire qui caractérise le projet ont dans chaque cas de structure un rapport de pouvoir déterminant sur la mise en œuvre et la réussite du pro- jet. C'est la Direction de projet qui propose et fait valider par le maître d'ouvrage l'organisation qui lui paraît la mieux adaptée . 21.
Scene 22 (42m 8s)
[Audio] Dans l'organisation d'un projet, on trouve différentes fonctions qui, selon la taille du projet, peuvent impliquer plusieurs personnes à temps plein pour chacune d'elles ou au contraire mobiliser quelques heures d'une seule personne. L'ensemble des personnes en charge de ces fonctions est dirigé et coordonné par le chef de projet. Les membres de l'équipe projet n'appartiennent plus, à partir du moment où ils sont désignés pour prendre part au projet, à leur structure habituelle hiérarchique dite permanente par opposition à la structure non permanente du projet. Il existe schématiquement trois types de structures non permanentes. a) Dans un premier cas de figure, la structure non permanente se fond dans le fonctionnement courant de l'entreprise : les spécialistes intervenant sur le projet restent hiérarchiquement rattachés à leur responsable de spécialité. Le chef de projet transmet alors ses consignes par leur intermédiaire ; son autorité est réduite et la coordination est difficile puisque le responsable de spécialité impose en général ses priorités tant au niveau des projets qu'au niveau de l'allocation des ressources. Il s'agit d'un mode de fonctionnement fréquent mais peu efficace hormis le cas de petits projets ou de projets fortement technologiques à lots de travaux indépendants. b) Dans un deuxième cas de figure, une structure dédiée est mise en place : les intervenants du projet son rattachés, pour la durée de leur mission relative au projet, à une structure temporaire dirigée par un chef de projet rattaché fréquemment directement à la direction générale. Ce mode de fonctionnement assure une grande cohésion au projet et favorise la déclinaison stratégique des objectifs du projet à tous les niveaux opérationnels. En revanche, il présente souvent des problèmes d'optimisation des charges de travail (perte d'efficience au niveau de l'entreprise) et rend délicats la capitalisation du savoir faire et le retour d'expériences. c) Le troisième cas consiste en une combinaison des deux formules précédentes pour en tirer les avantages respectifs : cette structure dite matricielle (figure 3) allie l'efficacité (optimisation du résultat) pour le projet et l'efficience (optimisation des moyens) pour l'entre- prise. Très séduisant conceptuellement, ce mode d'organisation qui subordonne chaque membre de l'équipe projet à deux autorités distinctes est parfois difficile à vivre. 22.
Scene 23 (44m 31s)
[Audio] En conséquence, il apparaît clairement que l'organisation permanente propre à l'entreprise et l'organisation temporaire qui caractérise le projet ont dans chaque cas de structure un rapport de pouvoir déterminant sur la mise en œuvre et la réussite du projet. C'est la Direction de projet qui propose et fait valider par le maître d'ouvrage l'organisation qui lui paraît la mieux adaptée 4- Ingénierie intégrée La démarche d'ingénierie intégrée (dénommée également ingénierie simultanée ou ingénierie concourante) s'inscrit dans le cadre de la recherche d'amélioration de l'efficacité et de la productivité dans le déroulement d'un projet. Elle permet d'éviter les reprises coûteuses liées à la prise en compte tardive de contraintes propres aux activités qui se situent en aval du cycle de vie du produit (production, maintenance, élimination, etc.). Les principaux objectifs de l'ingénierie intégrée se résument par la volonté de : — réaliser correctement du premier coup ; — réduire la durée des cycles de réalisation ; — réagir rapidement et efficacement aux perturbations d'un projet et aux sollicitations du marché. 23.
Scene 24 (45m 41s)
[Audio] L'ingénierie intégrée doit être perçue comme une approche tendant à ramener vers l'amont la connaissance des métiers s'exerçant en aval et non comme l'obligation de réaliser simultané- ment toutes les phases d'activité du cycle de vie du produit. 24.
Scene 25 (45m 58s)
[Audio] GESTION DE PROJET - ANALYSES DU BESOIN, FONCTIONNELLE ET DE LA VALEUR ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE : il s'agit d'une analyse qui part du besoin pour définir les fonctions attendues d'un produit. Lors de cette analyse, le produit n'existe pas encore, à fortiori aucune solution n'est envisagée. On se place du point de vue du client. I – Le produit : histoire d'un besoin NF X50 – 150 : "Un besoin est une nécessité, un désir éprouvé par un utilisateur". Le besoin doit être exprimé (pas facile), il est souvent latent, suscité (société de consommation...), il peut être imposé (normes, lois...). L'analyse du besoin va permettre de caractériser le besoin, pour rédiger le cahier des charges fonctionnel. 2. Le produit Un produit est une réalisation de l'homme, il n'est pas le fruit de la nature : il a été imaginé et réalisé pour satisfaire un besoin de l'homme (exemple : une loi, un tableau, une voiture...). Un produit peut être : - Un objet, un processus ou un service. On se limitera dans ce cours à l'analyse des produits industriels, c'est-à-dire aux produits qui sont le fruit de l'activité d'homme au sein d'un groupe socialement organisé pour cette réalisation et soumis aux impératifs des techniques et des coûts Dans un contexte industriel, le client achète le produit réalisé par l'entreprise. Cependant, le client n'a pas de relation avec l'entreprise sinon au travers du produit qu'il se procure, et des attentes qu'il peut avoir. Le produit est bien au cœur de la boucle 3– Expression du besoin 3.1. Besoin exprimé – Besoin Caractérisé Le client rêve en dehors de toutes contraintes, les enquêtes, les prototypes, l'analyse de la concurrence permettent aux groupes « produits » d'exprimer le besoin du client potentiel : c'est le besoin exprimé. Cette première étape est l'expression du besoin. L'analyse du besoin est une méthode qui contribue à la caractérisation du besoin c'est-à-dire la détermination de la grandeur mesurable qui va être modifiée par l'utilisation du produit : c'est le besoin caractérisé. De plus, l'analyse du besoin peut générer l'innovation. 3.2. Graphe des prestations – "bête à cornes" La méthode d'expression du besoin repose sur trois questions : - A qui le produit rend-il service ? À celui qui l'utilise : le client utilisateur - Dans quel but ? Pour satisfaire le besoin exprimé - Sur quoi le produit agit-il ? Sur l'état d'une matière d'œuvre 25.
Scene 26 (48m 41s)
[Audio] A qui ? Sur quoi ? (ou à quoi ?) (ou sur qui ?) le système rendle système agit-il ? il service ? SYSTEME Pourquoi cette action ? La réponse exprime le besoin Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p3 Le graphe des prestations est le schéma normalisé de l'expression du besoin Le produit rend service au client en agissant sur la matière d'œuvre pour satisfaire le besoin. La satisfaction du produit est générée par la modification de l'état d'une matière d'œuvre. Exemple : Le Segway Exemple : Le Segway 3. Caractérisation du besoin L'expression du besoin n'est pas suffisante, l'étape suivante est la caractérisation du besoin : il s'agit de qualifier et quantifier. La caractérisation précise les grandeurs mesurables liées à la matière d'œuvre. Qualifier : c'est identifier et exprimer le phénomène physique sur lequel le produit va agir et qui va générer la satisfaction du client (la matière d'œuvre). Quantifier : il s'agit de préciser la métrique qui va permettre d'appréhender l'effet du produit sur le phénomène et de donner le seuil de satisfaction du client. On définit un critère (grandeur physique Mesurable) et on précise une valeur c'est-à-dire un niveau attendu. Critère Valeur 3.3. Caractérisation du besoin L'expression du besoin n'est pas suffisante, l'étape suivante est la caractérisation du besoin : il s'agit de qualifier et quantifier. La caractérisation précise les grandeurs mesurables liées à la matière d'œuvre. Qualifier : c'est identifier et exprimer le phénomène physique sur lequel le produit va agir et qui va générer la satisfaction du client (la matière d'œuvre). Quantifier : il s'agit de préciser la métrique qui va permettre d'appréhender l'effet du produit sur le phénomène et de donner le seuil de satisfaction du client. On définit un critère (grandeur physique Mesurable) et on précise une valeur c'est-à-dire un niveau attendu. La caractérisation permet la validation de la satisfaction du client. Le client sera supposé satisfait lorsque le phénomène physique aura atteint ou dépassé le seuil, le niveau. 26 Exemple : Le Segway.
Scene 27 (51m 31s)
[Audio] phénomène et de donner le seuil de satisfaction du client. On définit un critère (grandeur physique Mesurable) et on précise une valeur c'est-à-dire un niveau attendu. Critère Valeur Critère Valeur La caractérisation permet la validation de la satisfaction du client. Le client sera supposé satisfait orsque le phénomène physique aura atteint ou dépassé le seuil, le niveau. Exemple : Le Segway La caractérisation permet la validation de la satisfaction du client. Le client sera supposé satisfait lorsque le phénomène physique aura atteint ou dépassé le seuil, le niveau. Le Segway agit sur les déplacements de l'individu, les phénomènes physiques mesurables sont en articulier la vitesse du déplacement, la distance possible (en autonomie)… Exemple : Le Segway Le Segway agit sur les déplacements de l'individu, les phénomènes physiques mesurables sont en particulier la vitesse du déplacement, la distance possible (en autonomie). Exemple : Le Segway Critère Valeur Le Segway agit sur les déplacements de l'individu, les phénomènes physiques mesurables sont en Distance en autonomie 30 km particulier la vitesse du déplacement, la distance possible (en autonomie)… Vitesse De 0 à 20 km/h … … Critère Valeur Distance en autonomie 30 km Vitesse De 0 à 20 km/h … … Remarques : - Une matière d'œuvre est caractérisée par plusieurs critères. - Un même besoin exprimé peut être satisfait par la modification de différentes matières d'œuvre. Il est alors caractérisé par plusieurs bêtes à cornes. 3.4. Validation du besoin Pour valider l'expression du besoin, il reste à poser trois questions complémentaires : Pourquoi ? # Pourquoi le produit existe-t-il ? Cette question permet de valider l'effet de l'utilisation du produit sur la matière d'œuvre. Le produit existe pour faire évoluer la matière d'œuvre. Evoluer ? # Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin ? Afin de valider la stabilité du besoin donc de la grandeur physique qui évolue lors de l'utilisation du produit. Cette question permet d'anticiper les évolutions du besoin. Disparaître ? # Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître le besoin ? Cette question permet de valider la pérennité du besoin. Elle assure la pertinence de l'étude qui débute. Conclusion : le besoin est exprimé, caractérisé et validé, on parle de Prestation, il est maintenant possible de procéder à l'analyse fonctionnelle du besoin. 4 – Analyse fonctionnelle du besoin 4.1. Présentation L'analyse fonctionnelle du besoin, permet de caractériser les fonctions de service attendues et générées par l'usage du produit. On a vu que le besoin exprimé par le client est satisfait si lors de son utilisation le produit répond à ses attentes. Il s'agit donc d'étudier le produit en situation d'utilisation, dans un milieu environnant. Il faut en particulier imaginer les interactions du produit avec son environnement. On considère 27.
Scene 28 (55m 2s)
[Audio] Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p5 Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p5 le produit comme "générateur de services", d'où le nom de fonctions de service entre le produit et les éléments du milieu extérieur. Conséquence : le produit (toujours au stade de concept et non de solution) est au cœur de son environnement. Cet environnement est constitué de tous les éléments du milieu extérieur, en relation avec le produit. La notion de frontière est primordiale. Frontière entre le produit Frontière entre le produit et son environnement et son environnement Relation entre Relation entre Elément du Milieu Elément du Milieu l'élément du milieu l'élément du milieu Extérieur Extérieur extérieur et le produit extérieur et le produit 2. Phases et cycle de vie du produit 2. Phases et cycle de vie du produit Le cycle de vie d'un produit est défini par ses différentes phases d'utilisation. Le besoin (la Le cycle de vie d'un produit est défini par ses différentes phases d'utilisation. Le besoin (la prestation) est différent pour chaque phase, les éléments du milieu extérieur, et les fonctions de service changent également. Une phase se caractérise par la stabilité des fonctions de service. prestation) est différent pour chaque phase, les éléments du milieu extérieur, et les fonctions de service changent également. Une phase se caractérise par la stabilité des fonctions de service. 4.2. Phases et cycle de vie du produit Le cycle de vie d'un produit est défini par ses différentes phases d'utilisation. Le besoin (la prestation) est différent pour chaque phase, les éléments du milieu extérieur, et les fonctions de service changent également. Une phase se caractérise par la stabilité des fonctions de service. 3. Graphe des fonctions de service (ou des interacteurs), pour une phase d'utilisation 3. Graphe des fonctions de service (ou des interacteurs), pour une phase d'utilisation La définition des relations entre le produit et les éléments du milieu extérieur est généralement La définition des relations entre le produit et les éléments du milieu extérieur est généralement une "histoire" de spécialistes, qui "racontent" l'utilisation du produit, pour envisager toutes les interactions avec l'extérieur. On peut alors construire le graphe des interacteurs. une "histoire" de spécialistes, qui "racontent" l'utilisation du produit, pour envisager toutes les interactions avec l'extérieur. On peut alors construire le graphe des interacteurs. # Les Eléments du Milieu Extérieur (EME) peuvent être de différente nature : # Les Eléments du Milieu Extérieur (EME) peuvent être de différente nature : 4.3. Graphe des fonctions de service (ou des interacteurs), pour une phase d'utilisation La définition des relations entre le produit et les éléments du milieu extérieur est généralement une "histoire" de spécialistes, qui "racontent" l'utilisation du produit, pour envisager toutes les interactions avec l'extérieur. On peut alors construire le graphe des interacteurs. # Les Eléments du Milieu Extérieur (EME) peuvent être de différente nature : - Physique (relatif à des matériaux, au milieu ambiant...) - Humain (relatif à l'ergonomie, au poids, à la maintenance...) - Technique (relatif à la source d'énergie...) Ils sont nommés afin de pouvoir être identifiés facilement # Les relations sont les fonctions de service du produit. - Physique (relatif à des matériaux, au milieu ambiant…) - Humain (relatif à l'ergonomie, au poids, à la maintenance…) - Technique (relatif à la source d'énergie…) - Relations entre deux EME par l'intermédiaire du produit : ce sont les fonctions principales ou fonctions d'usage. Elles satisfont le besoin, elles assurent la prestation. - Relation entre un EME et le produit, ce sont.
Scene 29 (59m 30s)
[Audio] Fonction contrainte Les fonctions de services sont numérotées. FS3 Fonction principale 2 FS4 FS2 FS1 Remarque : bien que les relations ne soient pas orientées, on peut distinguer : Fonction contrainte FS3 → les relations qui indiquent que le produit modifie l'état de l'EME ; → les relations qui indiquent que le produit est modifié par l'EME ; 2 FS4 Ainsi par exemple : Remarque : bien que les relations ne soient pas orientées, on peut distinguer : FP : le produit permet à l'EME 1 de modifier l'état de l'EME 3 ; FC1 : le produit modifie l'état de l'EME 2 ; FC2 (FC3) : le produit est modifié par l'EME 4 (l'EME 5) ; → les relations qui indiquent que le produit modifie l'état de l'EME ; → les relations qui indiquent que le produit est modifié par l'EME ; Remarque : bien que les relations ne soient pas orientées, on peut distinguer : →�les relations qui indiquent que le produit modifie l'état de l'EME ; →�les relations qui indiquent que le produit est modifié par l'EME ; Ainsi par exemple : FP : le produit permet à l'EME 1 de modifier l'état de l'EME 3 ; FC1 : le produit modifie l'état de l'EME 2 ; FC2 (FC3) : le produit est modifié par l'EME 4 (l'EME 5) ; Ainsi par exemple : FP FC1 FP : le produit permet à l'EME 1 de modifier l'état de l'EME 3 ; FC1 : le produit modifie l'état de l'EME 2 ; FC2 (FC3) : le produit est modifié par l'EME 4 (l'EME 5) ; FC2 FC3 FP FC1 Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p7 # "Une fonction de service est l'action attendue d'un produit (ou réalisée par lui) pour répondre à un élément du besoin d'un utilisateur donné" La formulation des fonctions de service est normalisée : un verbe ou un groupe verbal pour caractériser l'action ; des compléments représentant les éléments du milieu extérieur concernés. FC2 FC3 La Norme dit () → Il faut souvent plusieurs fonctions de service pour répondre à un besoin ; → Les fonctions de service comprennent les fonctions d'usage (partie rationnelle du besoin) et les fonctions d'estime (partie subjective du besoin) # "Une fonction est l'action d'un produit exprimé exclusivement en terme de finalité" Remarque importante : le graphe des interacteurs est établi pour une phase d'utilisation, au cours de la durée de vie d'un produit, il y aura donc autant de graphes que de phases. → La formulation doit être indépendante des solutions susceptibles de la réaliser. La formulation des fonctions de service est normalisée : un verbe ou un groupe verbal pour caractériser l'action ; des compléments représentant les éléments du milieu extérieur concernés. Exemple : Le Segway La Norme dit () La formulation des fonctions de service est normalisée : un verbe ou un groupe verbal pour caractériser l'action ; des compléments représentant les éléments du milieu extérieur concernés. La Norme dit (NF X 50 – 150) # "Une fonction est l'action d'un produit exprimé exclusivement en terme de finalité" →�La formulation doit être indépendante des solutions susceptibles de la réaliser. # "Une fonction de service est l'action attendue d'un produit (ou réalisée par lui) pour répondre à un élément du besoin d'un utilisateur donné" →�Il faut souvent plusieurs fonctions de service pour répondre à un besoin ; →�Les fonctions de service comprennent les fonctions d'usage (partie rationnelle du besoin) et les fonctions d'estime (partie subjective du besoin) Remarque importante : le graphe des interacteurs est établi pour une phase d'utilisation, au cours de la durée de vie d'un produit,.
Scene 30 (1h 4m 3s)
[Audio] : Rester insensible aux perturbations provenant de la route : Rester manœuvrable dans la circulation : Etre peu encombrant : Contribuer au respect de l'environnement 4. Caractérisation des fonctions de service attendues Comme pour le besoin, il faut maintenant caractériser les fonctions de service : # Qualifier par des mots les critères de performance de l'action décrite par le verbe. Il s'agit d'identifier la grandeur physique qui évolue, et de préciser le critère qui va permettre son évaluation. # Quantifier pour chaque critère le niveau de performance et les limites d'acceptabilité. Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p8 La Norme () caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée ; FS1 : Permettre au conducteur de se déplacer aisément sur la route (en ville). FS2 : Donner au conducteur une sensation de stabilité FS3 : Rester insensible aux perturbations provenant de la route FS4 : Rester manœuvrable dans la circulation FS5 : Etre peu encombrant FS6 : Contribuer au respect de l'environnement 4.4. Caractérisation des fonctions de service attendues Comme pour le besoin, il faut maintenant caractériser les fonctions de service : # Qualifier par des mots les critères de performance de l'action décrite par le verbe. Il s'agit d'identifier la grandeur physique qui évolue, et de préciser le critère qui va permettre son évaluation. # Quantifier pour chaque critère le niveau de performance et les limites d'acceptabilité. LaNorme (NFX50–150) grandeur repérée sur une échelle adoptée pour un critère d'appréciation d'une fonction ; Taux Classes Limites d'acceptation d'échange ensemble d'indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d'appréciation ; indication littérale placée auprès d'un niveau d'un critère d'appréciation, permettant de préciser son degré de négociabilité ou d'impérativité ; niveau de critère d'appréciation au-delà duquel le besoin est jugé non satisfait. rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation du prix et la variation correspondante du niveau d'un critère d'appréciation. Le tableau usuel : usuellement on précise la "Valeur" = "Niveau + Limite", pour un tableau simplifié. Voir exemple ci-après. Exemple : Le Segway Critère : caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée ; Niveau : grandeur repérée sur une échelle adoptée pour un critère d'appréciation d'une fonction; Flexibilité : ensemble d'indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d'appréciation ; Classe de flexibilité : indication littérale placée auprès d'un niveau d'un critère d'appréciation, permettant de préciser son degré de négociabilité ou d'impérativité ; Limites d'acceptation : niveau de critère d'appréciation au-delà duquel le besoin est jugé non satisfait. Taux d'échange : rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation du prix et la variation correspondante du niveau d'un critère d'appréciation. Le tableau usuel : usuellement on précise la "Valeur" = "Niveau + Limite", pour un tableau simplifié. Voir exemple ci-après. Exemple : Le Segway® Dérapage Aucun Basculement Aucun Rayon de virage Vitesse Rayon minimum 5 km/h 0,5 m FS4 : Rester manœuvrable dans la circulation 10 km/h 2,5 m Minimum admissible 20 km/h 10 m Remarques : # les éléments du milieu extérieur doivent aussi être caractérisés, à l'aide de critères et de niveaux. # Comme pour le besoin, les fonctions de service sont ensuite validées : 5. Conclusion.
Scene 31 (1h 8m 25s)
[Audio] Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p8 caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée ; grandeur repérée sur une échelle adoptée pour un critère d'appréciation d'une fonction ; ensemble d'indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d'appréciation ; indication littérale placée auprès d'un niveau d'un critère d'appréciation, permettant de préciser son degré de négociabilité ou d'impérativité ; niveau de critère d'appréciation au-delà duquel le besoin est jugé non satisfait. 5. Cahier des charges fonctionnel 5.1 Introduction La première étape d'une démarche de conception de produit consiste à exprimer, formuler et définir le besoin. À cette fin, le Cahier des Charges Fonctionnel ou CdCF intervient au premier stade de l'étude et est l'un des moyens utilisés pour traduire ce besoin. Le CdCF est utilisé pour préparer et suivre le développement ainsi que la réalisation d'un produit. Il sert de référence et de base de négociation en cas de contrat, litige, conflit ou modifications nécessaires des spécifications techniques du produit. Utilisations : consultations, appels d'offre, adjudications, marchés négociés entre partenaires (y compris entre services d'une même entreprise ou d'un autre secteur), conception pour un coût objectif (CCO), relations contractuelles en analyse de la valeur, etc. Produits concernés : tous les types de produits ; produits industriels, de génie civil, bâtiments, prestations intellectuelles, services, fournitures courantes, etc. rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation du prix et la variation correspondante du niveau d'un critère d'appréciation. Le tableau usuel : usuellement on précise la "Valeur" = "Niveau + Limite", pour un tableau simplifié. Voir exemple ci-après. Exemple : Le Segway Dérapage Aucun Basculement Aucun Rayon de virage Vitesse Rayon minimum 5 km/h 0,5 m FS4 : Rester manœuvrable dans la circulation 10 km/h 2,5 m Minimum admissible 20 km/h 10 m Remarques : # les éléments du milieu extérieur doivent aussi être caractérisés, à l'aide de critères et de niveaux. # Comme pour le besoin, les fonctions de service sont ensuite validées : 5. Conclusion : cahier des charges fonctionnel Le Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) représente l'ensemble des graphes des fonctions de service caractérisées, ainsi que les caractéristiques des Eléments du Milieu Extérieur, et ce pour chaque phase du produit, de la naissance jusqu'au recyclage. 5.2 CDCF Le Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) représente l'ensemble des graphes des fonctions de service caractérisées, ainsi que les caractéristiques des Eléments du Milieu Extérieur, et ce pour chaque phase du produit, de la naissance jusqu'au recyclage. 31.
Scene 32 (1h 11m 57s)
[Audio] Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p9 ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE : il s'agit cette fois de l'étude des fonctions de service réalisées (et non plus attendues) à partir des solutions techniques proposées par l'entreprise pour réaliser le produit. On se place du point de vue de l'exploitant ou du concepteur. ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE : il s'agit cette fois de l'étude des fonctions de service réalisées (et non plus attendues) à partir des solutions techniques proposées par l'entreprise pour réaliser le produit. On se place du point de vue de l'exploitant ou du concepteur. IV – Outil graphique FAST : Function Analysis System Technic 1. Notion de Cahier des charges 1. Fonctions de service et fonctions techniques Chaque fonction de service est obtenue à l'aide de fonctions techniques. Ces fonctions techniques font elles appel à des solutions techniques. Lors de la conception d'un produit, il est ainsi nécessaire de confronter les fonctions de service réalisées, avec les fonctions de service attendues pour répondre au besoin exprimé. 2. L'outil graphique Lorsqu'un organisme ou une entreprise (demandeur) veut faire concevoir un produit par un tiers (autre entreprise ou autre département de la même entreprise) il doit en principe établir un cahier des charges. Un cahier des charges, quelle qu'en soit la nature, a trois rôles essentiels : - exprimer la demande, - constituer la référence des rapports entre les deux partenaires, - fournir un cadre de réponse qui facilitera l'exploitation de celle-ci par le demandeur. 2. Cahier des charges fonctionnel CdCF La méthode F.A.S.T. est un outil graphique qui permet de détailler les fonctions techniques et les solutions associées. Organisé de la gauche vers la droite, partant d'une fonction de service, le diagramme F.A.S.T. recense toutes les fonctions techniques et pour finir il présente les solutions technologiques définies. Il est basé sur une méthode interrogative : pour chaque fonction technique indiquée dans un rectangle on doit pouvoir trouver autour les réponses aux questions définies ci-dessous. # Pourquoi une fonction doit-elle être assurée ? Pourquoi ? Comment ? FONCTION # Comment cette fonction doit-elle être assurée ? Quand ? # Quand cette fonction doit-elle être assurée ? Les règles de syntaxe sont les suivantes : # Les nombres de lignes et de colonnes ne sont pas fixés, ils dépendent du système. # La rubrique Quand n'est généralement pas spécifiée, pour une description fonctionnelle. Définition (NF X 50-150) : On appelle Cahier des charges fonctionnel, CdCF, le document par lequel le demandeur exprime son besoin (ou celui qu'il est chargé de traduire) en terme de fonctions de service et de contraintes. Pour chacune des fonctions et contraintes, sont définis des critères d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux est assorti d'une flexibilité. Remarque 1 : le CdCF s'occupe des fonctions de service du produit, des contraintes correspondantes et n'exprime aucune idée de technique et, il n'impose pas de solutions. Remarque 2 : le but poursuivi par le CdCF est d'obtenir en réponse la proposition de produit le plus apte à rendre le service attendu, dans les conditions prévues, pour le coût minimum. A cet effet, le CdCF n'exprime que des exigences de résultats et en principe, aucune exigence de moyens. L'un des principes de base du concept de « Qualité » est de bien séparer dans toutes les activités, d'une part le besoin à satisfaire et d'autre part la solution choisie pour répondre à ce besoin. Cette démarche permet de mieux analyser le.
Scene 33 (1h 15m 42s)
[Audio] niveau écran à fond sombre 1 minute d'arc. Ces limites sont des limites inférieures d'acceptation. Exemple 2 : CdCF d'un moteur d'avion (avec limites d'acceptation et flexibilités) Fonction : Fournir une poussée à l'aéronef. Critères : niveau de poussée : 30 000 daN, limite d'acceptation : 28 000 daN. niveau de consommation du carburant : 0,5 kg par heure ; de carburant par unité de poussée à Mach 0,8 et une altitude de 9000 m. masse nominale : 5200 kg; limite d'acceptation 5500 kg. Taux d'échange : un écart de masse de 1 kg s'échange avec un écart de consommation de carburant de 0,01 %. Cela veut dire que le client est prêt à accepter de manière équivalente un moteur dont la masse et la consommation de carburant seront de : m = 5210 kg avec une consommation = 0,4995 , m = 5200 kg avec une consommation = 0,5 , m =5190 kg avec une consommation = 0,5005. En tout état de cause, les limites d'acceptation devront être impérativement respectées. Cet ensemble de fonctions, critères, niveaux, flexibilités sont en quelque sorte « des règles du jeu » auxquelles les solutions que vous proposerez devront satisfaire pour participer à la sélection finale. 5.3 Parties principales d'un CDCF Dans le cas de produits complexes ou nouveaux, il est souvent nécessaire de procéder à plusieurs rédactions ou éditions successives du CdCF avant d'arriver à l'expression définitive. Un CdCF se compose de quatre parties principales plus des annexes éventuelles. 1. Une présentation générale du problème Elle permet de prendre connaissance rapidement du problème posé et est destinée à donner toutes les informations générales utiles concernant le produit : marché, débouchés, contexte du projet, concept général du produit, besoins principaux auxquels il doit répondre, son environnement, les limites de l'étude, etc. 2. L'énoncé fonctionnel des besoins (partie principale ou coeur du CdCF) Il servira de base pour concevoir des solutions susceptibles de répondre aux besoins. Il décrit et définit les fonctions de service à satisfaire par le produit, les contraintes, les critères d'appréciation (niveaux, flexibilité, limites d'acceptation, taux d'échange), etc. 3. Un appel éventuel à des variantes Cette partie demande et fixe les limites à l'étude d'autres propositions ou d'autres solutions possibles pour réaliser le produit. 4. Un cadre de réponse Il est destiné à simplifier et à codifier la façon de répondre (présentations, descriptions, etc.) afin de faciliter les dépouillements et vérifier que toutes les informations nécessaires sont bien fournies. 5. Les annexes 5.4 Organisation nécessaire à l'élaboration d'un CDCF Pour élaborer un CdCF un demandeur a besoin d'une structure de travail particulière analogue à celle utilisée dans une action d'analyse de la valeur. Cette structure est constituée d'un ensemble décideur, animateur plus groupe de travail. Demandeur : personne, organisme ou société responsable du financement, qui élabore le cahier des charges du produit. Le demandeur peut être l'utilisateur du produit, un service de 33.
Scene 34 (1h 19m 25s)
[Audio] l'entreprise ou un organisme qui se substitue aux utilisateurs ou encore le concepteur du système auquel le produit doit s'intégrer. Décideur : personne nommée ou mandatée pour prendre les décisions. Elle représente la direction de l'entreprise et a reçu les pouvoirs nécessaires. Elle intervient chaque fois que nécessaire et impérativement lors des choix définitifs. Animateur : c'est la personne chargée de l'organisation et du déroulement de l'élaboration du CdCF. Elle est responsable devant le décideur. L'animateur peut être interne ou extérieur (« animateur conseil ») à l'entreprise. Groupe de travail : c'est la structure opérationnelle de l'élaboration, celle qui collecte les informations, réfléchit, fait des propositions, rédige, etc. Le groupe n'a pas de hiérarchie interne et est solidairement responsable de la qualité du travail et de la validité de ce qu'il propose. Le groupe permet une démarche pluridisciplinaire en réunissant les représentants des différentes parties prenantes dans l'acquisition du produit et/ou dans sa mise en oeuvre. 5.5 Processus d'élaboration d'un CDCF 5.6 Erreurs à ne PAS COMMETTRE Eviter les mots ambigus ou potentiellement ambigus rapidement, adéquat, et/ou, etc…, « dans l'état de l'art », suffisant, ancien, nouveau, augmenter, diminuer, « non limité à … », minimiser, maximiser…. Eviter les expressions trop restrictives : La charge utile sera de 30 kg ou la charge utile sera inférieure ou égale à 30 kg. Ne pas utiliser minimum et maximum, mais « pas supérieur à… » et « pas inférieur à… » Eviter les redondances : on décrit un produit ou des mises en oeuvre au lieu d'exprimer un besoin. Se poser la question pourquoi ? à chaque affirmation. Le danger quand on décrit un produit au lieu d'exprimer des besoins, est de croire que tous les besoins sont couverts par le produit indiqué. On indique comment il faut faire au lieu d'indiquer ce qu'il faut faire. Usage de termes incorrects : les mots est, était, doit, ne doivent pas être utilisés dans un cahier des charges, mais dans des spécifications. Le fait qu'un besoin soit techniquement réalisable n'implique pas forcément qu'il est réalisable dans les conditions d'un projet donné. 34.
Scene 35 (1h 21m 53s)
[Audio] – Outil graphique FAST : Function Analysis System Technic FAST : Function Analysis System Technic Fonctions de service et fonctions techniques ice et fonctions techniques Chaque fonction de service est obtenue à l'aide de fonctions techniques. Ces fonctions techniques e service est obtenue à l'aide de fonctions techniques. Ces fonctions techniques solutions techniques. Lors de la conception d'un produit, il est ainsi nécessaire ont elles appel à des solutions techniques. Lors de la conception d'un produit, il est ainsi nécessaire e confronter les fonctions de service réalisées, avec les fonctions de service attendues pour épondre au besoin exprimé. onctions de service réalisées, avec les fonctions de service attendues pour xprimé. L'outil graphique La méthode F.A.S.T. est un outil graphique qui permet de détailler les fonctions techniques et les olutions associées. Organisé de la gauche vers la droite, partant d'une fonction de service, le iagramme F.A.S.T. recense toutes les fonctions techniques et pour finir il présente les solutions echnologiques définies. .T. est un outil graphique qui permet de détailler les fonctions techniques et les Organisé de la gauche vers la droite, partant d'une fonction de service, le recense toutes les fonctions techniques et pour finir il présente les solutions ies. Il est basé sur une méthode interrogative : pour chaque fonction technique indiquée dans un ectangle on doit pouvoir trouver autour les réponses aux questions définies ci-dessous. e méthode interrogative : pour chaque fonction technique indiquée dans un voir trouver autour les réponses aux questions définies ci-dessous. # Pourquoi une fonction doit-elle être assurée ? Pourquoi ? Comment ? 6 – Outil graphique FAST : Function Analysis System Technic 6.1. Fonctions de service et fonctions techniques Chaque fonction de service est obtenue à l'aide de fonctions techniques. Ces fonctions techniques font elles appel à des solutions techniques. Lors de la conception d'un produit, il est ainsi nécessaire de confronter les fonctions de service réalisées, avec les fonctions de service attendues pour répondre au besoin exprimé. 6.2. L'outil graphique La méthode F.A.S.T. est un outil graphique qui permet de détailler les fonctions techniques et les solutions associées. Organisé de la gauche vers la droite, partant d'une fonction de service, le diagramme F.A.S.T. recense toutes les fonctions techniques et pour finir il présente les solutions technologiques définies. Il est basé sur une méthode interrogative : pour chaque fonction technique indiquée dans un rectangle on doit pouvoir trouver autour les réponses aux questions définies ci-dessous. # Pourquoi une fonction doit-elle être assurée ? # Comment cette fonction doit-elle être assurée ? # Quand cette fonction doit-elle être assurée ? FONCTION onction doit-elle être assurée ? Pourquoi ? Comment ? # Comment cette fonction doit-elle être assurée ? Quand ? FONCTION fonction doit-elle être assurée ? # Quand cette fonction doit-elle être assurée ? Quand ? nction doit-elle être assurée ? Les règles de syntaxe sont les suivantes : sont les suivantes : # Les nombres de lignes et de colonnes ne sont pas fixés, ils dépendent du système. # La rubrique Quand n'est généralement pas spécifiée, pour une description fonctionnelle. de lignes et de colonnes ne sont pas fixés, ils dépendent du système. Quand n'est généralement pas spécifiée, pour une description fonctionnelle. # Pour la question "Comment ?" il y a généralement plusieurs éléments de réponse, deux possibilités sont alors prévues : Les règles de syntaxe sont les suivantes : # Les nombres de lignes et de colonnes ne sont pas fixés, ils dépendent du système. # La rubrique Quand n'est généralement pas.
Scene 36 (1h 25m 56s)
[Audio] Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p10 Exemple : Le Segway (F.A.S.T. partiel) Exemple : LeSegway® (F.A.S.T.partiel) V – Outil graphique SADT : Structured Analysis & Design Technic (Design : conception) Il s'agit d'un outil d'analyse descendante d'un système, qui permet une étude progressive : du V – Outil graphique SADT : Structured Analysis & Design Technic (Design : conception) global, vers le détail. La méthode appliquée industriellement est un outil de communication entre des personnes d'origines différentes. Il permet la description dans un langage commun, c'est la vision de synthèse qu'ils ont d'un même projet. Il s'agit d'un outil d'analyse descendante d'un système, qui permet une étude progressive : du La méthode SADT est une méthode graphique qui part du général pour aller au particulier. Elle global, vers le détail. La méthode appliquée industriellement est un outil de communication entre des personnes d'origines différentes. Il permet la description dans un langage commun, c'est la vision de synthèse qu'ils ont d'un même projet. permet de décrire des systèmes où coexistent des flux de matières d'œuvre (produits, énergies et informations). Elle s'appuie sur la mise en relation de ces différents flux avec les fonctions que remplit le système. La méthode SADT est une méthode graphique qui part du général pour aller au particulier. Elle Le modèle de représentation prend la forme d'Actigrammes, rectangles basés sur les activités ou les fonctions du système. 7 – Outil graphique SADT : Structured Analysis & Design Technic (Design : conception) Il s'agit d'un outil d'analyse descendante d'un système, qui permet une étude progressive : du global, vers le détail. La méthode appliquée industriellement est un outil de communication entre des personnes d'origines différentes. Il permet la description dans un langage commun, c'est la vision de synthèse qu'ils ont d'un même projet. La méthode SADT est une méthode graphique qui part du général pour aller au particulier. Elle permet de décrire des systèmes où coexistent des flux de matières d'œuvre (produits, énergies et informations). Elle s'appuie sur la mise en relation de ces différents flux avec les fonctions que remplit le système. Le modèle de représentation prend la forme d'Actigrammes, rectangles basés sur les activités ou les fonctions du système. permet de décrire des systèmes où coexistent des flux de matières d'œuvre (produits, énergies et informations). Elle s'appuie sur la mise en relation de ces différents flux avec les fonctions que remplit le système. Le modèle de représentation prend la forme d'Actigrammes, rectangles basés sur les activités ou les fonctions du système. Les actigrammes sont définis par : Les entrées : SUR QUOI agit la fonction ? Les sorties : QUE DEVIENNENT les entrées, après réalisation de la fonction ? Les contraintes de pilotage : éléments qui paramètrent et modulent la fonction. Les moyens (support d'activités) : c'est la réponse à la question : QUI réalise la fonction ? La description du global vers le détail est réalisée par des niveaux hiérarchisés : # Le niveau A-0 (le plus global) pour la fonction globale à l'extérieur du rectangle on trouve l'environnement, ainsi défini après avoir isolé le système ; 36.
Scene 37 (1h 29m 21s)
[Audio] l'environnement, ainsi défini après avoir isolé le système ; # Le niveau A-0 (le plus global) pour la fonction globale à l'extérieur du rectangle on trouve l'environnement, ainsi défini après avoir isolé le système ; Contraintes de pilotage Contraintes de pilotage ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT M.O. Sortante, nantie de M.O. Sortante, nantie de valeur ajoutée FONCTION M.O. Entrante GLOBALE DU valeur ajoutée FONCTION M.O. Entrante GLOBALE DU Informations SYSTEME Informations SYSTEME (Verbe à l'infinitif) Sorties annexes (déchets...) (Verbe à l'infinitif) Sorties annexes (déchets...) A-0 Moyens : ensemble des moyens utilisés pour réaliser la fonction A-0 Moyens : ensemble des moyens utilisés pour réaliser la fonction Exemple : Le Segway Exemple : Le Segway® Exemple : Le Segway Inclinaison du Inclinaison du conducteur Consigne de direction conducteur Consigne de direction Energie électrique Marche - Arrêt Energie électrique Marche - Arrêt Temporaire Temporaire Conducteur en Conducteur en Conducteur en position mouvement Transporter un Conducteur en position mouvement Transporter un initiale conducteur initiale conducteur Segway Segway Approche détaillée : Approche détaillée : # Le niveau A0 après décomposition de la fonction globale en fonctions principales, ce niveau regroupe les actigrammes A1, A2, A3… (il est recommandé de ne pas dépasser six fonctions principales) ; # Le niveau A0 après décomposition de la fonction globale en fonctions principales, ce niveau regroupe les actigrammes A1, A2, A3… (il est recommandé de ne pas dépasser six fonctions principales) ; # Au-delà l'actigramme A1 peut-être développé à un niveau inférieur regroupant A11, A12… La numérotation permet de connaître le niveau d'emboîtement. # Au-delà l'actigramme A1 peut-être développé à un niveau inférieur regroupant A11, A12… La numérotation permet de connaître le niveau d'emboîtement. Approche détaillée : # Le niveau A0 après décomposition de la fonction globale en fonctions principales, ce niveau regroupe les actigrammes A1, A2, A3... (il est recommandé de ne pas dépasser six fonctions principales) ; # Au-delà l'actigramme A1 peut-être développé à un niveau inférieur regroupant A11, A12... La numérotation permet de connaître le niveau d'emboîtement. # Chaque boîte possède les éléments d'un actigramme (entrées, sorties, contraintes, moyens). Structure des différents niveaux : # Chaque boîte possède les éléments d'un actigramme (entrées, sorties, contraintes, moyens). # Chaque boîte possède les éléments d'un actigramme (entrées, sorties, contraintes, moyens). 37.
Scene 38 (1h 32m 33s)
[Audio] Etude des Systèmes – Analyse fonctionnelle - p12 Structure des différents niveaux : Remarque : # La méthode S.A.D.T. est assez lourde, elle est principalement utilisée dans le domaine du génie logiciel, et de ce fait bien adaptée à la spécification fonctionnelle de la partie commande d'un système. Elle est puissante, donc valable pour de très gros systèmes, et s'applique difficilement sur de petits systèmes ou à la description très fine des fonctions. Elle n'intègre pas l'aspect temporel. VI – Autre outil graphique : "bloc – diagramme" Il s'agit d'un outil d'analyse structurelle qui situe les fonctions techniques réalisées entre les composants du produit (pour une phase donnée). Les éléments du milieu extérieur peuvent compléter le diagramme. Deux lignes (mixte-fin) horizontales définissent la frontière du produit. PHASE… EME1 FT6 FT1 C1 C2 FT2 FT4 FT5 FT3 C3 C4 C5 FT7 FT8 EME2 EME3 Remarque : # La méthode S.A.D.T. est assez lourde, elle est principalement utilisée dans le domaine du génie logiciel, et de ce fait bien adaptée à la spécification fonctionnelle de la partie commande d'un système. Elle est puissante, donc valable pour de très gros systèmes, et s'applique difficilement sur de petits systèmes ou à la description très fine des fonctions. Elle n'intègre pas l'aspect temporel. 38.
Scene 39 (1h 34m 17s)
[Audio] Exemple : 39. 39 Exemple :.
Scene 40 (1h 34m 23s)
[Audio] de petits systèmes ou à la description très fine des fonctions. Elle n'intègre pas l'aspect temporel. VI – Autre outil graphique : "bloc – diagramme" Il s'agit d'un outil d'analyse structurelle qui situe les fonctions techniques réalisées entre le composants du produit (pour une phase donnée). Les éléments du milieu extérieur peuve compléter le diagramme. Deux lignes (mixte-fin) horizontales définissent la frontière du produit. 8 – Autre outil graphique : "bloc – diagramme" Il s'agit d'un outil d'analyse structurelle qui situe les fonctions techniques réalisées entre les composants du produit (pour une phase donnée). Les éléments du milieu extérieur peuvent compléter le diagramme. Deux lignes (mixte-fin) horizontales définissent la frontière du produit. PHASE… EME1 FT6 FT1 C1 C2 FT2 FT4 FT5 FT3 C3 C4 C5 FT7 FT8 EME2 EME3 9 - Notion de « VALEUR » : Contribution d'une fonction Fi à la satisfaction du besoin utilisateur prix CFi Vi = Ci producteur coût Coût de Fi Poids de Fi Volume de Fi Fiabilité Disponibilité Délais Durée de vie Relation entre la contribution de la fonction (ou du sujet AV) à la satisfaction du besoin et le coût de la fonction (ou du sujet AV). Vi croît si : La contribution croît : CFi ä Le critère de valeur décroît : Ci æ 40.
Scene 41 (1h 36m 4s)
[Audio] 10 - LE PLAN DE TRAVAIL (NFX 50-152 & FDX50-153) D = décideur A = Animateur G = Groupe AV Op = Opérationnels PHASE ACTION D A G Op 1 ORIENTATION Cadre et objectifs * O 2 INFORMATION Recherche des données * O 3 FONCTIONS ET COUTS Recenser - Caractériser * * O Ordonner - Hiérarchiser Valoriser (Coût/fonction) CdCF 4 IDEES ET SOLUTIONS Créativité * * O 5 ETUDE-EVALUATION Conception-Coût O * * O * 6 BILAN PREVISIONNEL Bilan prévisionnel Proposition de choix Décision * * * O 7 REALISATION Application Suivi Bilan O O * * * O O : Participation * : Responsabilité Op : par exemple, le service Méthodes, Devis, Coûts de revient, … Quand faut-il agir ? F Le plus tôt possible ! C'est en effet au stade de la conception que l'on a le plus de chance possible d'avoir un résultat efficacité-valeur le plus performant. Attention, conception ne veut pas dire strictement Bureau d'Etudes. Si le système est un process, la conception est au niveau du créateur du process. 11 - Le tri croisé : Comparaison de l'importance relative des fonctions 2 à 2. 11.1.Tri croisé de base : Permet de classer les éléments par ordre d'importance. En conception, il consiste à déterminer la différence d'importance entre fonctions en les examinant par couple pour mettre en évidence la plus importante. 1 - Quelle est la fonction qui l'emporte ? 2 - Affectation d'une note 1 point = La fonction l'emporte de justesse 2 points = La fonction l'emporte moyennement 3 points = La fonction l'emporte nettement Le tri se fait en 1/2 matrice. Chaque cellule représente la comparaison entre 2 Fonctions Cellule de F2 F1 F 3 F4 F5 F6 comparaison F2 :1 F1:2 F1 :1 F5 :1 F1 :3 F1 ligne / colonne fonctions. On totalise les points obtenus par fonction puis établit un classement final décroissant des fonctions. On obtient le poids de la fonction en rapportant le nb de points obtenus par la fonction au nb total de points distribué F1 l'emporte nettement sur F6 ici F1 avec F2 F2 41 3 points pour F1.
Scene 42 (1h 38m 53s)
[Audio] Remarques : - La distribution peut être 0, 1, 3, 9 points. - Le poids obtenu par F2 F3 F4 note brute : calcul : poids : F1 F1: 3 F1:1 F1: 9 120 F2 F3: 3 F2: 1 4 F3 F3:1 30 F4 0 5% 5% fonction est un cumul des différences d'importances qui ne reflète pas l'ordre de grandeur des fonctions. - Une fonction de faible importance, ne l'emportant jamais sur une autre, se verra attribuer 0 point, donc 0% ! C'est illogique puisque la fonction existe. Répartition du poids restant au prorata de la note du tri croisé. Exemple : Si le groupe décide d'affecter un poids de 5% à la fonction la moins importante. Le poids restant (ici 95%) sera réparti au prorata de la note du tri croisé. 11.2.Exercice d'application : Evaluer la performance de la méthode de tri par rapport à des fonctions dont les importances relatives sont connues (colonne réalité). Tri de base : Chaque case contient l'intitulé de la fonction la plus importante suivie de la note (ici 1pt). F2 F3 F4 points / fonct poids tri croisé réalité écarts F1 F1 :1 F1 :1 F1 :1 55% F2 F3:1 F2:1 12% F3 F3:1 25% F4 8% Total : 12 - Le bloc diagramme fonctionnel : M4 M1 C1 Représenter le milieu extérieur du système (Mi) Lister les éléments Ei du système (pour chaque phase) Représenter d'un trait les relations de contact entre les éléments Ei. Représenter les flux : Flux fonctionnels : C 5 C2 Relations avec le milieu extérieur (Ex. M2, E4) Relations entre éléments du milieu extérieur (Ex. M1, M3) Flux « bouclés » : C3 c6 Relations entre éléments M2 (Ex. E3, E5, E6, E4) C4 42 M3 M5.
Scene 43 (1h 41m 18s)
[Audio] Le BDF permet de construire le TAF : Bilan des flux par élément => participation de l'élément aux fonctions. TAF de l'élément. � des TAF d'éléments = TAF global => Rendement de conception. Eléments Flux fonctionnels Flux de conception Contrainte Interaction F1 – F2 – F3 F8 – F9 – F10 – F11 – F12 x x x x x x x F4 – F5 – F6 – F7 x x x C1 C2 C3 C4 x x Coût d'une fonction : (EN 1325-1) Ensemble de la dépense prévue ou réalisée pour incorporer une fonction dans un sujet AV. 13- Tableau d'analyse fonctionnelle : Répartition des coûts Ci par fonction Fi pour une entité F1 F2 F3 FT F1 F2 F3 FT Le Tableau d'Analyse Fonctionnelle (TAF) représente la participation des composants du produit aux fonctions. Liste des composants Coût par composant C1 K1 X X X K1/3 K1/3 K1/3 C2 K2 X X K2/2 K2/2 C3 K3 x X K3/2 K3/2 C4 K4 x x x x K4/3 K4/3 K4/3 Assemblage K5 X X X X K5/4 K5/4 K5/4 K5/4 Coût total : S Ki coût F1 coût F2 coût F3 coût FT.
Scene 44 (1h 43m 19s)
[Audio] Coûts des composants réalisés MPi = Coût d'approv. Matière première Ri = Coût de réalisation Ki = MPi + Ri Coût des composants approvisionnés Ki = Coût d'approvisionnement Ce coût n'est pas plus affecté à une fonction qu'à une autre. Il est affecté à l'ensemble des fonctions, avec une clef de répartition constante ou non. Par exemple, l'emballage du produit. En effet, on peut affecter une clef de répartition si on estime que la participation des composants aux fonctions n'est égale (cf. TD) Notion de " JUSTE NECESSAIRE " (ou coût plancher): Coût de la solution idéale la plus économique satisfaisant au plus juste la fonction. Coût du produit = coût juste nécessaire + coûts théoriquement inutile. 44.
Scene 45 (1h 44m 8s)
[Audio] EXEMPLE DE CDCF 45. 45 EXEMPLE DE CDCF.