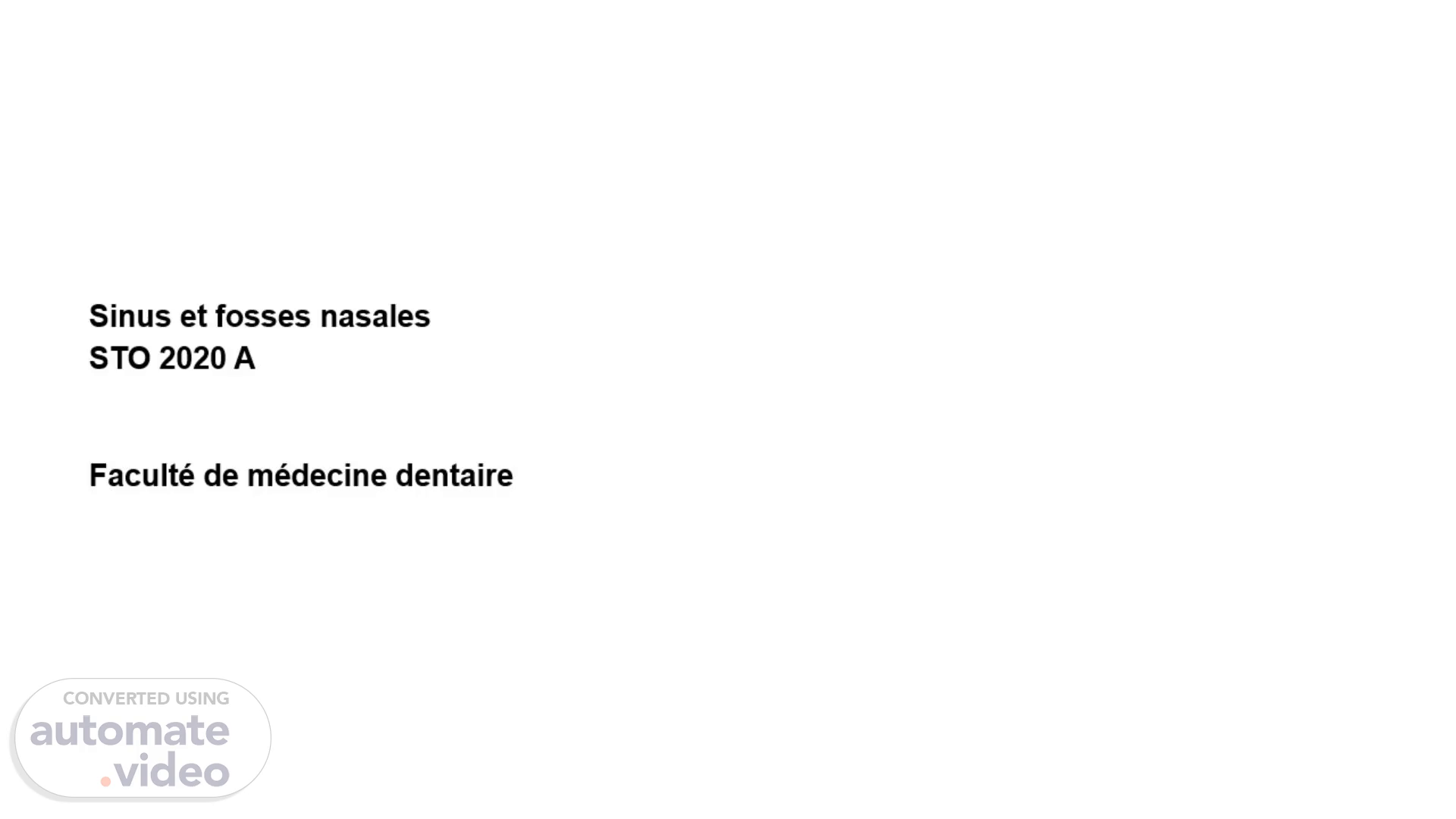Scene 1 (0s)
[Audio] Bonjour Nous allons en apprendre davantage sur les fosses nasales et les sinus paranasaux. C'est un sujet très important pour vous, futurs dentistes, parce que les sinus sont en relation directe avec les dents, surtout les molaires supérieures..
Scene 2 (18s)
[Audio] Le nez a trois fonctions principales : 1. L'odorat: - Le premier rôle du nez est l'odorat. C'est possible grâce au nerf olfactif. Le nerf olfactif est le premier nerf crânien. C'est un nerf sensoriel, qui naît directement du cerveau. 2. La filtration de l'air : La deuxième fonction du nez est de filtrer l'air. Les poils situés à l'entrée du nez, appelés vibrisses, retiennent les grosses particules. Plus à l'intérieur, la muqueuse nasale et le mucus retiennent les petites particules et les microbes. 3. Le réchauffement de l'air : a troisième fonction du nez est de réchauffer l'air avant qu'il n'atteigne les poumons. En hiver, à Montréal, lorsque vous inspirez un air glacé, ce sont les cornets, aussi appelés conchae, qui jouent ce rôle. Situés sur les parois latérales du nez, ils ressemblent à des étagères osseuses recouvertes de muqueuse. Ils augmentent la surface de contact entre l'air et la muqueuse. Ce contact permet de réchauffer et d'humidifier l'air froid avant qu'il ne descende dans la trachée et les poumons. onctions des sinus paranasaux Les sinus paranasaux sont comme des petites cavités d'air dans les os du visage. Ils ont plusieurs rôles : Ils allègent le poids du crâne. Imaginez si notre tête était pleine d'os massif – elle serait trop lourde ! Ils protègent les structures internes en cas de traumatisme. Ils donnent une résonance à la voix. C'est pour cela que chacun de nous a une voix unique. On ne sait pas exactement pourquoi cette fonction est vraiment importante, mais elle existe..
Scene 3 (3m 29s)
[Audio] Le nez externe est formé d'os et de cartilage. Os 1.Os nasaux 2.Processus frontal du maxillaire 3.Partie nasale de l'os frontal Cartilage a.Cartilages latéraux b.Cartilages alaires majeurs c.Cartilage septal d.Cartilages alaires mineurs On peut observer que la plus grande partie du nez externe est formée par le cartilage. Sur le plan clinique, c'est très important, car ces cartilages sont souvent impliqués dans les chirurgies esthétiques ou réparatrices du nez, comme la rhinoplastie.
Scene 4 (4m 3s)
[Audio] L'anatomie interne du nez, également appelée cavité nasale, peut être comparée à une maison mitoyenne : elle comporte une cloison médiane commune et deux cavités symétriques de chaque côté. Il y a donc une paroi médiane et deux parois latérales. Si vous regardez une radiographie frontale, vous verrez que les lignes jaunes représentent les limites de la cavité nasale. Le plancher est formé par le palais dur. Au niveau du toit, on trouve la plaque cribriforme, représentée ici en violet, et cette structure pointue appelée crista galli. Ces deux éléments appartiennent à l'os ethmoïde. L'os ethmoïde est un os très important car il sépare le cerveau, situé dans la fosse crânienne, de la cavité nasale située en dessous. Dans cette cavité, on trouve également deux projections en forme d'étagères appelées cornets : le cornet inférieur, ou cornet nasal inférieur, et le cornet moyen. Il existe également un cornet supérieur, mais il n'est pas visible sur cette image. Comme nous l'avons déjà vu, ces cornets sont situés sur la paroi latérale du nez et augmentent la surface de contact entre l'air et la muqueuse. Cela contribue à réchauffer et à humidifier l'air inhalé..
Scene 5 (5m 13s)
[Audio] Tout comme le nez externe, la paroi médiane du nez, ou septum nasal, est constituée à la fois d'os et de cartilage. Les principaux os qui composent le septum sont : le vomer, qui est un os impair, et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, qui appartient à l'os ethmoïde. Le cartilage principal est le cartilage septal. Cliniquement, c'est important à retenir : en cas de fracture avec un choc qui pousse le septum vers l'intérieur, il peut y avoir une fuite claire par le nez. Cette fuite correspond en réalité au liquide céphalo-rachidien, le LCR. C'est aussi pour cela qu'il y a du cartilage à l'avant : il est plus souple et s'effondre en premier, ce qui protège les structures osseuses situées plus en arrière Le bord inférieur du septum est continu avec le palais dur - à l'avant avec le maxillaire et à l'arrière avec l'os palatin..
Scene 6 (6m 6s)
[Audio] Parlons maintenant de la vascularisation du septum nasal. Le septum est une zone richement vascularisée, alimentée en sang par deux sources principales : l'artère carotide interne (ACI) et l'artère carotide externe (ACE). À partir de l'artère carotide interne, l'artère ophtalmique donne naissance aux branches septales de l'artère ethmoïdale antérieure et de l'artère ethmoïdale postérieure qui irriguent le septum. À partir de l'artère carotide externe, deux branches principales sont impliquées : l'artère faciale, qui envoie l'artère labiale supérieure vers l'avant pour irriguer la partie antéro-inférieure du septum, et l'artère maxillaire, qui envoie l'artère sphéno-palatine et l'artère palatine supérieure pour irriguer la partie postérieure du septum. Cliniquement, la zone la plus fragile est la partie antéro-inférieure, le plexus de Kiesselbach. C'est la cause la plus fréquente des saignements de nez, ou épistaxis. une anesthésie locale dans la région antérieure du maxillaire ou un traumatisme chirurgical peut facilement déclencher un saignement dans cette zone..
Scene 7 (7m 14s)
[Audio] L'innervation du septum nasal provient de trois nerfs crâniens. D'abord, le nerf olfactif, le premier nerf crânien, qui donne l'odorat dans la partie supérieure du septum. Ensuite, le nerf trijumeau assure la sensibilité : la branche ophtalmique, V1, par le nerf ethmoïdal antérieur, pour la partie antéro-supérieure, la branche maxillaire, V2, par le nerf nasopalatin, pour la partie postéro-inférieure. Enfin, le nerf facial, via le ganglion ptérygopalatin, apporte les fibres végétatives qui contrôlent la sécrétion de mucus. Donc, en résumé : le nerf I pour l'odorat, le V pour la sensibilité, et le VII pour la sécrétion Sur le plan clinique, il est important de retenir certaines choses. Si le nerf olfactif est endommagé, par exemple lors d'un traumatisme qui touche la lame criblée, le patient perd l'odorat. On appelle cela une anosmie. Si le nerf nasopalatin, qui vient de la branche V2, est atteint, par exemple pendant une chirurgie du palais ou lors d'une pose d'implant, le patient peut présenter une perte de sensibilité de la partie antérieure du septum. Enfin, l'innervation végétative par le nerf facial joue aussi un rôle important. Elle contrôle la sécrétion de mucus dans le nez. Quand cette innervation est trop active, cela peut provoquer une rhinorrhée, c'est-à-dire un écoulement nasal excessif. ».
Scene 8 (8m 43s)
[Audio] Passons maintenant à la paroi latérale du nez. Elle est formée de plusieurs os : l'os nasal, le processus frontal du maxillaire, l'os lacrymal, les cornets supérieurs et moyens, qui appartiennent au labyrinthe ethmoïdal, le cornet inférieur, la plaque perpendiculaire de l'os palatin, et enfin la plaque ptérygoïdienne médiane. Tous ces os s'assemblent pour former une paroi complexe et très importante. Sur le plan clinique, il est important de se souvenir des cornets nasaux. Comme nous l'avons vu précédemment, ils augmentent la surface permettant à l'air d'être réchauffé et humidifié. Lorsque ces cornets sont hypertrophiés, c'est-à-dire trop grands, ils peuvent bloquer la respiration et provoquer une obstruction nasale. Dans certains cas, une réduction chirurgicale des cornets peut être nécessaire..
Scene 9 (9m 35s)
[Audio] Tous les os que nous avons décrits précédemment sont entièrement recouverts d'une muqueuse respiratoire. Cette muqueuse est riche en vaisseaux sanguins et en glandes. C'est grâce à elle que l'air inspiré est réchauffé, humidifié et filtré avant d'atteindre les poumons. Quand il fait très froid dehors, par exemple –4 °C avec une humidité de 0 %, l'air est tout de même réchauffé et humidifié : dans le pharynx, il arrive à environ 31 °C avec 98 % d'humidité. Cela montre que, même s'il existe de grandes différences de température à l'extérieur, l'air qui atteint le pharynx arrive pratiquement toujours à la même température et au même degré d'humidité..
Scene 10 (10m 18s)
[Audio] Parlons maintenant de la vascularisation de la paroi latérale du nez. Comme pour la cloison nasale, l'irrigation sanguine provient de deux systèmes : l'artère carotide interne et l'artère carotide externe. Du côté de la carotide interne, on retrouve les mêmes branches que pour la cloison : l'artère ethmoïdale antérieure et l'artère ethmoïdale postérieure, toutes deux issues de l'artère ophtalmique. Elles irriguent la partie supérieure de la paroi latérale. Du côté de la carotide externe, il existe deux branches principales : d'abord, l'artère maxillaire, avec sa branche la plus importante, l'artère sphéno-palatine. Cette artère est la branche dominante pour la paroi latérale. ensuite, l'artère faciale, via l'artère labiale supérieure. Il n'y a pas de plexus de Kiesselbach dans la paroi latérale, la plupart des saignements proviennent de la partie postérieure de l'artère sphéno-palatine. Ceux-ci sont plus graves et plus difficiles à contrôler que les épistaxis antérieures provenant du septum..
Scene 11 (11m 24s)
[Audio] Examinons maintenant l'innervation de la paroi latérale du nez. Comme pour le septum, trois nerfs crâniens sont impliqués : le nerf olfactif pour l'odorat, le nerf trijumeau (V) pour la sensibilité, et le nerf facial (VII) pour l'innervation parasympathique, qui contrôle les sécrétions muqueuses. Pour la sensibilité de la branche V1 (ophtalmique), les nerfs ethmoïdaux antérieur et postérieur innervent la partie supérieure de la paroi latérale. Pour la branche V2 (maxillaire), l'innervation est assurée par les nerfs nasaux latéraux postérieurs, qui proviennent du ganglion ptérygoïdien, et par le nerf infraorbitaire pour la partie antérieure. Contrairement au septum, il n'y a pas de nerf nasopalatin ici, car celui-ci est spécifique au septum médian..
Scene 12 (12m 14s)
Paranasal sinus. 12.
Scene 13 (12m 21s)
[Audio] Voici les sinus paranasaux. Ce sont des cavités aériennes situées dans certains os du visage. Il y en a quatre paires principales : le sinus frontal, les cellules ethmoïdales, le sinus sphénoïdal et le sinus maxillaire. Le mot "para-nasal" veut dire "autour du nez". Ces cavités sont tapissées d'une muqueuse respiratoire et elles communiquent toutes avec la cavité nasale. ».
Scene 14 (12m 44s)
[Audio] La muqueuse des sinus est composée de plusieurs types de cellules : des cellules ciliées, qui battent pour pousser le mucus, des cellules caliciformes, qui fabriquent le mucus, et des cellules basales, qui renouvellent la muqueuse. Le mucus est évacué grâce à ce qu'on appelle le drainage muco-ciliaire, vers la cavité nasale et le nasopharynx..
Scene 15 (13m 6s)
[Audio] Ici, on voit le complexe ostéoméatal. C'est la zone clé pour le drainage des sinus frontaux, ethmoïdaux et maxillaires. Il comprend plusieurs structures : l'ostium maxillaire (1), qui est l'ouverture du sinus maxillaire, l'infundibulum (2), le passage qui relie le sinus au méat moyen, le hiatus semilunaris (3), où se rejoignent toutes ces voies de drainage, le récessus frontal (4), et la bulle ethmoïdale (5). Tout cela draine finalement dans le méat moyen (6). Cliniquement, c'est une zone très importante car un blocage ici peut provoquer une sinusite. ».
Scene 16 (13m 45s)
[Audio] « Le sinus frontal est situé derrière les arcades sourcilières. Il est absent à la naissance, il commence à se développer vers 7–8 ans, et sa croissance est terminée après la puberté. Il est rarement parfaitement symétrique. Le sinus frontal draine dans le méat moyen par le canal fronto-nasal. On distingue une table antérieure, une table postérieure, et parfois un septum intra-sinus qui n'est pas toujours au milieu. ».
Scene 17 (14m 11s)
[Audio] Les cellules ethmoïdales se trouvent dans le labyrinthe ethmoïdal, entre les orbites et la partie supérieure des fosses nasales. Elles se développent déjà pendant la grossesse. On distingue deux groupes : les cellules antérieures, qui drainent vers le méat moyen, et les cellules postérieures, qui drainent vers le méat supérieur. C'est une zone complexe et fragile, proche de l'orbite et du cerveau. ».
Scene 18 (14m 36s)
[Audio] Le sinus sphénoïdal est situé dans le corps de l'os sphénoïde. Il est petit à la naissance et se développe surtout après la puberté. Sa taille et sa forme varient beaucoup, et il est rarement symétrique. Il draine dans le récessus sphéno-ethmoïdal. Une sinusite sphénoïdale peut être grave, car elle peut compliquer en une thrombose du sinus caverneux. ».
Scene 19 (14m 58s)
[Audio] Le sinus maxillaire est le plus grand des sinus paranasaux, avec un volume d'environ 15 cc. Il est présent dès la naissance. Ses limites : en bas, la crête alvéolaire supérieure, donc proche des molaires, en haut, le plancher de l'orbite, médialement, la paroi nasale latérale, et en arrière, le processus zygomatique. Il draine dans le méat moyen par l'infundibulum. ».
Scene 20 (15m 24s)
[Audio] Pour les dentistes, le sinus maxillaire est très important. On le retrouve dans : les implants dentaires, l'élévation sinusale, les extractions dentaires, les fistules oro-antrales, les infections du sinus, et certaines chirurgies comme la technique de Caldwell-Luc. ».
Scene 21 (15m 41s)
[Audio] Cette diapo montre les rapports entre le sinus maxillaire et les racines dentaires. Il existe plusieurs types : dans certains cas, la racine est à distance du sinus, dans d'autres, la racine est très proche, voire dans le sinus. Les racines souvent concernées sont celles des deuxièmes et premières molaires maxillaires. Ceci explique pourquoi une infection dentaire peut atteindre le sinus, et pourquoi une chirurgie dentaire peut parfois ouvrir une communication avec le sinus. ».
Scene 22 (16m 9s)
Merci. Questions?? [email protected]. 22.
Scene 23 (16m 16s)
References. Images from anatomy.co.uk [email protected].