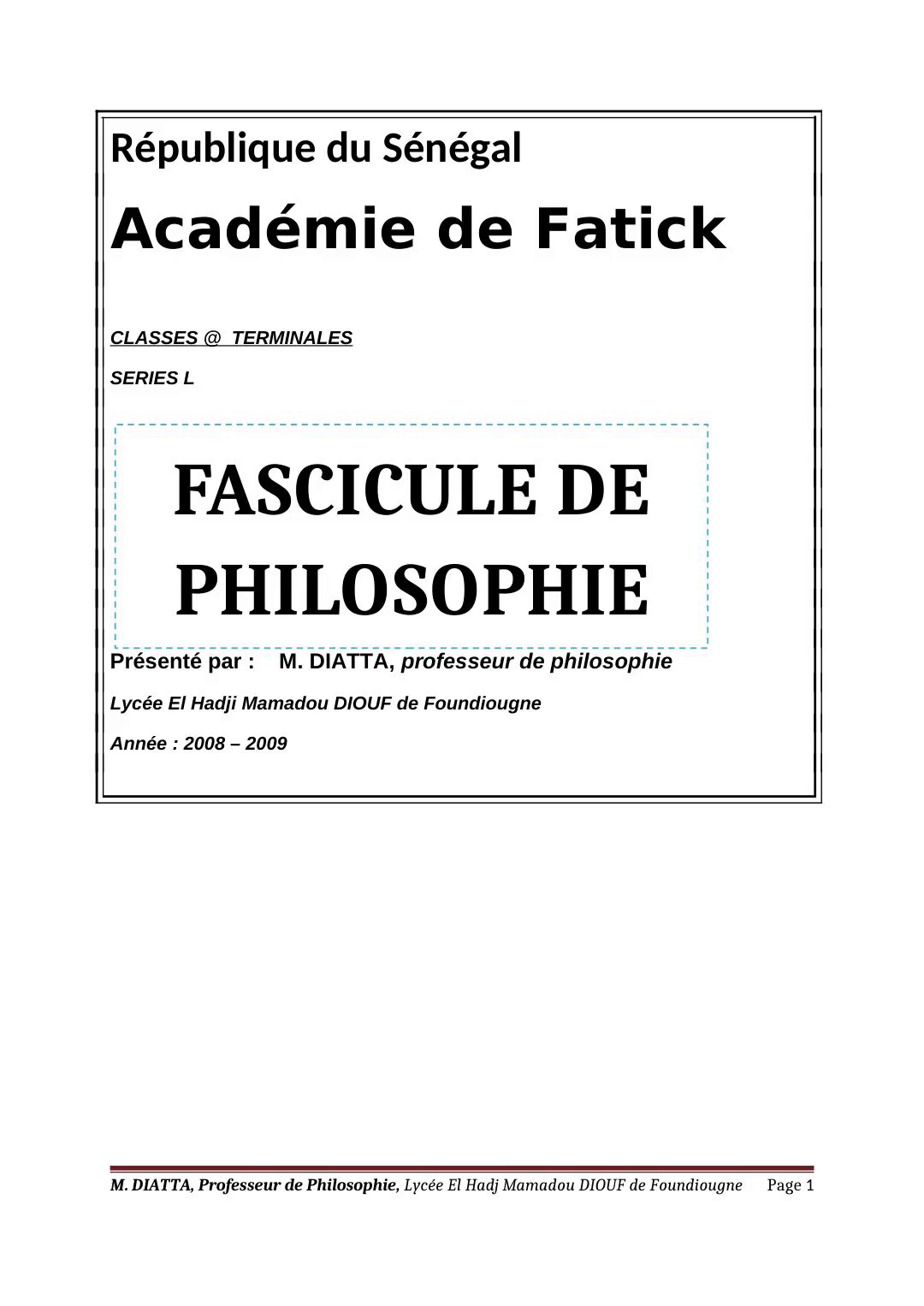Scene 1 (0s)
[Audio] République du Sénégal Académie de Fatick CLASSES @ TERMINALES SERIES L FASCICULE DE PHILOSOPHIE Présenté par : M. DIATTA, professeur de philosophie Lycée El Hadji Mamadou DIOUF de Foundiougne Année : 2008 – 2009 M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 1.
Scene 2 (30s)
[Audio] PROGRAMME DE PHILOSOPHIE Toutes séries L Domaine 1 : LA REFLEXION PHILOSOPHIQUE Chapitre 1 : Les origines et la spécificité de la réflexion philosophique Chapitre 2 : Les grandes interrogations philosophiques Chapitre 3 : Enjeux, finalités et perspectives philosophiques Chapitre 4 :L'idée d'une philosophie africaine DOMAINE 2 : LA VIE SOCIALE Chapitre 1 : Nature et Culture Chapitre 2 : Individu et Société Chapitre 3 : Conscience et Inconscient Chapitre 4 : La Liberté Chapitre 5 : L'Etat DOMAINE 3 : EPISTEMOLOGIE Chapitre 1 : L'émergence de la pensée scientifique Chapitre 2 : Les différents types de sciences Chapitre 3 : Science et Technique DOMAINE 4 : ESTHETIQUE Chapitre 1 : La représentation artistique Chapitre 2 : Fonctions et Formes de l'art ŒUVRES AU PROGRAMME TOUTES SERIES L DESCARTES, Discours de la Méthode PLATON , Ménon M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 2.
Scene 3 (1m 49s)
[Audio] DOMAINE 1 : LA REFLEXION PHILOSOPHIQUE Objectif Général : Il s'agit d'amener les apprenants, au terme de l'exploration de cette partie, à identifier les spécificités de l'activité philosophique comparativement aux autres domaines du savoir et de l'action, mais aussi de s'interroger sur les grands problèmes de l'existence comme la destinée, la mort ,le sens de la vie , etc. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 3.
Scene 4 (2m 23s)
[Audio] INTRODUCTION GENERALE A LA PHILOSOPHIE Considérations générales D'une manière générale, une introduction signifie ce qui prépare à la saisie d'une réalité nouvelle. Elle est par définition une entrée en matière voire une présentation. Une introduction est pour ainsi dire, une préface explicative, un guide, qui a pour objet de présenter les contours et caractéristiques propres à une question donnée. L'introduction à la philosophie pose cependant problème. En effet, introduire la philosophie supposerait que celle-ci existe d'abord et qu'elle soit localisable dans le temps et dans l'espace. De ce point de vue, la date et le lieu de naissance de la philosophie suscitent maintes réflexions et interrogations. Ainsi, par où commencer ? semble être la première difficulté à la définition de l'entreprise philosophique. S'agira-t-il de se situer en dehors de la philosophie pour l'introduire ou faudra-t-il simplement identifier et considérer à l'intérieur du dispositif philosophique, un intervalle, avec un premier point comme commencement, et un autre comme fin ? Une première observation nous amène à retenir l'attitude consistant à se situer en dehors du champ philosophique pour l'investir comme une voie intellectuellement parlant assez risquée. Car, le danger est effectivement grand d'assister à la production d'un discours dénaturé et non philosophique sur la philosophie. Une telle difficulté semble fonctionner comme un avertissement visant à dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité mieux indiquée pour introduire la philosophie que de partir de la philosophie elle – même. Mais, trouver le point de départ de la philosophie n'est –il pas déjà être dans la philosophie ?ce qui reviendrait à pouvoir désormais répondre de manière tranchée à la question : QU'EST – CE QUE LA PHILOSOPHIE ? La question inaugurale « QU'EST- CE QUE LA PHILOSOPHIE » est, il faut le reconnaître, difficile à prendre en charge puisqu'elle appelle en principe une réponse non équivoque de la philosophie. Non seulement la question est loin d'impliquer une réponse évidente et exhaustive, mais encore, l'entreprise philosophique reste un éternel questionnement où toute réponse hâtive, satisfaisante et unanimement partagée semble presque impossible. Voilà assurément une question qui vient de façon prématurée .En effet, comparée au physicien et au M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 4.
Scene 5 (4m 55s)
[Audio] mathématicien qui, en investissant leur objet d'étude commencent toujours par le définir, la question QU'EST – CE QUE LA PHILOSOPHIE devra provisoirement être mise entre parenthèses puisqu'elle vient très tôt investir un domaine où ne doivent tenir que le questionnement perpétuel et la remise en cause permanente. Dès lors, ne serait – il pas plus prudent de commencer l'introduction à la philosophie en essayant de répondre aux questions suivantes : Où commence la philosophie ? Quelles sont ses origines ? M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 5.
Scene 6 (5m 35s)
[Audio] Chapitre 1 : Les origines et la spécificité de la réflexion philosophique Il convient de souligner que le commencement est différent de l'origine. Si le commencement traduit le lieu ou moment qui a vu germer la philosophie pour la première fois et éventuellement le(s) géniteur(s), l'origine, quant à elle, constitue l'ensemble des conditions voire circonstances ayant favorisé l'avènement de la pensée philosophique. Dès lors l'introduction à la philosophie pourrait se satisfaire de la réponse aux questions suivantes : où est née la philosophie ? (question du commencement) ; d'où vient l'impulsion à philosopher ? (question de l'origine). I. Du commencement de la philosophie La détermination du lieu de naissance de la philosophie reste à n'en pas douter une question très controversée. Les thèses, en effet, abondent en la matière si bien qu'il est difficile de désigner une, qui serait victorieuse et aurait pris le dessus sur les autres et continuerait de se considérer comme systématique et irréfutable. Nombreux sont aujourd'hui les penseurs qui assignent à la philosophie une origine barbare. En effet, ce concept, loin d'être négativement chargé, signifiait chez les grecs, l'étranger. Les tenants de cette thèse avaient pour argument cardinal l'influence exercée par ceux qui n'étaient pas grecs(les barbares) sur les grecs. Cheikh Anta DIOP une des figures de proue ayant défendu cette thèse remarquait que les grecs ont puisé l'essentiel de leurs connaissances chez les BARBARES. Cependant, une telle conclusion semble être exempte de toute nuance. L'impossibilité à dire que les Egyptiens étaient déjà philosophes avant l'arrivée des grecs nous autorise à émettre des réserves face à cette considération .La réalité est qu'il faut éviter toute confusion entre le transfert culturel et la transposition. D'autres, par contre, attribuent à la Grèce antique, le commencement de la philosophie .Il s'agit bien de la tradition occidentale de la philosophie .Dans la crise de l'humanité européenne et la philosophie HUSSERL écrivait que c'est en Grèce antique qu' « est apparue une attitude d'un genre nouveau à l'égard du monde environnant ; il en est résulté l'irruption d'un type absolument nouveau de créations(…).Les Grecs lui ont donné le nom de philosophie ». L'affirmation de Martin HEIDEGGER selon laquelle « la philosophie est née en Grèce et qu'elle parle grec » doit être inscrite dans la même perspective. En excluant à d'autres peuples la possibilité de donner naissance à la philosophie, Diogène LAERCE réfute du même coup toute influence extérieure, du moins intellectuelle, sur les grecs. Il écrit dans Vies, Doctrines et Sentences des philosophes illustres qu' « en attribuant aux étrangers les propres inventions grecques tous ces penseurs pèchent par ignorance car les grecs n'ont pas donné naissance seulement à la philosophie mais au génie humain tout entier ». Par ailleurs, dans les Stromates Clément d'Alexandrie considère la philosophie non pas comme une invention humaine mais comme une partie du M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 6.
Scene 7 (8m 38s)
[Audio] Logos divin volé par un DIABOLOS. « Quelque puissance, écrivait-il, quelque ange a appris une bribe de vérité sans rester lui-même fidèle à la vérité, il a soufflé ses connaissances aux hommes .Il leur a enseigné le fruit de son vol ». Ainsi, convient-il de remarquer que si la philosophie ne pourrait et ne saurait être l'objet d'un vol ni du hasard alors son avènement est à chercher dans un ensemble de circonstances et conditions qu'il nous faut impérativement analyser avec munitie. II. LES Origines de la Philosophie Les origines de la philosophie sont multiples et diversement déterminées. Elles sont tributaires d'un contexte mythologique particulier, doublé d'une situation sociale, politique et intellectuelle favorable à l'éclosion de cette pensée rationnelle mais singulièrement nouvelle. 1. Le règne du mythe Dans sa tentative à cerner le sens de tout mystère se présentant à lui, l'homme fait usage d'une variété de formes de savoirs. Nous pouvons citer la religion, les arts, le mythe, etc. Cependant, notons que le mythe est la première réponse en tant que mode de savoir que l'intelligence humaine a fournie. Ainsi, nous entendons par mythe un récit fabuleux d'origine populaire dans lequel interviennent des agents ou êtres surnaturels mais à des fins symboliques. Procédant par image, le mythe comporte aussi une dimension Sacrée et prend dès lors la forme d'une cosmogonie. Cette dernière se définit comme une théorie légendaire qui a pour ambition de justifier l'origine et la formation de l'univers. Il est à remarquer que le mythe se présente sous diverses formes : il est cosmogonique lorsqu'il a pour fonction d'expliquer l'origine du monde ; il est dit anthropogonique lorsqu'il s'intéresse à l'origine des animaux dont l'homme, etc. Le spécialiste des religions Mircéa ELIADE définit le mythe comme un récit qui « raconte, relate non seulement l'origine du monde, des animaux mais aussi tous les événements primordiaux à la suite desquels l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire mortel, organisé en société obligé de travailler pour vivre, et travaillant selon certaines règles ». Dans le récit mythique, la nature souvent anthropomorphisée obéit aux caprices et à la volonté des divinités .Le mythe est en définitive présent partout où il y a des hommes ; ce qui nous fait dire que chaque société a sa propre mythologie ainsi qu'on le notait chez les peuples grecs, babyloniens, africains, etc. Il convient de retenir que si avec le mythe c'est toute l'humanité entière qui se trouvait encore plongée dans l'innocence et la torpeur, il faudra alors attendre l'irruption de la philosophie pour assister à son réveil de ce profond « sommeil mythique » pour reprendre Georges GUSDORF. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 7.
Scene 8 (11m 32s)
[Audio] 2. Du contexte socio-politique de la Grèce antique à la naissance de la philosophie La philosophie naquit en Grèce dans un contexte de profondes mutations tant au plan social et politique qu'à celui intellectuel. Le VIIe et le VIe siècles consacrent en Grèce antique la fin du règne mythique au profit d'une nouvelle forme de pensée. En effet, l'avènement de la philosophie est tributaire de conditions socio-historiques réelles comme l'apparition de certaines institutions : la monnaie, le calendrier, l'alphabet, etc. Ensuite la naissance d'une société cosmopolite écartelée dans ses fondements et ses valeurs traditionnelles explique également la naissance de cette pensée nouvelle. Ainsi, l'économie marchande très florissante dans les ports d'Asie Mineure favorisa l'émergence de nouvelles classes : d'où une libération active de la pensée. Quant au plan politique le pouvoir tyrannique et absolu est supplanté par la démocratie grâce à la naissance de la raison politique avec la Cité ou Polis .Dès lors la politique devient une invention proprement humaine ce qui, du coup, écarte les divinités de la gestion de la Cité. La naissance de l'Agora devenue le lieu par excellence où doivent désormais se prendre les décisions de la Cité, favorise l'enracinement de la démocratie considérée comme le meilleur régime pour l'épanouissement des athéniens. La démocratie, selon François CHATELET, « n'est pas seulement comme l'indique son étymologie, le pouvoir du petit peuple, mais le régime dans lequel le gouvernement est au milieu lorsque chacun est citoyen et en droit et en fait dans la capacité d'y participer ». Ce nouvel environnement social et politique caractérisé par le débat contradictoire ; la discussion libre et passionnée aura pour conséquence la libération de la pensée et la naissance inévitable d'un nouveau type de réflexion. Voilà qui justifie la conviction de Jean-Pierre VERNANT lorsqu'il écrit « les règles du jeu politique qui sont la libre discussion, le débat contradictoire, l'affrontement des argumentations contraires s'imposent comme règles du jeu intellectuel ».La philosophie, cette pensée nouvelle qui juge l'univers à l'œuvre de l'esprit critique et de la raison commence déjà avec les présocratiques. 3. Les présocratiques et la désacralisation du savoir Libéré de la naïveté et de l'aveuglement du mythe, l'homme jette un regard neuf sur l'univers grâce aux premiers efforts de la pensée rationnelle instaurée par les présocratiques .Ainsi, l'ordre naturel et les faits atmosphériques se présentent désormais comme des problématiques sur lesquelles la discussion est ouverte. En effet, ces premiers penseurs grecs se constituèrent en Ecoles. Le dénominateur commun de leurs recherches résident en la rupture d'avec les modes de pensée jusque là en vigueur comme, l'explication mythologique. Parmi ces Ecoles, nous avons entre autres : -L'Ecole Ionienne fondée par Thalès de Milet ; M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 8.
Scene 9 (14m 35s)
[Audio] -L'Ecole Italique dont le fondateur était Pythagore de Samos ; -L'Ecole d'Elée qui vit le jour avec Xénophane de Colon. 3.1 Les Milésiens A la question de l'origine de ce qui est, c'est-à-dire, de l'Etre, ces penseurs soutiennent l'existence d'un principe premier. Ainsi, plutôt d'expliquer le réel par des représentations anthropomorphiques les milésiens considèrent qu'il faut aller audelà de ces images et apparences encore confinées dans l'ordre de l'empirique. Autrement dit, pour comprendre un phénomène, il fallait désormais adopter une nouvelle attitude, celle qui consiste à examiner les différentes lois physiques qui concourent à son apparition. Ces physiologues de Milet à savoir Thalès (l'Eau), Anaximène (l'Air), et Anaximandre (la matière Infinie) ont en effet apporté un état d'esprit nouveau et légué à la postérité une méthode de pensée nouvelle, fondement de la science et de la technique. L'Ecole de Milet a par conséquent joué un rôle majeur dans la naissance de cette pensée rationnelle. Ces philosophes, tous originaires de la Cité de Milet (en Ionie, région maritime de l'Anatolie).avaient institué cette Ecole, l'une des premières à proposer sur l'univers une réflexion libérée des récits de la mythologie grecque. Aux explications cosmogoniques qui faisaient de l'ordre du monde le résultat de luttes entre les « puissances » primordiales et des exploits de quelques figures héroïques, les « physiciens » de Milet(en ce qu'ils s'intéressent essentiellement à l'évolution du monde physique) opposent une réflexion désacralisée sur l'ordre cosmique. Sceptiques à l'égard des explications surnaturelles de l'origine du monde, ils entendent soumettre cette question à la réflexion humaine. Le renversement de perspective est de taille : alors que la pensée mythique entend expliquer le monde des hommes et de la nature en retraçant les évènements premiers qui ont produit le cosmos, c'est à partir des connaissances disponibles que les Milésiens cherchent dans un sens inverse, à comprendre la formation du monde et son évolution. 3.2 Les Italiques Pythagore et ses disciples développent une approche plus abstraite du cosmos et s'éloignent ainsi de ce qui relève de la matière. Le NOMBRE est selon eux à l'origine de tout ce qui est, car tout est mesurable, « tout est Nombre ». 3.4 Les Eléates A coté des Milésiens et des Pythagoriciens, d'autres penseurs grecs vont influencer de manière considérable, la naissance de la philosophie. Les Eléates les plus connus sont Héraclite, Parménide, Empédocle et Anaxagore. -Héraclite défendait le Devenir comme le principe des choses. « On ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve », disait-il, pour faire ainsi de la mobilité et du changement, les éléments explicatifs de la phusis. Que tout change constamment de forme, tel était, selon lui, le trait caractéristique de la nature. Nous M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 9.
Scene 10 (17m 37s)
[Audio] pouvons peut-être avancer qu'Héraclite faisait plus confiance aux sens que Parménide. Il est alors le théoricien du « Panta Rhei » (« tout s'écoule »).Tout s'écoule disait Héraclite, tout est en mouvement et rien n'est éternel. Sans le jeu constant entre les contraires, le monde n'existerait plus. -Parménide va prendre le contre pied du Devenir héraclitéen et fonde la philosophie de l'Etre ou l'Ontologie. Selon Parménide « l'Etre est le non-être n'est pas » ; ce qui signifie que l'Etre est Impérissable, Immobile et Infini donc non engendré. Son travail philosophique consista à mettre en évidence la trahison des sens sous toutes ses formes. Cette foi inébranlable dans la raison de l'homme au détriment du changement perpétuel que nous offrent nos sens, cela s'appelle le rationalisme. Un rationaliste est celui pour qui la raison est la source de toute connaissance du monde. -Si Empédocle a été le tenant des quatre éléments qui seraient à l'origine de l'univers à savoir l'Eau, l'Air, le Feu, et la Terre, Anaxagore lui, fait du noùs, principe intelligent et spirituel, l'élément fondamental à la base de tout ce qui existe. Dès lors, nous pouvons affirmer qu'avec les Présocratiques, c'est une histoire nouvelle qui s'ouvre pour la philosophie. 4. Les Sophistes Pour s'adapter à la métropole de la raison, il fallait avoir une conception pragmatique et mercantiliste de la vie. Le pouvoir et le prestige social constituent désormais les seules motivations du peuple athénien au grand détriment de la pensée. L'important était de savoir parler et bien parler c'est-à-dire être fort en rhétorique. La Rhétorique est l'art de convaincre par la puissance du Verbe et de rendre vraisemblable tout discours à des fins utiles. En clair, la rhétorique connote l'art de bien parler, la technique de la mise en œuvre des moyens d'expression. Des penseurs pour l'essentiel Grecs étaient reconnus comme de véritables sophistes. Le Sophiste est par définition celui à l'image du sage grec, a fait profession d'enseigner la sagesse et l'habileté. Autrement dit, le sophiste est l'homme habile ou l'homme savant en quelque matière. Il est également celui qui a l'art de rendre les hommes supérieurs à ce qu'ils sont par l'emploi d'arguments valides en apparence, mais en réalité faux puisque servant à faire illusion aux autres. PROTAGORAS un des sophistes les plus célèbres de la Grèce antique avait l'habitude de dire que : « l'homme est la mesure de toute chose ».Ce subjectivisme intellectuel tant clamé par ce sophiste révèle qu'il n'y a donc plus de valeurs universelles communes aux hommes. CALLICLèS et TRASYMAQUE défendent l'idée que l'homme ne saurait reconnaître d'autres lois que son caprice et sa passion. Voila pourquoi les sophistes Protagoras, Hippias, Ménon, Gorgias, Prodicus, entre autres, furent considérés comme de véritables maîtres ou orfèvres de la parole .Le sophisme est pour ainsi dire un raisonnement souvent oral sans aucune solidité ni contenu sérieux. Quant à la sophistique, elle signifie une dénaturation de la philosophie puisque constituant M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 10.
Scene 11 (20m 53s)
[Audio] l'ensemble des doctrines ou plus exactement l'attitude commune des principaux sophistes Grecs que SOCRATE va renverser. Mais, qu'est-ce qu'alors la philosophie, cette forme de pensée nouvelle, cette attitude révolutionnaire dont Pythagore osa se réclamer pour la première fois ? III. Tentative de définition de la philosophie Qu'est-ce que la philosophie ? Le philosophe ne peut pas répondre d'emblée à cette question. Y répondre, proposer une définition de la philosophie, ce serait dire qu'on peut savoir ce qu'elle est sans en avoir jamais fait l'expérience, sans s'être mis soi-même à philosopher. Or la question : « qu'est-ce que la philosophie ? » est déjà une question philosophique. Le mathématicien qui se demande ce que sont les mathématiques n'est pas en train de faire de s mathématiques ; de même pour l'historien qui se demande ce qu'est l'histoire. Le philosophe se demandant ce qu'est la philosophie est déjà en train de philosopher. La réponse à cette question, c'est donc, en un sens, l'ensemble du cours qui l'apportera. Il s'agit de se mettre soimême à philosopher, et non de découvrir « du dehors » en quoi consiste la philosophie. Mais, examinons cette question en commençant par l'étymologie du concept de PHILOSOPHIE. 1. La conception étymologique de la philosophie L'étymologie grecque renseigne dès l'abord sur le contenu et la mission de la notion de philosophie. En effet, issue du grec « philein » (aimer) et « Sophia » (sagesse), la philosophie peut être littéralement traduite comme Amour de la sagesse. Cependant cette signification comporte une première ambiguïté dûe au double sens de la « sagesse » ; car, la philosophie n'est pas la sagesse. Ainsi la Sophia signifiait chez les grecs un art de vivre mais aussi un savoir. Cette double signification amène à distinguer la sagesse contemplative ou spéculative de la sagesse pratique. En effet, dire que la sagesse est un art de vivre c'est identifier l'homme sage comme celui qui se conduit de manière raisonnable. Il s'agit en clair de celui qui évite toute démesure et, qui accueille avec sérénité les épreuves en essayant de vivre en intelligence avec son milieu et avec lui-même. Ce que l'homme de la foule retient ordinairement de la sagesse, c'est qu'elle préconise une vie étriquée, affaiblie, « assagie », une vie « raisonnable »menée à pas comptés. Vivre sagement ce serait vivre sans prendre de risques, calmer les ardeurs, briser les passions. D'autre part, la sagesse peut être identifiée au savoir. Dès lors le sage devient celui qui possède une connaissance ou un certain nombre de savoirs. Est sage par conséquent, celui qui totalise une connaissance encyclopédique. Sans doute le premier aspect – pratique – n'est-il pas dissociable du second : tout effort pour élaborer une règle de vie, pour adopter une attitude réfléchie et M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 11.
Scene 12 (23m 56s)
[Audio] responsable implique une réflexion critique et une interrogation sur les conditions de possibilité d'un savoir. Il y a néanmoins un contraste entre cette forme de sagesse populaire et la sagesse dite socratique. Toute la différence entre la philosophie et la sagesse réside dans le fait que le philosophe, contrairement au sage tel défini plus haut, n'est pas celui qui détient un savoir. Voilà pourquoi, par philosophie comme Amour de la sagesse, nous entendons l'expression du désir de l'homme à découvrir partout et de tout temps la vérité. En clair, il s'agit de l'effort pour comprendre l'univers dans son ensemble. Le philosophe n'est qu'un amant de la sagesse. IL est donc celui qui est seulement à la quête du savoir. La philosophie prise au sens étymologique signifie alors, recherche ininterrompue de la vérité. A la différence de la sagesse, la philosophie peut être définie comme une recherche rationnelle, une réflexion critique qui a pour objet la compréhension générale de l'homme et de l'univers. Dans les principes de la philosophie, DESCARTES écrit : « par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts ». Le philosophe étant un amant toujours insatisfait, la philosophie comme activité reste et demeure une recherche et non une possession définitivement constituée et stockée quelque part où l'on viendrait s'abreuver. Dans Introduction à la philosophie, Karl JASPERS dégage cette forte conviction lorsqu'il écrit: « la philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en un savoir mis en formules, définitif, complet. Faire de la philosophie c'est être en route; les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question ». Il ressort de cette remarque de Jaspers que vouloir consigner la philosophie, vouloir en faire un savoir stable qui se transmettrait de génération en génération, c'est tuer la philosophie ; car cela relève du dogmatisme. En effet, d'essence critique, la philosophie ne saurait dès lors se confondre avec le dogmatisme qui apparaît selon André LALANDE comme une « tournure d'esprit qui consiste à affirmer ses doctrines avec autorité, et sans admettre qu'elles puissent avoir quelque chose d'erroné. »(in VTCP).C'est du reste ce refus de considérer la philosophie comme un savoir déjà constitué ou comme un héritage qui poussa Emmanuel KANT à affirmer qu' « on n'apprend pas la philosophie on apprend simplement à philosopher ». (KANT, Annonce du programme des leçons de M.E KANT durant le semestre d'hiver (1765-1766). C'est donc dire qu'on ne saurait s'exercer à l'activité philosophique comme on s'adonnerait aux sciences exactes. Car, le raisonnement mathématique requiert l'assentiment de tout un chacun en ce que ses preuves sont évidentes alors qu' « en philosophie, écrit KANT, chaque penseur bâtit son œuvre sur les ruines d'une autre ; mais jamais aucune n'est parvenue à devenir inébranlable en toutes ses parties ».Il s'agit de se mettre soi-même à philosopher. Ce qui se joue dans un cours de M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de {Foundiougne Page.
Scene 13 (27m 19s)
[Audio] philosophie est moins l'apprentissage de ce que d'autres hommes, les « philosophes »,bizarres ou fascinants, ont pu penser, que l'acquisition par soi-même d'une démarche philosophique .Il s'agit de découvrir quels échos les pensées et les œuvres des philosophes peuvent trouver en nous, compte tenu de notre expérience et des questions qui nous habitent. Mais, que signifie par ailleurs la philosophie aux yeux de l'homme du commun en général ? 2. Philosophie et sens commun Il convient de reconnaître que la philosophie ne saurait se définir aussi simplement à partir de ses vocables constitutifs (philein & Sophia).En effet, notre question « qu'est-ce que la philosophie » appelant une définition ou plus exactement la définition de la philosophie ne peut pas être hélas immédiatement satisfaite du moins de manière rigoureuse, neutre et globale. Toute réponse à la question « qu'est-ce que la philosophie » est très souvent partiale ou partielle et même dérive en une réponse qui n'engage pas la philosophie. Cette dernière remarque traduit en effet toutes les considérations négatives voire simplistes du sens commun sur la philosophie. De la théorie vague aux élucubrations d'un esprit inquiet qui se cherche et ne se retrouvant pas en passant par la figure du philosophe tenu pour un absent ou pour quelqu'un qui se fabrique son propre monde oubliant celui dans lequel il vit, retenons simplement qu'une telle présentation fait de la philosophie une activité frivole, un jeu intellectuel déroutant et subversif. En effet, pour le théologien, la philosophie est tout simplement l'affaire du diable ; pour le savant ou l'homme de science, la philosophie renvoie à la rêverie et à la théorie purement et simplement tandis que le politique qualifie la philosophie d'activité subversive en ce sens qu'on n'y parlerait que de révolution et de sexe. Toutefois, une condamnation si négative et préjudiciable à la philosophie ne peut être que hâtive et non avenue. Car, ce serait manifestement faire preuve d'une méconnaissance de l'entreprise philosophique. Ainsi, toute argumentation tendant à récuser la philosophie n'est que vaine prétention. La conclusion qui se dégage de tout cela est que si la définition de la philosophie pose problème c'est bien parce qu' « on tient pour acquis ce qui est encore en question ». Voilà pourquoi à la question (légitime) de savoir qu'est-ce que la philosophie, il serait plus prudent de dire comme SOCRATE « je ne sais pas ». 3. La révolution socratique « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien » ; cet apophtegme a fini par être le credo de SOCRATE. En effet, voilà une réponse certes négative et laconique, mais qui reste très féconde. Cela a pour justification le fait qu'elle ouvre la voie à la recherche. Selon SOCRATE, reconnaître qu'on ne sait pas, être conscient de son in-science, c'est effectivement entreprendre de savoir. Si par sagesse on reconnaissait la possession d'un savoir, l'unique preuve de sagesse devient pour SOCRATE l'humilité en matière de connaissance. C'est M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 13.
Scene 14 (30m 31s)
[Audio] sans aucun doute à travers cette nouvelle conception socratique de la sagesse, c'est-à-dire dans la conscience du non-savoir qu'il faut chercher les origines de la philosophie. 3.1 SOCRATE et les origines de la philosophie Les origines de la philosophie se résument essentiellement chez SOCRATE en ces trois vocables : Etonnement, Doute et Bouleversement. Dans le Théétète, PLATON fait remarquer que « la philosophie n'a pas d'autres origines que l'étonnement ».Renvoyant au grec « thaumazein », s'étonner signifie opérer un renversement .Le philosophe apparaît sous ce rapport comme l'homme qui prend la ferme résolution de ne plus s'encombrer des explications toutes faites. Il exerce ce renversement par rapport au mythe d'abord et à toutes les connaissances irrationnelles comme la magie et la religion mais aussi par rapport aux préjugés et à l'opinion. Nous entendons par préjugés, les connaissances déposées en l'individu par le bais de l'éducation sans qu'il ait pu y exercer sa faculté de jugement critique pour discerner le vrai du faux. Quant à l'opinion ou doxa(en grec), elle peut être définie comme le jugement collectif qu'une société porte sur une réalité quelconque ; c'est donc une croyance populaire. Dire que l'origine de la philosophie c'est l'étonnement, c'est reconnaître du même coup que l'insolite ne fascine plus le philosophe, mais mobilise son intelligence et suscite en lui un éternel questionnement. S'étonner, c'est accueillir ce qui nous surprend, c'est être ouvert et disponible, attentif au réel. L'étonnement nous sort de l'enfermement dans le cercle de nos préoccupations quotidiennes. L'étonnement est bien plus qu'une simple curiosité : il ébranle tout notre rapport au monde. S'étonner, c'est être rejoint par une surprise quant à l'étrangeté du monde et de notre condition. S'étonner, c'est déjà désirer comprendre. On le voit, le champ de la philosophie recouvre potentiellement la totalité de l'existence humaine. Le philosophe allemand Emmanuel KANT, a proposé de ramener la totalité du champ philosophique à trois questions fondamentales : 1. Que puis-je savoir ? 2. Que dois-je faire ? 3. Que m'est-il permis d'espérer ? Et enfin, une quatrième question subsidiaire qui, écrit KANT, ne fait finalement que résumer les trois autres, au point que pouvoir réellement répondre à cette quatrième question, ce serait du même coup avoir répondu à toutes les questions philosophiques. Cette question est la suivante : 4. Qu'est-ce que l'homme ? C'est pourquoi écrit Merleau PONTY « le philosophe est l'homme qui s'éveille et qui parle, et l'homme contient silencieusement les paradoxes de la philosophie, parce que, pour être tout à fait homme, il faut être un peu plus et un peu moins qu'homme. » M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 14.
Scene 15 (33m 21s)
[Audio] Les explications toutes faites du déjà là ne satisfont plus l'inquiétude de l'homme. Qui suis-je ?d'où tout cela me provient-il ? « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien » ? S'interrogeait LEIBNIZ. C'est alors cet étonnement, cet émerveillement dont parlait aussi ARISTOTE qui formera chez le philosophe, l'esprit critique et le Doute. Il y a lieu cependant de faire la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Il s'agit de comprendre par l'esprit critique l'attitude qui consiste à aller audelà des apparences voire des évidences premières des phénomènes. Quant à l'esprit de critique, il est celui nuisible à la recherche en ce qu'il remet tout en cause sans proposer quelque chose à la place. Le doute en ce qui le concerne, est l'attitude consistant à émettre des réserves par rapport à une réalité donnée en vue de vérifier le bien fondé ou non de la chose en question .Comme l'esprit critique, le doute devient la clé de la recherche philosophique. Dès lors, une connaissance, pour être acceptée comme telle, devra nécessairement passer par le purgatoire du doute .Aussi, devrait-on noter qu'il y a une différence notoire entre le doute philosophique et le doute sceptique ou dit autrement, le doute radical. Par ailleurs, l'idéal socratique, cette entreprise de remise en cause de toute une WELTANSCHAUNG ne sera possible que lorsque l'homme accepte le Bouleversement. Il s'agit de bouleverser les mentalités et les habitudes afin de donner un sens nouveau à la vie. Philosopher, c'est se remettre en question et notre entourage aussi. Se mettre à philosopher, c'est donc comme s'éveiller d'un long sommeil. Car avoir vécu, c'est certes avoir une matière sur laquelle réfléchir, mais c'est aussi avoir contracté des habitudes, s'être habitué à bien des choses qui par conséquent n'étonnent plus, c'est aussi avoir accumulé un certain nombre d'idées(venant de notre entourage, de notre famille, de nos professeurs, de notre classe sociale, de notre culture…)à propos de ces choses. La philosophie n'intervient pas sur un terrain vierge. Philosopher, c'est s'interdire de penser quelque chose sans être capable de rendre compte, à soi-même et à autrui, des raisons pour lesquelles on pense cela plutôt qu'autre chose. Ainsi, le bouleversement doit désormais être une lutte continue contre l'opinion, la superstition et tout ce qui relève du conformisme. Le bouleversement sera de ce point de vue exercé contre toute Autorité et toute Tradition pour ne devenir enfin qu'une vigilance permanente. C'est à cette insurrection contre l'ordre établi, au bouleversement profond des sociétés que nous convie SOCRATE, lui qui considère la philosophie non plus comme un enseignement doctrinal, mais seulement comme une leçon de méthode. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 15.
Scene 16 (36m 14s)
[Audio] 3.2 Comprendre la philosophie par l'exemple : le dualisme platonicien PLATON s'appelait Aristoclès. A 29 ans il fut témoin de la condamnation de son maître SOCRATE .Qu'Athènes puisse condamner à mort l'homme le plus éminent de la ville non seulement le marqua à jamais, mais déterminera toute l'orientation de sa pratique philosophique. A cela s'ajoute l'instabilité politique d'Athènes tributaire de la guerre du Péloponnèse ; l'un et l'autre conduisirent enfin PLATON à rechercher de nouvelles valeurs culturelles, morales et politiques. Il fonda ainsi l'Académie. Son œuvre fut importante car étant plus de 25 ouvrages en forme de dialogues. On peut noter le Ménon, la République, le Gorgias, le Protagoras, le Banquet, le Sophiste, le Lachès, le Philèbe, le Timée, etc. Cependant pour comprendre la philosophie platonicienne, il nous faut faire un retour à SOCRATE. En effet, combien il est difficile de parler de ce dernier si l'on sait qu'il n'a jamais écrit. A la différence des sophistes, SOCRATE n'avait pas d'Ecole. Ainsi, peut-on affirmer sans risque de nous tromper que SOCRATE n'a pu se poser qu'en s'opposant d'abord aux sophistes. Mais Qui est SOCRATE ? Comment est-il venu à la philosophie ? Quelle est sa philosophie ? « Tout ce que je sais, avait-il l'habitude de dire, c'est que je ne sais rien ».D'où lui vient alors cet intérêt particulier à discuter avec les gens d'Athènes et démasquer leur croyance aveugle ou ignorance ? Dans l'Apologie de SOCRATE, PLATON nous renseigne que l'affaire est d'origine divine. L'oracle de DELPHES avait désigné SOCRATE comme étant l'homme le plus sage des Athéniens. Se prêtant à la vérification de la parole de l'Oracle par une enquête qu'il mena lui-même auprès des populations athéniennes, SOCRATE se rendit compte que tous ses interlocuteurs étaient des ignorants. L'ignorant en effet n'est pas celui qui ne sait rien, mais celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. SOCRATE venait ainsi de comprendre qu'il est investi d'une mission très difficile. Démasquer la fausse sagesse des sophistes ignorants mais aussi réveiller les consciences endormies dans le sommeil des préjugés et de l'opinion, telle est la conception que SOCRATE se fait de la philosophie. A l'image de la mouche, SOCRATE va embarrasser par ses questions interminables. Rappelons que philosopher, c'est considérer que rien ne va de soi et que tout ce qui joue un rôle dans une existence mérite d'être interrogé. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 16.
Scene 17 (38m 56s)
[Audio] 3.3 La méthode socratique SOCRATE inaugure une méthode originale tant par son procédé que par sa fonction. Sa méthode se distingue du coup de la méthode des sophistes qui procédaient par transmission unilatérale du savoir. Mais d'où lui vient cette pratique nouvelle de la philosophie ? La réponse se trouve dans le Théétète. Fils du statuaire Sophronisque et de PHENARETE la sage- femme, SOCRATE était bien soigneusement éduqué. En effet, si le travail d'une sagefemme consiste à aider les femmes à mettre au monde leurs enfants, de la même façon, pense SOCRATE, le philosophe doit-il aider son concitoyen à sortir ce dont son esprit est gros. C'est là toute la signification de la maïeutique qui selon Socrate est l'art de faire accoucher les esprits. Il convient de préciser que cette maïeutique ou ironie socratique ne consiste pas seulement à convaincre l'autre de son ignorance ; elle vise surtout à montrer à son interlocuteur qu'il porte en lui des vérités mais seulement qu'il ignore. Par un jeu de question /réponse, Socrate amenait son interlocuteur à avouer non seulement son non-savoir mais aussi et surtout à chercher par soi-même la bonne réponse. Philosopher est ce que nul ne peut faire à ma place puisque la vérité n'est inscrite nulle part ; donc à nous de jouer, à nous de penser. La ressemblance éloquente entre le métier de la sage-femme et l'activité philosophique consacre dès lors la méthode inaugurale que Socrate introduisit dans le dispositif philosophique. 4. PLATON et la théorie de la connaissance Pour le citoyen de Collytos, apprendre n'est plus synonyme de réception passive de connaissances comme le pratiquaient les sophistes. Apprendre signifie pour PLATON se ressouvenir, c'est donc une Réminiscence. En effet, dans le Lachès de PLATON, Socrate semble dire à ses interlocuteurs « ne désespérez pas car chacun a les moyens de se sauver lui-même de l'ignorance coupable, pour vu qu'il veuille regarder de lui-même ».Par ailleurs, il faut remarquer que cette théorie dite de la connaissance chez PLATON est exposée dans le livre X de la République plus connue sous le nom du mythe d'ER ou allégorie de la caverne ou même dans le Ménon, œuvre du reste au programme. PLATON y expose le parcours que notre âme a connu avant d'échoir dans le corps humain. L'oubli qui a frappé l'âme explique pourquoi une fois dans le monde sensible, celle-ci éprouve d'énormes difficultés à contempler la vérité et prend dès lors les apparences pour des vérités à la manière des prisonniers de la caverne dont parlait PLATON dans la République VII. En effet, dans ce texte PLATON compare ce monde d'ici-bas à des prisonniers enchaînés dès leur naissance dans une demeure souterraine. Le visage tourné vers la paroi, ils sont dans l'impossibilité de voir autre chose que cette paroi. Derrière eux se trouve allumé un feu. Entre le feu et la caverne passe une route et sur celle-ci défilent des individus de différentes sortes. Le feu projette sur la paroi de M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 17.
Scene 18 (42m 6s)
[Audio] la caverne les différentes images des personnages qui défilent sur la route. Ces prisonniers prennent pour des réalités les images projetées sur la paroi. Pour PLATON, la situation des hommes d'ici-bas est identique à celle des prisonniers de la caverne. En effet, dans ce monde les hommes sont esclaves de leurs sens. Enfermés dans l'obscurité du monde de la matière en perpétuel devenir et enchaînés qu'ils sont par les préjugés, les hommes n'essaient pas d'aller au- delà des apparences que leur donnent leurs sens. PLATON appelle ce monde : le Monde Sensible. Ce monde est celui des apparences, des images, des reflets, des illusions, des ombres et des copies. Mais une ombre ne s'expliquant que par ce dont elle est ombre, PLATON est obligé de passer par le Monde Intelligible. On comprend dès lors les difficultés, les peines qui attendent l'homme qui voudra bien gravir la pente à la lumière du prisonnier libéré pour contempler l'essence des choses. Un tel homme sera, en effet, semblable à l'Albatros dont parlait Baudelaire, tombé sur le navire des hommes et se trouvant dans l'incapacité de marcher à cause de ses ailes de géant. Ainsi, cet homme, cet Albatros, ce prisonnier libéré de la caverne, c'est précisément le philosophe qui a suffisamment pris du recul par rapport à la société pour y jeter un regard critique et non complaisant. Cette élévation de l'esprit pour la connaissance des Idées, PLATON, l'appelle la Dialectique ascendante. Mais une fois ce recul opéré, le philosophe doit revenir dans sa Cité pour faire comprendre aux hommes que l'apparence des phénomènes n'est rien par rapport à la réalité des choses. Sa mission sera de guérir les hommes de leur cécité intellectuelle. Ce retour dans la société, Platon l'appelle la dialectique descendante. Il s'agit dans ce cas pour le philosophe de se donner pour mission fondamentale de libérer ses compatriotes des illusions dont ils vivent, de les délivrer des préjugés et de la doxa pour les conduire vers la lumière, siège de la Vérité et du Bien. Cependant, cette noble mission suppose un préalable, celui d'exercer sur soimême la critique. C'est à cela que conviait l'injonction delphique à travers le fameux «connais- toi toi- même » ! Dans les Méditations cartésiennes Edmond HUSSERL éclairait sur l'exigence qu'il fallait pour être philosophe. Il écrit : « le philosophe doit se replier sur soi- même et au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici et tenter de les reconstruire ».C'est aussi cette entreprise de Destruction/Reconstruction que systématisera DESCARTES dans sa recherche de la vérité. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 18.
Scene 19 (44m 48s)
[Audio] PHILOSOPHIE ET SCIENCE INTRODUCTION La conception étymologique de la philosophie « Amour de la sagesse » laisse entrevoir une réelle confusion entre la science et la philosophie. C'est pourquoi Louis Althusser ne s'est pas empêché de voir dans Lénine et la philosophie une relation organiquement constituée entre la philosophie, dans sa genèse comme dans son évolution, et la science. Aussi l'histoire des idées semble bien attester ce rapport dialectique entre philosophie et science quand on sait que depuis sa naissance, la philosophie n'a cessé d'apparaitre comme la mère des sciences. Toutefois, les sciences dites particulières vont progressivement se détacher de la tutelle de la philosophie, ce qui ouvre ainsi l'avènement de la science moderne définie par André LALANDE comme un « ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité, de généralité, susceptibles d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels qui leur sont communs, mais de relations objectives qu'on découvre graduellement, et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies.» Nous analyserons à travers cette réflexion les différentes péripéties qui ont jalonné et continuent encore d'animer l'histoire de la philosophie et de la science en termes de rapports. I. La conception encyclopédique de la philosophie Depuis les grecs jusqu'au XVIIe siècle la philosophie se présentait comme une véritable encyclopédie de l'ensemble des savoirs .A vrai dire, la philosophie englobait la science dans sa diversité ; elle paraissait en effet comme la mère des sciences, comme le savoir qui englobait tous les autres savoirs. C'est très exactement sa prétention encyclopédique qui justifie ce qu'il convient d'appeler l'arbre cartésien. En effet, dans les principes de la philosophie DESCARTES écrivait : « toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale ». Le caractère transversal des esprits d'alors ne souffrait d'aucune contestation. Seulement, pour arriver à une pratique consacrée de la philosophie, Platon recommandait au préalable une assise ferme de culture mathématique. Au fronton de son Académie, il était inscrit que « nul n'entre ici s'il n'est géomètre ».La prétention de la philosophie au savoir total pouvait bien se comprendre dans la mesure où elle contenait en germe toutes les autres connaissances. Aristote soutenait cette conception encyclopédique si bien qu'il définissait le philosophe comme « celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible ». M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 19.
Scene 20 (47m 35s)
[Audio] Cependant, la dimension globalisante de la philosophie va connaitre son épilogue à partir de l'instant où survint la grande césure entre elle et les sciences particulières. Cette césure consacrera dès lors la révolution copernicienne. II .La naissance de la science moderne Le détachement des sciences s'est réalisé de manière progressive au fil des siècles. Toutefois il faudrait souligner que, nous sommes de nos jours, très loin de cette conception encyclopédique de la philosophie. En effet, ces sciences se sont progressivement libérées de l'impérialisme de la philosophie dès lors qu'elles ont pu clarifier leurs principes, leurs objets et leurs méthodes. Notons cependant que cela fut rendu possible grâce à l'efficacité du langage mathématique et de la méthode expérimentale. Ainsi, au XVII siècle, la physique avec GALILEE va se détacher de la philosophie ; au XVIIIe siècle, il reviendra à la chimie de se constituer avec LAVOISIER tandis que la biologie attendra le XXe pour voir son rayonnement éclater avec Claude BERNARD .De même, les sciences humaines très récentes, du reste , verront le jour lorsqu'elles ont pu se démarquer de la spéculation philosophique. A c e titre, la sociologie par exemple, comme science humaine ou sociale naitra avec les précurseurs de cette branche, lesquels ont pour noms : Auguste COMTE et Emile DURKHEIM. Dès lors, la philosophie qui se voulait un savoir ou à la limite un pouvoir devrait plutôt prononcer son oraison funèbre et laisser les hommes évoluer sans elle .Le savoir et le pouvoir sont incontestablement détenus aujourd'hui par la science et la technique. Le divorce des sciences d'avec la philosophie s'avère plus illustratif lorsque le monde assista au XXe siècle à un développement spectaculaire du fait des progrès scientifiques remarquables. BERTHELOT, le scientiste, invitait les hommes à faire totalement confiance à la science, tant il est vrai que la science semble être capable de répondre à toutes les questions auxquelles les hommes sont confrontés. Toutefois, il convient de revoir à la baisse l'exaltation, somme toute, hyperbolique de la science .En effet, la puissance démesurée de la science ainsi que l'espoir exagéré de ses adeptes nous amènent à être plus regardant et éviter ainsi de décréter l'inutilité de la philosophie. En clair, l'homme n'a-t-il pas enfin compris après quatre siècles qu'il est temps de le considérer autrement, puisqu'il n'est pas que matière, mais aussi et surtout pensée ? M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 20.
Scene 21 (50m 12s)
[Audio] III. Philosophie et science : deux pôles complémentaires. Proclamer la mort de la philosophie reviendrait à ignorer fondamentalement les rapports dialectiques qu'il y a entre la philosophie et la science .En réalité, la philosophie et la science deviennent de plus en plus liées et cessent de s'exclure radicalement en dépit de leurs dissemblances méthodologiques. En effet, le rôle de la philosophie reste de maintenir les problèmes en discussion et d'en approfondir ou d'en renouveler les données mais non pas d'en venir à bout. C'est à juste raison que notait Karl JASPERS lorsqu'il écrivait : « la philosophie sous toutes ses formes doit se passer du consensus unanime. Ce qu'on cherche à conquérir en elle, ce n'est pas une certitude scientifique, (…), c'est un examen critique au succès duquel l'homme participe de tout son être ». La science moderne, quant à elle, confère à l'homme un pouvoir indubitablement exorbitant. Ainsi lui est-il donné la possibilité d'explorer et de dompter l'espace qui l'entoure. Par ses énormes progrès, la science a considérablement transformé la vie de l'homme ainsi que son milieu .Jean ROSTAND ne disait-il pas que « la science a fait des hommes des dieux » ? Aujourd'hui, les progrès de la médecine permettent de repousser la mort qui jadis plaçait l'être humain dans l'impuissance. Mieux, la pratique de l'eugénisme corrobore cette idée de la maîtrise que l'homme a de son environnement, et de son organisme jusque dans ses parties les plus infimes. Cependant, il convient de souligner que si la science transforme le vécu quotidien de l'homme, la philosophie prend à son tour position et constitue une réflexion critique sur les fondements du savoir en général et de la science en particulier. Tandis que les sciences en effet- aujourd'hui nettement différenciéessont progressives et admettent des solutions certaines et universellement tenues pour vraies, la philosophie reste selon COURNOT dans Essai sur les fondements de nos connaissances au chapitre XXI « enfermée dans un cercle de problèmes qui restent au fond toujours les mêmes et qui ont pour point commun de n'être pas soumis au contrôle de l'expérience ». La philosophie prend dès lors du recul par rapport à la science lorsque qu'elle va au-delà du caractère miraculeux et fascinant de l'arme nucléaire, du machinisme excessif en passant par les manipulations génétiques pour poser les enjeux éthiques qu'impliquent les découvertes scientifiques. A cela s'ajoute le réchauffement de l'atmosphère créé à l'occasion sur l'environnement, à cause de l'action de l'homme. Georges GUSDORF notait à ce propos que « les découvertes les plus extraordinaires de la physique en appellent toujours à une instance métaphysique ou philosophique dan la mesure où elles demandent chaque fois à être reclassées dans l'humain ».Ainsi la destruction de la couche d'ozone, le clonage sont devenus aujourd'hui de réels problèmes qui justifient du reste, l'apparition de comités d'éthique dans les pays où la science a atteint un degré de maturité M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 21.
Scene 22 (53m 21s)
[Audio] Texte : De l'émancipation des sciences L'organisation du savoir a cessé depuis longtemps d'être monarchique. Aux siècles de foi et d'autorité, la théologie était la reine des sciences. La philosophie était sa servante ou plutôt, comme gémissait Kant, sa suivante alors que la philosophie, observait-il, n'a qu'un service à rendre : précéder et non pas suivre, marcher en tête des disciplines, tracer o u éclairer leur route. La philosophie fut promue à son tour, libérée, intronisée. De servante elle devint maîtresse, exerçant son règne sur l'ensemble des savoirs particuliers. Mais ceux-ci ne devaient pas tarder à s'émanciper ; de sorte que la philosophie a subi le même sort que la théologie. Elle a perdu son sceptre et son principat le jour où les savants ont secoué sa tutelle. Cette destitution a été progressive. Les sciences de la nature ont conquis leur autonomie les premières. Les sciences de l'homme ne se sont affranchies que récemment. Le meilleur atout de la science nouvelle consiste même dans l'homogénéité grandissante de ses méthodes, quels que soient les champs explorés, quelle que soit l'hétérogénéité des objets qu'elle cherche à maîtriser. H.DUMERY M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 22.
Scene 23 (54m 45s)
[Audio] Chapitre II LES GRANDES INTERROGATIONS PHILOSOPHIQUES Objectif général : Les spéculations qui conduisent le penseur à s'habituer à élever sa pensée au dessus des choses concrètes et sensibles ne semblent pas de nature à corriger les préjugés défavorables véhiculés sur la philosophie. Ainsi, l'objectif général recherché dans l'étude de ce chapitre consiste à amener les apprenants à savoir répertorier et expliciter les grandes interrogations que soulève la philosophie en direction de l'homme, de la nature et de l'existence en général, etc. Tous ces domaines sont, à vrai dire, investis par la philosophie à travers ce qu'il convient de retenir par les interrogations, métaphysique, anthropologique et axiologique. Le dénominateur commun de ces différentes interrogations est que celles-ci placent l'homme au centre de leurs débats ; ce qui du coup mobilise ici notre attention. Leçon 1 :L'interrogation métaphysique « Il y a une science qui étudie l'Etre en tant qu'être, et les attributs qui lui appartiennent essentiellement .Elle ne se confond avec aucune des autres sciences dites particulières, car aucune de ces autres sciences ne considère en général l'être en tant qu'être, mais découpant une certaine partie de l'être ».Aristote, la Métaphysique (vers 345 av. J.C.), traduction de J. Tricot, Ed. Vrin, 1981, tome I, livre I, pp.171-175. Introduction La métaphysique ou philosophie première vise la connaissance de ce qui est en dehors de la réalité sensible et empirique. En effet, le terme métaphysique fut forgé par Andronicos de Rhodes. Par l'emploi de ce concept il désignait l'ensemble des œuvres d'Aristote en l'occurrence celles qui venaient après les œuvres qui portaient sur la physique. Ainsi, l'expression grecque Meta – ta – phusica signifie à la fois ce qui vient après la physique, mais aussi ce qui se trouve au-delà de la physique .Dès lors ce qu'il convient d'appeler ici par débat étymologique implique que : quelque soit le sens considéré, la métaphysique se trouve toujours en dehors de la physique et traite de questions que la science ne peut pas aborder. En conséquence, si la science répond à la question du comment, la métaphysique en revanche examine celle du pourquoi des phénomènes. C'est pourquoi la métaphysique peut être définie comme la science des principes premiers, c'est-à-dire, des principes à partir desquels toutes nos connaissances tiennent leur certitude et leur unité. La métaphysique dépasse la démarche descriptive et explicative de la science limitée au monde sensible. La métaphysique porte sur les questions, eschatologique, téléologique et archéologique. Au demeurant, il convient de préciser que l'interrogation métaphysique en tant que partie essentielle de la réflexion philosophique n'a pas connu un égal traitement dans l'histoire de la philosophie. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 23.
Scene 24 (57m 47s)
[Audio] I .La possibilité de la connaissance métaphysique La recherche métaphysique est une vieille question de la philosophie. Depuis Platon déjà on notait les balbutiements de l'interrogation métaphysique. Mais sa systématisation ne sera effective qu'avec Aristote, le stagirite. 1. Aristote et la recherche du premier principe Un principe, archê chez les grecs, n'est pas ce qui commence d'exister mais ce à partir de quoi commence d'exister tout ce qui existe. En effet la métaphysique se présente chez Aristote comme la science de l'être en tant qu'être, c'est-àdire l'ontologie. Il écrit à ce propos : « S'il n'y avait pas d'autre substance que celle constituée par la matière, la physique serait la science première. Mais il existe une substance immobile ; la science de cette substance doit être antérieure et doit être la philosophie première et elle est universelle de cette façon parce que première et se sera à elle de considérer l'être en tant qu'être c'est-à-dire à la fois son essence et les attributs qui lui appartiennent en tant qu'être ». Alors que les sciences particulières comme les mathématiques, la biologie, la chimie, la physique, etc. n'étudient qu'une portion de l'être, la philosophie première étudie l'être dans sa totalité, sans ses déterminations particulières. L'être en tant qu'être est Forme Pure, Acte Pur, Premier Moteur. Ainsi, il est immobile et source de tout mouvement. Voilà pourquoi chez Aristote, la philosophie première est appelée ontologie mais aussi « recherche des causes premières et des principes premiers ».Cependant, le mérite d'Aristote aura été d'avoir ouvert un horizon important qui continue encore de préoccuper les temps modernes notamment le XVIIe siècle avec Descartes. 2. La métaphysique comme fondement des connaissances: l'arbre cartésien Dans son itinéraire Descartes avait pour mission de trouver un fondement inébranlable à la philosophie qui englobait jusque là la science. Le fondement c'est précisément la métaphysique. « Toute la philosophie, écrivait-il, est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique ». Pour Descartes, la métaphysique n'est ni le sommet, ni le point d'aboutissement du savoir. Elle constitue alors la sève à partir de laquelle les autres sciences se nourrissent et se développent et fondent leurs certitudes. Par ailleurs, si Descartes ne conteste pas la métaphysique aristotélicienne, il soutient cependant que le principe premier de la métaphysique c'est la pensée. L'être de la métaphysique cartésienne c'est l'être de la pensée, l'être du sujet pensant. C'est donc l'existence de cet être qui permet de déduire les autres principes comme l'existence de Dieu en tant que source et garant de la vérité. Toutefois, la métaphysique qui prend en charge la question de l'origine de l'univers et de la vie a M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 24.
Scene 25 (1h 0m 49s)
[Audio] été fortement discréditée puisque considérée d'autre part comme une connaissance inutile et dépassée. II. Les critiques de la métaphysique 1. La métaphysique comme un état transitoire Selon Auguste COMTE l'explication métaphysique est comprise entre l'explication théologique et l'explication scientifique. L'histoire en général ou l'esprit humain en particulier est passé selon COMTE de l'état théologique à l'état métaphysique pour échoir finalement dans l'état positif. Ce développement successif de l'esprit humain a été retenu sous le vocable de la « théorie des trois états ». L'état théologique fait référence à un être surnaturel pour expliquer tout phénomène qui se produit. Ainsi la tempête sera expliquée par un caprice du dieu du vent Eole. Il renonce à la métaphysique ou à la recherche des causes premières et des fins dernières. Ce qui est important à son niveau c'est de pouvoir décrire comment les phénomènes se produisent et donc de découvrir les lois qui expliquent leurs enchaînements logiques. Une loi veut dire un rapport interne et nécessaire entre les phénomènes. Dès lors la métaphysique devient aux yeux d'Auguste COMTE un état futile et inutile. Elle est tout simplement un état transitoire donc intermédiaire entre un point de départ et un point d'arrivée. La métaphysique est en ce sens dépassée et frappée d'anachronisme. C'est pourquoi écrivait ce tenant du positivisme : la métaphysique « est une sorte de maladie chronique naturellement inhérente à notre évolution mentale individuelle ou collective entre l'enfance et la virilité ». La métaphysique est ainsi invitée à disparaître. 2. L'impossibilité à connaître la chose en soi : le point de vue kantien KANT fait remarquer l'existence de deux mondes : le monde phénoménal et le monde nouménal. Le monde phénoménal est en effet le monde par excellence des reflets et des images des choses. Alors que celui appelé nouménal est le siège de la chose en soi. Or chaque monde correspond à un type de connaissance en fonction des conditions qui rendent celle-là éventuellement possible. Quelles sont les connaissances rencontrées dans le monde phénoménal ? Dans ce monde phénoménal, nous retrouvons entre autres les vérités scientifiques et morales. Leurs conditions de possibilité sont l'espace et le temps. En effet toute connaissance rationnelle doit selon Kant s'effectuer dans un cadre spatio-temporel ou suivant les catégories de l'entendement que sont l'espace et le temps. Ainsi selon Emmanuel KANT il n'y a de connaissance rationnelle que celle qui s'effectue dans les limites de l'espace et du temps. La question qui se pose dès lors à nous est celle de savoir si une connaissance transcendant le monde phénoménal est possible ? En d'autres termes, la raison M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 25.
Scene 26 (1h 3m 39s)
[Audio] peut-elle saisir le noumène c'est-à-dire la chose en soi ? En clair, une connaissance métaphysique est-elle possible ? L'ambition ou la tentative pour la raison d'appréhender le noumène sera fortement critiquée par KANT. Pour lui, Platon, Descartes ou Spinoza en s'élevant au dessus du monde sensible ne faisaient que jouer au visionnaire. En effet, pense –t-il, pour connaître, la raison a nécessairement besoin d'un appui ; ce qui est impossible dans le monde nouménal. Voilà pourquoi Kant considère que les connaissances métaphysiques sont illusoires et chimériques. Car, la raison, privée d'un point d'appui solide prend l'apparence d'être folle. Elle se perd de ce point de vue dans des antinomies. Le reproche fait à la métaphysique et notamment à Platon, conduit le philosophe de Königsberg à établir cette comparaison: « la colombe légère qui dans son libre vol fend l'air dont elle sent la résistance pourrait s'imaginer qu'elle volerait bien mieux encore dans le vide C'est ainsi que Platon se hasarda sur les ailes des Idées dans les espaces vides de la raison pure. Il ne s'apercevait pas que malgré ses efforts il ne faisait aucun chemin puisqu'il n'avait pas de point d'appui ou il pût appliquer ses forces ». Comme la colombe, Platon pense qu'en fuyant la réalité sensible, il arriverait à la connaissance véritable des phénomènes. Il ne se rendait pas compte qu'en dehors de l'expérience sensible, la raison ne peut rien dire d'exact. L'activité métaphysique tourne « à vide » : la prétendue « intuition intellectuelle » ne peut être le fait de notre esprit humain impuissant par sa structure même à saisir par vue directe un objet suprasensible. Il s'agit d'accomplir un équivalent de « Révolution copernicienne » dans l'ordre du savoir. Cependant, préférant la théologie à la connaissance métaphysique, Kant avouait dans la préface à la seconde édition de la critique de la raison pure que : « j'ai dû abolir le savoir pour laisser place à la croyance ». M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 26.
Scene 27 (1h 5m 42s)
[Audio] CONCLUSION La réflexion sur le sens de l'interrogation métaphysique a révélé un profond désaccord entre les penseurs ? Platon, Descartes, saint- Thomas D'Aquin et Aristote entre autres soutenaient l'importance voire le caractère indispensable de la recherche métaphysique en ce sens qu'elle sert de fondement à toute connaissance. Mais cet enthousiasme sera de courte durée puisque d'autres par contre verront à l'image de CARNAP que « les énoncés de la métaphysique sont dénués de sens ». Ainsi si pour COMTE l'interrogation métaphysique est une maladie de l'intellect humain, KANT en revanche, prétend que la quête métaphysique relève de la folie. En effet ce discrédit de la métaphysique se retrouve encore chez voltaire qui considère que la métaphysique n'a aucune valeur et doit être qualifiée simplement d'un jeu puéril ou pis encore comme un dialogue de sourds. Il notait à cet effet que : « quand un homme parle à un autre homme qui ne le comprend pas et que le premier qui parle ne comprend plus : c'est la métaphysique ».Cette critique contre la métaphysique sera d'ailleurs plus vivace avec Nietzsche qui, parlant de la métaphysique considère que « la croyance fondamentale des métaphysiciens c'est la croyance en l'antinomie des valeurs » (in Par- delà le Bien et le Mal). Cependant, il convient de noter que ces critiques acerbes contre la métaphysique ne sauraient lui ôter toute sa valeur dans l'existence de l'homme. La métaphysique aura le mérite d'avoir au moins agité un type d'interrogation qu'aucune discipline ne peut prendre en charge. Mieux, le développement prodigieux des sciences et techniques ne peut en aucune façon tuer et remplacer cette interrogation. Car, ce qui est réel et mérite d'être retenu c'est qu'en dépit de toute critique « l'homme est un animal métaphysique » ainsi que le remarquait Schopenhauer. Enfin ,face à la métaphysique, ne faudrait-il pas comprendre qu'il n'y a aucun moyen de combler ce pressant besoin ,qui est plus qu'un simple désir de savoir, mais une sorte de maîtresse bien ingrate à laquelle on est obligé de revenir. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 27.
Scene 28 (1h 7m 55s)
[Audio] Leçon 2 : Les interrogations, anthropologique et axiologique I. L'ANTHROPOLOGIE Introduction A qui entreprend de réfléchir sur l'existence, il peut sembler tentant sinon logique de commencer par se demander ce que signifie l'Homme en général. Ainsi entendu comme science qui étudie l'homme, l'anthropologie tente de répondre à une curiosité. L'histoire du savoir n'a pas pris en charge dès l'origine une telle préoccupation, du moins de la même manière. Cela explique en effet, la naissance très récente de l'anthropologie qui n'est apparue qu'au XVIIIe siècle. Cependant, il faut noter que l'anthropologie comprend deux grandes parties essentiellement : l'anthropologie physique et l'anthropologie sociale. Cette dernière qu'il s'agira d'analyser corrélativement aux sciences humaines, retiendra surtout notre attention. Dès lors en nous apprenant que l'objet de cette science naissante est l'homme, elle ne nous dit presque rien, puisque tout le problème dans l'étude de l'anthropologie est de savoir ce qui, de l'homme, peut être objet de science. 1. Anthropologie et sciences humaines Apparue récemment comme savoir qui se veut scientifique, l'anthropologie se comprend mieux à travers l'étude des sciences humaines. L'anthropologie sociale souvent dénommée anthropologie culturelle englobe en effet l'ethnographie et l'ethnologie. L'ethnographie est l'étude descriptive et classificatrice des différentes civilisations, notamment, à ses débuts, celles des sociétés dites « primitives », par opposition aux sociétés occidentales économiquement développées. L'ethnologie est la science qui, partant le plus souvent des phénomènes observés par l'ethnographie, cherche à en fournir une explication. A l'instar de l'anthropologie, les sciences humaines portent aussi leurs réflexions sur l'homme. Mais si les études fournies à partir des sciences humaines font de l'homme leur principal objet, elles diffèrent cependant de l'anthropologie. En effet la limite que l'on peut observer dans les sciences humaines c'est précisément ceci : l'homme est étudié dans le temps et dans l'espace, à certains évènements, à certains peuples ou à certains individus. Quant à l'anthropologie, elle se veut une science qui embrasse tout l'homme c'est à dire l'homme dans La totalité de ses manifestations. C'est à ce titre que M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 28.
Scene 29 (1h 10m 20s)
[Audio] Claude Lévi-Strauss écrivait parlant de l'anthropologie qu'elle : « vise à une connaissance globale de l'homme embrassant son sujet dans toute son extension historique et géographique aspirant à une connaissance applicable à l'ensemble du développement ; et tendant à des conclusions, positives ou négatives mais valables pour toutes les sociétés humaines. » 2. Anthropologie et excès idéologiques L'anthropologie sociale est une science qui se fixe comme mission l'étude des règles de conduite et comportement d'un groupe d'individus mais encore ses croyances et coutumes. Voilà qui pousse à considérer que l'anthropologie est profondément ancrée dans les éléments culturels d'un peuple comme d'une civilisation. En effet, cette forme de science a vu son essor aux Etats- Unis. Là, elle connut un développement sans précédant lorsqu'elle soutiendra que chaque peuple possédait une culture dès l'instant qu'il est admis un groupe et une communauté. Cependant, il faut dire que cette conception ne sera pas sans controverses. La culture devient dès lors objet de controverse et du coup beaucoup de théories ont été construites à propos. Nous avons entre autres l'ethnocentrisme, la théorie primitive et la théorie des évolutionnistes. -L'ethnocentrisme consiste à prendre sa propre culture comme modèle de référence pour juger les autres. Dans le cas de l'anthropologie, cela pose le problème de l'objectivité du chercheur. Le risque très grave qui peut surgir dans ces manières de penser c'est de ravaler l'autre au stade le plus bas de ce qui fait l'humanité de l'homme. C'est pourquoi lorsque Hegel affirmait dans Leçons sur la philosophie de l'histoire (1837-1840), qu' « on ne peut rien trouver (dans le nègre) qui rappelle l'homme », il s'agit de voir par là une méconnaissance réelle qu'il témoigne de ce que sont les autres. Ce qui peut du reste être à l'origine de conséquences graves comme les épurations ethniques constatées çà et là dans le monde entier. - La théorie primitive : elle naît de la colonisation. En effet, pendant cette époque les anthropologues de l'univers culturel occidental n'ont pas hésité de développer des théories racistes faisant état de la supériorité de certaines cultures sur d'autres. En réalité la diversité culturelle est l'émanation des réalités propres à chaque milieu social. Ainsi, plutôt de s'exclure ou de rejeter l'autre, les cultures devraient en revanche cohabiter, car aucune d'elle ne vaut plus qu'une autre. -Les évolutionnistes sont les tenants de la doctrine selon laquelle l'humanité est soumise à une évolution en permanence. L'humanité serait ainsi passée, selon eux, de l'état sauvage à la civilisation en passant par la barbarie. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 29.
Scene 30 (1h 13m 9s)
[Audio] L'EVOLUTION DE L'HUMANITE Les # phases Types Humains Outillage Type de civilisations Paléolithique archaïque Apparition des Australopithèque Galet aménagé 3 M à 600 000 premières structures d'habitations Paléolithique inférieur Découverte du Pithécanthrope Biface hachereau feu 600 000 ans à 150 000 ans Paléolithique moyen Homme de Lames, Inhumation Neandertal 150 000 à 40 000 ans Naissance de l'art Paléolithique supérieur 40 000 à 10 000 ans L'homme moderne homo sapiens Lames, Lamelles travail de l'os L'ho Epipaléolithique 10 000 ans Début de la sédentarisation mme moderne Jusqu'au début du Microlithes, burins, ractoirs grattoirs, etc. Néolithique 3. Philosophie et Anthropologie Philosophie et anthropologie sont deux disciplines proches mais différentes à bien des égards. En effet, philosophie et anthropologie portent toutes les deux sur un objet unique : elles ont « la connaissance globale de l'homme », comme préoccupation majeure. Toutefois, l'opposition entre philosophie et anthropologie tient à une différence méthodologique. C'est donc la méthode qui les distingue. L'anthropologie parait plus scientifique et plus objective tandis que la philosophie reste subjective, normative et générale en ce sens qu'elle cherche le plus haut degré de perfection de l'homme... L'anthropologie prend d'autre part M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 30.
Scene 31 (1h 14m 53s)
[Audio] l'homme comme un objet empirique qu'il peut étudier grâce à des méthodes d'investigations expérimentales. Les anthropologues se livrent à l'étude et à la comparaison des différentes cultures ou encore des rapports qui lient les hommes aux multiples formes prises par leur socialisation, au sein des groupes où ils vivent. II. L'AXIOLOGIE Pour la philosophie, l'homme reste et demeure « une idée dont aucune investigation objective, aucune enquête empirique si rigoureuse soit-elle » ne peut rendre compte de manière exhaustive. En effet, l'homme est un animal profondément complexe si bien qu'il faut encourager la multiplicité des points de vue s'agissant de son étude. Voilà pourquoi l'étude scientifique que les anthropologues entendent faire de l'homme sans référence aucune à la métaphysique ou philosophie première, ni à l'axiologie relève d'une simple illusion. D'où le sens de l'interrogation axiologique. Celle-ci peut être définie comme étant l'étude critique portée sur les valeurs. La valeur d'une chose est son aspect désirable, ce qui fait que la chose est estimée. Admettons que la vérité, les règles morales, les normes sociales d'un peuple sont des valeurs qui n'ont de sens que dans ces sociétés. Les faits n'ont, en vérité de signification, souligne GRANGER que si on leur en donne (in Pensée formelle et Sciences de l'homme). C'est bien pour cela que l'objet de l'axiologie consiste à voir ce qui doit véritablement être considéré comme vérité, comme valeur morale, comme normes à privilégier ; mais aussi qui détient la vérité ainsi que les valeurs morales ? Ainsi, nous pouvons retenir en définitive que l'axiologie pose le problème éminemment philosophique de la relativité des valeurs. Qu'est-ce qui mérite d'être considéré Comme valeur ? Voilà tout le sens de l'interrogation axiologique. La philosophie et l'axiologie s'intéressent dès lors à ce que doit être l'homme pour se réaliser au mieux en dehors ders observations et analyses objectives de la science. Peut- on pour autant espérer atteindre un jour une connaissance « totale » de l'homme ?peut-être… !Certainement à la seule condition de multiplier indéfiniment les analyses comparatives. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 31.
Scene 32 (1h 17m 12s)
[Audio] Chapitre III : Enjeux, finalités et perspectives philosophiques Objectif général : Les élèves doivent être capables de donner des indications précises sur l'état actuel de la philosophie et ses perspectives. Leçon : L'état actuel de la philosophie au regard de la diversité des systèmes philosophiques « Qu'est-ce que la philosophie ? Quelles sont les leçons de ces amis de la sagesse ?à les entendre ne les prendrait-on pas pour une troupe de charlatans criant chacun de son coté sur la place publique : venez à moi, c'est moi seul qui ne trompe point ! » ROUSSSEAU M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 32.
Scene 33 (1h 17m 55s)
[Audio] Introduction Quand on observe l'histoire de la philosophie, elle apparaît comme une scène où les acteurs ne cessent de s'affronter les uns, les autres. Un tel constat autorise sans doute des interrogations sur la valeur même de cette discipline. C'est pourquoi se demande-t-on très souvent, si la diversité des philosophies n'est pas un argument qui milite contre la philosophie .En clair, que vaut cette réflexion considérée .par plus d'un, comme la traduction parfaite de l'humanité de l'homme, si elle s'avère incapable de tenir en un seul discours formel et constitué ? Quel sens accorder à cette pensée nouvelle si elle ne semble pouvoir se justifier que lorsque chaque philosophe remet en cause totalement ou partiellement les philosophies antérieures et nourrit du même coup l'ambition secrète de mettre fin à la philosophie ? Pour prendre en charge une telle difficulté, nous allons nous y consacrer en explorant le déploiement effectif de l'activité philosophique à travers l'histoire des idées. I. L'histoire de la philosophie Un bref survol de l'histoire panoramique de la philosophie nous permet d'emblée de faire le constat suivant sur la philosophie : Depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, la philosophie semble offrir une présentation éclectique voire d'un ensemble décousu. Déjà dès l'Antiquité, Héraclite s'opposait avec Parménide sur le principe premier des choses. Constatant la mobilité des choses, Héraclite soumettait le monde au changement perpétuel, donc au devenir et au mouvement tandis que Parménide y voyait l'intervention d' un ETRE : d'où sa théorie de l'ontologie (science de l'être en tant qu'être). Platon pensera avoir résolu cette opposition entre Héraclite et Parménide et proposa une nouvelle conception du monde. Il considérait en effet que si Héraclite et Parménide ne s'entendaient pas sur la question de l'Etre qui EST, c'est parce qu'ils étaient encore restés prisonniers du monde sensible. Il fit alors recours au monde intelligible pour dépasser, estimait-il, leur opposition. Mais cette conviction platonicienne sera de courte durée puisqu'elle sera très vite contestée par son disciple Aristote. En effet la critique aristotélicienne portait sur la théorie des Idées développée par Platon. Aristote ne partageait pas la conviction de Platon consistant à dévaluer le monde sensible au profit d'un autre intelligible. Car, dira-t-il, ce n'est pas l'Idée d'Homme, le Concept ou l'Essence d'homme ou l'Homme en soi qui engendre les hommes particuliers. En clair ce n'est pas l'homme en soi qui engendre Achille mais son père Pelé. Il écrivait à ce propos : « on peut avoir de l'affection pour ses amis et pour la vérité. Mais la moralité consiste à donner la préférence à la vérité ». M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 33.
Scene 34 (1h 20m 45s)
[Audio] Pourtant l'assurance aristotélicienne sera combattue au XVIIe siècle par Descartes. Le père de la Logique (Aristote) faisait figure d'Autorité dans le discours philosophique. Ainsi, on a longtemps pensé que celui-là qui avait énoncé les principes (règles ou lois) de la raison ne pouvait jamais se tromper. L'Argument d'Autorité du « Magister » va s'effondrer pour laisser place au Doute cartésien. Hélas ! Le projet philosophique de Descartes ne sera pas du goût de Pascal son compatriote français, lui qui considérait Descartes « d'incertain et d'inutile ». Descartes est incertain car les principes sur lesquels il fonde la vérité ne sont pas fiables. Personne ne peut faire les preuves de l'existence de Dieu. Pour Pascal, Dieu n'est pas objet de démonstration, mais de croyance. La lutte entre les systèmes philosophiques sera encore plus vivace au XVIIIe siècle. Ce fut le cas entre Kant et son précepteur David HUME à propos de la nature de la connaissance. Aussi entre Kant et Hegel, l'opposition était une réalité. Pour Hegel, Kant ignorait ce qu'est la raison. Voila pourquoi Hegel, le philosophe d'Iéna, recommandait un dépassement de la philosophie de Kant lequel dépassement d'ailleurs, considérait-il, devait être exercé sur la totalité de la philosophie. Il croyait que son système mettait fin à l'activité philosophique et qu'il était le savoir absolu, le système final et définitif. Ainsi pour faire de la philosophie il fallait attendre le système hégélien qui vient au crépuscule de la quête du savoir. Il écrivait : « l'oiseau de minerve ne prend son vol qu'à la tombée de la nuit ». Mais comment Hegel qui n'avait pas mis fin à la science et à l'histoire humaine pouvait- il mettre fin à la philosophie ? La philosophie hégélienne était-elle ce qu'il y avait de meilleur qu'un esprit humain pouvait produire ? Karl MARX semble répondre par la négative, lui qui estimait que la dialectique hégélienne « marchait la tête en bas et les pieds en haut » et qu'il fallait plutôt la redresser. Une telle conviction justifiait du reste son affirmation dans la XIe thèse sur Feuerbach que « les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe, c'est de le transformer ». En définitive, chaque philosophe s'emploie à réfuter ceux qui l'ont précédé et nourrit l'ambition d'avoir achevé la philosophie. Le champ de la philosophie est bien celui des antagonismes. Jamais une réponse acceptée par tous ne s'est donnée à fixer. C'est ce qui explique sans doute que la philosophie ne connaisse pas une évaluation positive, surtout de la part de l'homme du commun. II. Faut-il récuser la Philosophie ? Pour le sens commun la philosophie n'est qu'une activité frivole, un jeu intellectuel déroutant et subversif. Que peut du reste cette pensée avec laquelle on ne peut essentiellement rien entreprendre et à propos de laquelle les servantes ne peuvent s'empêcher de rire », se demandait Heidegger, qui faisait allusion à Thalès, tombé dans un puits alors qu'occupé d'astronomie, il regardait en l'air. On se M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 34.
Scene 35 (1h 23m 50s)
[Audio] souvient du portrait de Socrate peint par Aristophane. Aussi, pour Calliclès, ce jeune et insolent interlocuteur de Socrate dans le Gorgias, la philosophie n'est qu'un enfantillage inutile et dangereux qui divertit et détourne les jeunes esprits des choses sérieuses qui devraient légitimement préoccuper les hommes responsables. Toutefois, que la philosophie se présente comme un spectacle décourageant, que la philosophie apparaisse comme un domaine incompréhensible, qu'elle n'apporte guère de solutions immédiatement utilisables à l'instar de la science et de la technique, tout cela suffit-il à la renvoyer au musée des archaïsmes ? La réalité est, qu'il est d'abord possible d'admettre à la suite de Hegel, une véritable unité de la philosophie au-delà de la diversité des philosophies .Bien que particulières par leurs approches et leurs démarches, chacune des philosophies nous permet par son contenu de saisir l'aspect universel de toute philosophie. Dès lors, récuser une philosophie particulière sous prétexte qu'elle n'est pas l'ensemble de la philosophie serait simplement insensé et pourrait être assimilé à l'attitude d'une personne qui refuse une cerise ou une poire parce que celle-ci ne serait pas le fruit. C'est pourquoi pour Hegel, « quelque soit la diversité des philosophies elles ont ce trait commun d'être de la philosophie. Quiconque donc étudierait ou posséderait une philosophie si toutefois c'en est une, connaîtrait par suite la philosophie ».Ainsi, toute condamnation si brutale et hâtive de la philosophie ne serait que méconnaissance. En effet, en tant que connaissance fondatrice (Descartes), cheminement individuel, la philosophie trouve en elle- même sa valeur et son sens Puisqu'elle ne cherche pas à se faire valoir auprès de l'opinion. Chaque philosophe n'est-il pas fils de son temps, pour reprendre ainsi Hegel ? M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 35.
Scene 36 (1h 25m 49s)
[Audio] Chapitre 4 : L'IDEE D'UNE PHILOSOPHIE AFRCAINE INTRODUCTION Avec ses particularités propres, ignorées, méconnues, les pensées africaines furent pendant longtemps dans l'absence de l'histoire, de la raison, et de l'humanité. L'étude de cette absence, le pourquoi et le comment de la pensée africaine seront étudiés à travers ce qu'il conviendra ici d'appeler l'ère des dénégations. Les thèses anthropologiques qui formaient l'essentiel des conceptions des occidentaux sur l'Afrique qualifiaient l'homme noir d'être inférieur, doté d'une mentalité prélogique, primitive, etc. C'est surtout cette considération qui manifeste un déni radical et idéologique de la civilisation noire qui sera en partie à l'origine de cette idée d'une philosophie africaine. I. L'ERE DES DENEGATIONS Les thèses dites anthropologiques sont liées à la cause expansionniste de la civilisation occidentale. Arthur GOBINEAU écrit dans Essai sur l'inégalité des races humaines « le caractère d'animalité empreint dans la forme de son bassin lui impose sa destinée dès l'instant de sa conception. Ses facultés pensantes sont médiocres ou même nulles. Il tue volontiers pour tuer lâche devant la souffrance il est facile à émouvoir ». Ces considérations entrent bien dans le cadre de la fausse science construite idéologiquement et politiquement à des fins hégémoniques, économiques, religieuses et impérialistes. On peut citer toujours dans cette tentative de légitimation d'un racisme viscéral les propos de André LEFEVRE quand il écrit dans le dictionnaire des sciences anthropologiques « quant aux nègres depuis deux mille ans au moins leur état social et mental n'a pas varié » On ne saurait être plus clair sur leurs intentions qui n'étaient en réalité qu'au M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 36.
Scene 37 (1h 27m 38s)
[Audio] service de l'occident. Ainsi les tenants du polygénisme et les spécialistes de la phrénologie sont de véritables défenseurs de l'esclavage et de la domination des peuples nègres. Le polygénisme est en effet la théorie qui fait dériver les races humaines actuelles de plusieurs races à l'origine. La phrénologie signifie une théorie du caractère et des fonctions intellectuelles de l'homme d'après la conformation externe du crâne. Cela grâce à la chronométrie qui est la science de la mesure du crâne mais à des fins idéologiques. A ces explications il faut ajouter les thèses ethnologiques produites par des savants, des voyageurs mais aussi des missionnaires l'Abbé BOILAT avec ses Esquisses sénégalaises (1853), Alvise de Cada Mosto Relations des voyages à la cote occidentale de l'Afrique en (1895) Maurice dela fosse qui ont au moins produit des informations importantes sur les peuples et la société africaine. De la mentalité primitive prélogique chez Lucien Lévy Brulh dans mythologie primitive, nous allons assister de manière beaucoup plus radicale à un déni d'historicité et autre d'ordre philosophique .L'occident apparaît comme le destin historique du monde, le point de référence de toute l'humanité. Nous avons là un européocentrisme sans précédent. L'historien anglais Newton écrit en 1923 « l'Afrique n'a pas d'histoire avant l'arrivée des européens l'histoire commence quand l'homme se met à écrire ». La réduction de l'histoire à l'écriture comme seule possibilité pose une conception unilatérale et ethnocentriste où le préjugé tient lieu d'hypothèse. Par ailleurs les positions des philosophes aussi ne sont pas en reste. Hegel écrit « ce continent n'est pas intéressant du point de vue de sa propre histoire, mais le fait que nous voyons l'homme dans son état de barbarie de sauvagerie n'empêche encore de faire partie intégrante dans la civilisation. L'Afrique aussi loin que ne remonte l'histoire est le pays de l'or replié sur lui même, le pays de l'enfance qui au-delà du jour de l'histoire est enveloppée dans la couleur noire de la nuit ». Il ajoute que « le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie dans toute sa pétulance. Il faut faire ion de tout respect et de toute moralité de ce que l'on nomme sentiment si on veut bien le comprendre. On ne peut rien prouver dans le caractère qui rappelle l'homme ». Leçons sur la philosophie de l'histoire. II. UNE AUTHENTIQUE PHILOSOPHIE NEGRO AFRICAINE L'idée d'une philosophie africaine est née d'un paradoxe .En effet suite à l'époque des dénégations, ce fut le révérend père Placide Tempels qui a dégagé l'idée à travers sa philosophie Bantou. Le but de cet ouvrage était d'aider les colonisateurs à comprendre l'âme du Bantou. Il prétendrait ainsi découvrir une philosophie Bantou qui se fonde sur la notion de force vitale, c'est-à-dire, cette énergie qui représente chez tous les Bantou ce qui anime leur vie. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 37.
Scene 38 (1h 30m 37s)
[Audio] D'autres intellectuels africains s'en suivront pour opposer un mouvement de réhabilitation et soutenir l'idée de l'existence d'une philosophie africaine. Dans son fascicule la philosophie en orient Paul Masson Oursel sort pour la première fois l'histoire de la philosophie des sentiers qui étaient traditionnellement réservés aux seuls occidentaux. C'est pour combler une universalité de la philosophie que P.M Oursel parle de la philosophie en orient. C'est un recul idéologique de ces thèses ethnocentristes qui apparaît ainsi quand il écrit<<personne aujourd'hui ne peut plus dire que la Grèce, Rome, et les peuples médiévaux de l'Europe aient seul possédé une réflexion philosophique. L'immense foyer de spéculations abstraites a été animé, a même brillé d'un vif éclat dans d'autres sections de l'humanité ». Traditionnellement la philosophie était l'apanage de l'européen. Cette remise en cause ne vise pas la négation de la philosophie occidentale mais elle relativise sa prétention comme étant la seule possibilité. La référence à l'Egypte pharaonique par Le Conte Volné d'abord Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ensuite, n'est pas seulement une mode, mais une nécessité de validation du concept, de la philosophie africaine. III. PROBLEMATIQUE DE LA PHILOSOPHIE AFRICAINE Certaines critiques considèrent que ce qui est appelée philosophie africaine et qui se nourrit des éléments culturels de la tradition appartient plutôt à l'ethnophilosophie. C'est le cas de Marcien Towa et de Paulin Hountondji. L'ethnologie se veut descriptive, la philosophie se veut analytique. Ainsi convient-il de souligner que la qualification d'ethnophilosophie constitue en soi et est déjà une critique de préparation à ce qu'on nomme philosophie africaine. 1) Philosophie et ethnophilosophie : La revendication de l'existence d'une philosophie n'est autre chose qu'une revendication de la raison. Or, cette revendication d'une philosophie authentique africaine est liée à la perspective globale et la revendication de l'identité africaine reconnue et enracinée dans les valeurs les plus fondamentales. 2) Philosophie et idéologie : L'idéologie e st une synthèse d'idées, un ensemble de représentations théoriques reçues et propres à un groupe donné conditionnées par des intérêts communs. C'est l'exemple de la négritude et du consciencisme de Kwamé Nkrumah. Ainsi on voit comment la négritude comme ensemble des valeurs du monde noir peut être perçue comme idéologie. De même on voit comment le mythe qui est une donnée collective peut être considéré comme une idéologie. La philosophie quant à elle se veut démarche autonome, rationnelle et s'amusant dans un discours individuel critique. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 38.
Scene 39 (1h 31m 42s)
[Audio] 3) Sagesse, pensée et philosophie : La philosophie n'est ni mythologie ni idéologie. La possession d'une philosophie africaine serait née d'abord d'une valorisation, d'une certaine rationalité africaine contre les thèses anthropologiques et ethnologiques, mais aussi du besoin d'affirmation, d'une identité culturelle par la valorisation des contes, des pensées , des mythes, des proverbes, des sagesses et de vouloir en faire une philosophie. Il s'agit là d'une véritable confusion entre philosophie et pensée. CONCLUSION L'unanimisme du mythe et de l'idéologie ne saurait prospérer en philosophie. Le premier problème que soulève l'idée d'une philosophie africaine est que celle-ci n'est point le fait des africains eux- mêmes mais des occidentaux. Cette philosophie a été d'abord ethnique puisque la plupart de ces philosophies servaient des intentions politiques et religieuses. Elles ont eu le mérite d'avoir impulsé leur mouvement de réhabilitation des cultures et des valeurs du monde noir en s'opposant aux thèses de Lucien Lévy Brulh entre autres, mais n'ont cessé d'être problématiques jusqu'à nos temps actuels. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 39.
Scene 40 (1h 32m 53s)
[Audio] Domaine 2 : LA VIE SOCIALE Objectif Général : Il s'agit à travers cette seconde partie d'amener les élèves à être capables de mieux se connaître eux-mêmes, de connaître leur environnement social, ses cadres et ses fondements ; sur cette base, ils seront capables de porter un jugement sur l'ensemble des problèmes qui agitent la vie sociale. Chapitre I : Nature et Culture « Tout ce qui est universel, chez l'homme, relève de l'ordre de la nature et se caractérise par la spontanéité, (…), tout ce qui est astreint à une norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif et du particulier. » Claude Lévi-Strauss, les Structures élémentaires de la parenté (1947), éd. Mouton, 1971, p.10 Introduction L'antériorité de la nature sur la culture semble requise par le simple bon sens : comment en effet définir la culture sinon comme une transformation de la nature et peut-être même comme une « seconde nature » ? Le rapport de l'homme à la nature, le rapport de la nature à la culture ne sont pas les mêmes aux différentes époques des sociétés et des hommes. Ainsi le rapport entre nature et culture reviendrait à distinguer non seulement l'inné de l'acquis mais aussi à examiner les questions suivantes : La différence entre l'inné et l'acquis, entre la nature et la culture traduit-elle un rapport d'exclusion comme le chaud exclut le froid ? Comment comprendre les propos des ethnocentristes, des biologistes et des racistes, si on admet qu'il n'y a pas et ne saurait y avoir de peuple sans culture ? Quelles sont les caractéristiques d'une œuvre culturelle ?ou plus simplement, à quoi reconnaît-on une œuvre culturelle ? Enfin, en quoi le travail et le langage sont-ils les expressions types de la culture ? M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 40.
Scene 41 (1h 34m 52s)
[Audio] I. Définitions Etymologiquement, inné signifie naître avec. C'est donc l'ensemble des dispositifs qu'un individu apporte en venant au monde. Ce qui est inné en l'homme, n'est donc pas, ce qu'il a éprouvé, fait, ou reçu depuis sa naissance ; il s'agit au contraire de ce avec quoi il est né. L'inné devient alors synonyme d'instinct. L'instinct peut être entendu comme étant l'ensemble des réactions innées ou même héréditaires communes à tous les individus d'une même espèce. Par conséquent, il ne résulte ni de l'expérience, ni de l'éducation, et n'exige pas la réflexion. C'est en ce sens que l'inné diffère de l'acquis. Quant à l'acquis, il peut être entendu dans un sens purement dynamique ou évolutif. Il est le processus par lequel l'homme agit sur une nature donnée afin d'y tirer profit. C'est pourquoi, l'acquis peut désigner aussi, pour parler familièrement, tout ce que l'individu possède par un processus de transformation qui lui est propre après sa naissance. Cette distinction minimale entre l'inné et l'acquis, renseigne à bien des égards sur la complexité et sur le caractère non équivoque des concepts de Nature et de Culture. Dans un sens général, la nature désigne d'abord le monde extérieur à l'homme, c'est-à-dire, ce qui entoure l'homme et qui n'est pas son œuvre, du brin d'herbe à l'étoile. Mais, la nature, c'est aussi « l'essence », l'être profond de tout sujet ou de tout phénomène sensible : c'est le sens dit restreint de la nature. Celleci renvoie en effet, à la nature humaine. Dès lors il convient de noter que le terme nature vient de nascor en latin qui veut dire naître. Ainsi, la nature humaine recouvre une double signification selon que l'on se situe sur un plan collectif qu'individuel. Sur un plan collectif « la nature d'un homme est ce qui le rend homme, ce qu'il a de commun avec ses semblables ; ce qui constitue soit sa définition, soit son Idée, soit l'instinct normal de son espèce ».La nature humaine renvoie dans ce sens à ce qui est commun à tous les hommes malgré leur étonnante diversité. Dans un registre plus individuel « la nature d'un homme est au contraire ce qui l'individualise, ce qui le distingue par certaines tendances ou certains modes de réactions qui lui sont propres ».En clair, la nature d'un homme au plan individuel est ce qui fait que l'individu, tout en partageant avec ses semblables certains traits spécifiques se pose en s'opposant à ces mêmes semblables par des signes distinctifs propres. Exemple : le tempérament. La culture, elle, relève de l'acquis. Cependant, si nous partons de la définition que la culture, c'est ce que l'homme ajoute à la nature par la transformation de celleci, alors if faudrait être certain de la nécessité de la nature et oser affirmer même M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 41.
Scene 42 (1h 37m 52s)
[Audio] que sans nature, il n'y aurait pas de culture. La nature devient dans ce cas la matière première, le matériau de base sur lequel l'homme doit agir. Au sens propre, la culture signifie travail et transformation. Dès l'Antiquité la culture se présentait comme la culture de la terre (agriculture).En ce sens la culture était comprise par les grecs comme un processus de mis en valeur de la nature environnante en vue de produire. Mais la culture pouvait aussi signifier l'exercice sur l'esprit et sur le corps pour actualiser des potentialités. Il s'agit donc, de la mise en valeur du patrimoine intellectuel et physique qui sommeille en l'individu. Nous avons là ce qu'il convient d'appeler l'éducation ou simplement la socialisation. A coté de ce dernier sens dit restreint ou humaniste de la culture, celle-ci s'est aujourd'hui enrichie, grâce au développement de l'anthropologie, d'une nouvelle conception. Il s'agit du sens sociologique de la culture. Dès lors, civilisation, entendue comme mode d'organisation sociale supposée la plus raffinée, devient synonyme de culture. C'est l'humanité qui se voit enfin sauvée de malentendus purement idéologiques, lesquels feront l'objet d'une étude plus exhaustive dans les colonnes à venir. II. Les rapports entre nature et culture « La nature est-elle une anti-nature ?» Edgar MORIN, Le paradigme perdu, la nature humaine, p.20, seuil, paris, 1973. De prime abord, on peut noter entre la nature et la culture un rapport conflictuel .En effet, à la différence de l'animal, l'homme est obligé de combattre la nature pour vivre. Il la transforme et trouve les moyens de compléter le manque qui est en lui. L'homme est alors un être démuni. Il est dépourvu et pauvre en dons biologiques. Quant à l'animal, il est programmé et n'a donc pas besoin de nier la nature. Il adopte la nature tandis que l'homme s'adapte à la nature. L'homme est un animal inachevé, incomplet et prématuré que seule la culture permet de s'accomplir en comblant le vide laissé par la nature. Le cas des « enfants sauvages » en est une parfaite illustration. En effet, Lucien MALSON nous présente l'histoire de deux jeunes filles adoptées par des loups .Ainsi, longtemps sevrées du milieu social ces enfants ne développaient plus des comportements proprement humains. C'est pourquoi selon Malson, « les enfants privés très tôt de tout commerce social, demeurent démunis dans leur solitude au point d'apparaître comme de moindre animaux.» Cette distinction entre l'homme et l'animal se comprend aussi dans la différence entre l'hérédité et l'héritage. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 42.
Scene 43 (1h 40m 46s)
[Audio] Cependant, le rapport entre nature et culture, donc entre l'homme et l'animal, ne saurait s'appréhender sous l'angle seulement de l'exclusion. En effet, même les enfants sauvages, comme le souligne Lévi-Strauss, ne sont que « des monstruosités culturelles » L'homme n'est donc pas une entité close n'ayant aucun rapport avec son milieu social. C'est la « perfectibilité », qualité première et spécifique de l'homme par laquelle il se distingue des animaux, qui lui fit rompre l'harmonie primitive avec la nature. Cette particularité constitue en un sens, la vraie nature de l'homme : mais cette nature est une « non-nature » qui ouvre à l'humanité une quasi-infinité de possibles et porte donc en elle la liberté. Ainsi, les rôles respectifs des facteurs innés et des facteurs acquis dans l'éducation et dans certaines conduites de l'homme revoient actuellement à une double action de la nature et de la culture, ou encore des gènes et du milieu sur la signification véritable à donner à l'être humain. N'est- il pas illogique, se demandait A. Jacquard, de dissocier l'inné et l'acquis qui n'ont aucune réalité, pris isolément ? Affirmer comme François JACOB l'interaction du biologique et du culturel, c'est instituer l'unité de l'homme comme réalité « bio- sociologique ». De ce point de vue, s'il ne fait l'ombre d'aucun doute que nature et culture sont intimement liées et que l'homme ne serait qu'un animal domestique, n'y a t – il pas alors un problème à vouloir hiérarchiser les cultures en termes de différences ethnique, biologique ou raciale ? III. Les dangers du biologisme, du racisme et de l'ethnocentrisme Le processus du développement historique des peuples nous a amenés à constater que chaque société a presque toujours tendu à « confondre sa propre civilisation avec la civilisation ».Ainsi certaines sociétés sont allées jusqu'à rejeter en dehors de l'humanité les hommes qui provenaient d'autres cultures. L'appellation de « barbare » était collée à tous ceux qui étaient étrangers à la culture et à la civilisation grecques. L'homme est arrivé sans aucun doute à attribuer à ses comportements une origine biologique ou raciale. Ainsi, Aristote, analysant l'organisation politique de sa société trouvait que l'esclavage était chose naturel et normal. Il écrivait à ce propos : « la nature a fait des hommes libres différents du corps des esclaves. Elle a fait les uns pour commander, les autres pour obéir ».A la question de savoir si toutes les cultures se valaient, diverses conceptions furent alors dégagées. Arthur GOBINEAU soutenait ainsi la supériorité de certaines races sur d'autres. Il faut noter dans le même temps toute l'influence des écrits d'Adolphe Hitler lorsqu'il faisait du pangermanisme la vision politique par excellence que tous les peuples devraient adopter. Dans son ouvrage Mein Kampf était consigné l'essentiel de ses convictions politiques. Mais il convient de souligner à juste titre que l'idée de catégoriser le genre humain en entités anatomophysiologiques closes, c'est-à-dire, en races, était l'une M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 43.
Scene 44 (1h 43m 59s)
[Audio] des plus violentes manœuvres humaines. L'esclavage, la colonisation l'apartheid ainsi que les épurations ethniques en furent des exemples éloquents. En réalité la variété des cultures ne relève nullement des races ou des ethnies mais simplement du fait que les différents groupes humains ont du inventé des solutions adaptées aux problèmes particuliers de leurs environnements respectifs. « Tout est relatif, voilà le seul principe absolu » : cet aphorisme d'Auguste COMTE résume à merveille le paradigme du relativisme culturel. En réaction contre l'universalisme, le paradigme du relativisme culturel peut se définir comme une conception, à la fois holiste et singularisante qui pose la différence des cultures dont découlent la diversité des pratiques, des valeurs et des normes, souvent opposées, car elles varient en raison des cultures des sociétés ou des nations. Comprendre les différences exige la connaissance intime et l'empathie voire la sympathie avec les sociétés autres que ce que nous sommes. Il n'y a donc pas de valeurs universelles et si une hiérarchie transculturelle s'impose, elle reflète les rapports de force entre dominants et dominés qui structurent la scène internationale. Chaque culture étant singulière, Daniel-Louis SEILER écrivait dans La méthode comparative en science politique que : « L'individu humain n'est pas dissociable, ni partant, compréhensible, séparé du système de relations qui l'unit à son passé, à sa famille, à divers groupes d'appartenance, à sa culture et à la société globale qui est la sienne. Pour le relativisme culturel, il n'y a pas d'Homme mais des hommes et des femmes concrets, pas plus qu'il n'y a de Culture mais des cultures ». En définitive, on peut mettre dos à dos l'universalisme et le relativisme culturel. Car, ces deux positions extrêmes peuvent tomber dans le piège de l'ethnocentrisme. L'universalisme, père du colonialisme, peut conduire à la négation de l'autre dans sa singularité. Le relativisme culturel peut mener au mépris de l'autre lorsqu'il cède au nationalisme, au racisme et, à partir de ces dérapages idéologiques, établit une hiérarchie entre les cultures où trônerait une seule. C'est dans ce cadre du reste que Montaigne écrivait : « ce qui est hors des gonds de la culture, on le croit hors des gonds de la raison et Dieu sait combien déraisonnablement le plus souvent.» Chercher à reconnaître la diversité culturelle, en faire valoir la fécondité et la nécessité revient à partager cette forte conviction de Claude Lévi- Strauss lorsqu'il s'adressait à ses pairs en ces termes : « la pensée sauvage est logique, dans le même sens et de la même façon que la nôtre ». Si l'humanité de l'homme ne peut se manifester que dans le cadre culturel, quelles sont alors les caractéristiques propres à l'œuvre culturelle ? M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 44.
Scene 45 (1h 46m 54s)
[Audio] IV. Les traits caractéristiques de l'œuvre culturelle Si nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'il y a autant de cultures que de sociétés et qu'aucune culture n'est plus valorisante qu'une autre parce que simplement l'homme n'est rien d'autre qu'un « animal symbolique » qui prête sens aux choses et aux êtres, il y a au moins des éléments distinctifs qui caractérisent l'œuvre culturelle. Il s'agit entre autres des aspects, artificiel, collectif, historique et conflictuel. le caractère artificiel : l'homme transforme progressivement son milieu. De par son action il parvient à rendre artificiel ce qui était naturel et inculte. Car toute œuvre culturelle est perfectible. Le caractère collectif : l'œuvre culturelle nécessite la coopération et la solidarité de l'ensemble de la collectivité. Elle suppose ainsi une organisation de la société laquelle favorise l'éclosion des talents de chaque individu comme de la collectivité. C'est à ce titre que la nécessité du groupe social se fait sentir puisque sans lui, il ne peut y avoir de culture. C'est pourquoi, il aisé de comprendre que les inventions technologiques ainsi que les découvertes scientifiques et les conceptions philosophiques, politiques, religieuses, morales n'ont de sens que dans un cadre social et en référence à une culture donnée. le caractère historique : l'ouvre culturelle obéit à la variation du temps et de l'espace .En clair, notre milieu influence en grande partie nos modes d'habitats, nos habitudes vestimentaires, nos habitudes culinaires, etc. Tout est soumis à l'évolution dans le fait culturel. Le caractère conflictuel : les sociétés vivent et connaissent des réalités différentes. Ainsi, les représentations et les conceptions vont aussi varier d'un milieu à un autre. C'est pourquoi, selon qu'il évolue dans des organisations syndicales, politiques et religieuses, l'homme doit reconnaître et accepter les différences. La variété et la contradiction dans les points de vue sont l'œuvre de l'homme ; ce qui fait que reconnaître la diversité des cultures ne peut en aucune façon interdire les échanges interhumains. Donc toute œuvre humaine est susceptible de jugements et d'appréciations différentes. Mais le travail et le langage ne semblent-ils pas traduire plus fidèlement la culture ? IV. Le travail Généralités Avant d'être vécu comme une activité libératrice ou plaisante, le travail apparaît originairement comme une contrainte. Sans doute parce que l'homme ne s'y adonnait pas volontiers, mais par nécessité. Ainsi, l'homme ne travaille pas seulement pour vivre, mais aussi pour bien vivre. En effet issu du latin « tripalium » M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 45.
Scene 46 (1h 49m 46s)
[Audio] dont dérive aussi le terme travailleur, le travail semble se justifier dans l'inadéquation des besoins de l'homme et ce que lui offrait la nature. Il fallait dès lors arracher à la nature les moyens dont l'homme avait besoin pour vivre ; ce qui du coup devait nécessairement passer par un combat contre le milieu naturel. C'est pourquoi nous pouvons comprendre par travail, toute activité transformatrice du réel effectuée par l'homme en vue de produire une œuvre utile à son existence. Cette action de transformation ne s'applique pas en effet seulement sur le monde physique ambiant, mais aussi sur le monde intérieur de l'homme et sur son intellect. Si Marx avait raison de souligner que le travail fait corps avec l'intelligence, c'est parce que cette œuvre de transformation qui consiste à nier l'apparence première ne peut être possible que si l'homme la réalise avec des règles que la nature ne prodigue pas mais que l'intelligence humaine est seule à même d'élaborer. Cependant l'histoire des idées retient du travail une activité différemment appréciée par les penseurs, les civilisations et la religion. Le travail n'était-il pas d'abord méprisé ?ou alors, loin d'être l'expiation d'une malédiction, n'est- il pas un moyen pour parvenir à l'estime de soi ?le travail est-il l'apanage des hommes ? Quel rapport y a- t-il entre le travail et le loisir ?le travail ne pose-t-il pas aujourd'hui des problèmes à l'homme avec l'invention de la machine ? 1. La valeur morale et l'évaluation religieuse du travail Chez les grecs le travail était inconcevable pour l'homme libre. Seule la classe des ouvriers ou des artisans devait toucher à la matière en vue de la transformer. Ainsi le travail devait être foncièrement différencié de l'activité philosophique qui est de nature intellectuelle ou simplement perçue comme un luxe. En réfléchissant sur les possibilités d'une société juste, Platon décrit l'homme juste comme étant un homme équilibré c'est-à-dire dont la tête (l'intelligence) gouverne le cœur, symbole de la force et de la puissance ainsi que le ventre siège des passions ; C'est le même schéma en effet qu'il propose pour une république juste. Il faut à la tête de la république de Platon le philosophe ou à défaut le roi - philosophe ; ensuite, les gardiens ; et enfin, les esclaves. Cette stratification sociale montre à quel point Platon méprise le travail manuel jadis confinée aux esclaves, ceux considérés comme les derniers de l'échelon, les êtres de l'épithumia c'est-à-dire les êtres des passions. Platon écrivait à ce propos « Dans l'esprit des esclaves il n'y a rien de sain ni d'entier, et qu'un homme prudent ne saurait se fier à cette classe d'homme ».Ainsi les grecs ont-ils tenu le travail en piètre estime dans la mesure où travailler .c'est d'abord aliéner sa liberté au service de la matière ou d'autrui. De même, cette évaluation négative du travail fut également partagée par les penseurs latins. En effet, ces derniers opposaient clairement le loisir studieux ou l'otium et le negotium (le travail manuel). Cicéron n'affirmait-il pas que « rien de M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 46.
Scene 47 (1h 52m 59s)
[Audio] noble ne pourra jamais sortir d'une boutique ou d'un atelier » ? Quant à Sénèque, profondément imbu de sa dignité philosophique, il soutenait sans ambages qu' « honorer le travail manuel c'est faire croire au cordonnier qu'il est philosophe ». Voilà une pensée, au demeurant, partagée par les sociétés africaines traditionnelles. En effet, le même mépris du travail manuel y était observé. La société africaine traditionnelle était fortement hiérarchisée en classes. C'est ainsi que les groupes dits castés étaient considérés, pour ainsi dire, comme des sous- produits de l'humanité PARCE QUE SEULEMENT ils travaillaient manuellement. Ils faisaient dès lors l'objet de plusieurs préjugés : tantôt comme des porte-bonheur tantôt comme des porte-malheur. La religion a aussi considéré le travail comme une malédiction divine consécutive à la transgression originelle. Celle-ci enjoignait que désormais la femme devra en enfanter dans le travail (la douleur) tandis que l'homme ne mangera qu'à la sueur de son front. Cependant, cette conception faisant du travail une punition, sera trahit par d'autres considérations toujours de la religion. Comment en effet comprendre la nouvelle appréciation que Samba DIALLO a du travail dans l'Aventure Ambiguë ? Le parallélisme qu'il établit ici entre le travail et la prière annonce déjà la rupture. Le travail n'est plus expiation d'une faute mais voie privilégiée pour se rapprocher davantage de l'Eternel. C'est dans ce contexte du reste qu'il faut inscrire la conception mouride du travail ; En effet, Cheikh Ahmadou Bamba relevait une relation étroite entre le travail et la prière. La synonymie entre les deux lui faisait considérer ceci : « travaille comme si tu devrais vivre éternellement et prie comme si tu devrais mourir à l'instant. » Ainsi la conception religieuse du travail apparait comme une sorte de charnière entre l'Antiquité et l'époque moderne. Le travail n'est plus seulement comme l'expression de la malédiction de l'homme, mais plutôt comme le moyen pour l'homme de se libérer de l'hostilité de la nature. Mais en quoi le travail peut-il être entendu comme moyen de libération ? 2 LE TRAVAIL : ACTION LIBERATRICE Des les premiers moments de la Renaissance on assiste à la glorification du travail BACON écrit « Il est certain que la science seule constitue la puissance de l'homme il n'y a pas d'autre moyen de vaincre la nature qu'en lui obéissant ».Descartes pensait aussi à ce propos que la science et la technique, ce formidable couple fera de l'homme le «maitre et possesseur de la nature ». D M, 6 Cette conception libératrice du travail apparait bien dans ce que l'histoire des idées retiendra sous le vocable de la dialectique du maitre et de l'esclave. Soumis au maitre l'esclave l'est aussi à la nature, parce qu'obligé d'entrer en rapport conflictuel M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 47.
Scene 48 (1h 55m 56s)
[Audio] avec elle. Mais par le biais du travail l'esclave va se libéré de la nature; il la nie et la façonne à sa guise. Au moment où le maitre ne sait plus travailler et attend tout du travail de l'esclave, il devient du même coup esclave de l'esclave. Maitre de la nature par le travail, l'esclave est aussi maitre de son maitre par le produit de son travail. Cependant quelque soit la position adoptée il demeure que le travail médiatise le rapport, de l'homme à la nature. Mais l'homme est-il le seul animal qui travaille. I 3.ACTIVITE ANIMALE ET TRAVAIL HUMAIN (texte de g Bataille) Dans le texte G Bataille tente de définir l'homme, comme un animal rebelle. Pour ce faire il montre d'abord comment l'homme pour survivre est obligé, de dire non au "donné naturel" ensuite à travers la seconde négation il caractérise l'homme comme un être qui refuse son animalité Mais si l'homme se définit essentiellement par cette double négation, cela suffit –il pour l'opposer à l'animal ? Le travail parviendra-t-il à indiquer l'animalité de l'homme et à écarter l'animal de tout travail ? Par, donné naturel il faut entendre la nature comme monde environnant c'est dire tout ce que l'homme trouve sur place en venant au monde. Ainsi se voit-il obligé de nier cette nature d'entrer en rapport conflictuel avec elle dans la mesure où il se définit comme un être de manque. Contrairement à l'animal qui n'a pas besoin, des stratégies vitales, pour survivre parce que programmé biologiquement. L'homme lui est défavorisé et doit donc entrer dans une activité de transformation de la nature. En définissant ainsi l'homme comme l'animal qui n'accepte pas le donné naturel, Bataille nous indique d'ores et déjà que l'homme à un surplus par rapport à l'animal. Tout en niant le monde environnant l'homme nie du même coup sa propre nature. Il est obligé de nier sa propre animalité pour pouvoir vivre en société. En effet la société requiert un ensemble de règles de conduites et de pratiques visant à humaniser l'homme. C'est là où intervient, la marque de « L'éducation » de la religion. De plus, ce qui différencie le travail humain de l'activité animale, c'est d'abord l'élément de la conscience. L'activité de l'animal est une activité générique et le modèle à partir duquel l'animal travaille est un modèle inconscient. L'homme invente. C'est dire que l'activité animale est immuable non évolutive et donc sans histoire. C'est cela aussi qui permet de dire que le travail nécessite la conception d'un plan. L'acte est prévu par l'esprit avant d'être réalisé par la main. Karl Marx écrit dans le capital « Ce qui distingue dés l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche, le résultat auquel le travail aboutit préexiste absolument dans l'imagination du travailleur ».La relation de maitrise de l'homme M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 48.
Scene 49 (1h 59m 0s)
[Audio] à la nature n'a pas seulement comme conséquence la domination par la technique (outil de transformation). Le travail lie également l'homme aux autres ne pouvant vaincre seul la nature et satisfaire tous ses besoins, l'homme a besoin du travail des autres. C'est sans doute ici qu'il faut chercher l'origine de la division du travail caractérisée par la répartition des tâches. Chaque homme doit en effet faire appeler à la collaboration et à la solidarité aussi bien verticale qu'horizontal. La solidarité horizontale : est l'échange mutuel des services des travailleurs. La solidarité verticale en revanche est à la fois le profit que nous tirons des travaux de nos ancêtres et l'obligation de travailler pour nos successeurs. Léon Bourgeois résume parfaitement cette double solidarité quand il écrit « devoir est l'infinitif de dette. » En définitive nous pouvons dire que par le travail l'homme se crée lui-même par de- là les choses. Notre travail nous intègre dans la société et fait notre dignité humaine. Emmanuel Mounier disait que « tout travail travaille à faire un homme et en même temps une chose ». 4 TRAVAIL ET LOISIR On peut définir sommairement le loisir comme un ensemble d'activités choisies par les hommes pour épanouir leurs facultés physiques et intellectuelles. Pour cerner le rapport travail- loisir il nous faut nécessairement une nouvelle définition du loisir. Nous pouvons a cet effet à la suite du sociologue Joffre Dumazédier dans vers une civilisation du loisir ? définir le loisir comme « un ensemble d'occupations aux quelles l'individu peut s'adonner de plein gré, soit pour se reposer, soit pour se divertir, soit pour développer son information ou sa formation désintéressée, sa participation sociale ,volontaire ou sa libre capacité créatrice après s'être dégagé de ses obligations professionnelles, sociales et familiales. » C'est dire que le loisir n'a de sens que si et seulement si il désigne l'ensemble des activités auxquelles s'adonne l'individu après son travail. Quelque soit sa signification, le loisir, vise selon Dumazedier.une libération et un plaisir. Le délassement, le divertissement et le développement de la personnalité constituent les trois fonctions essentielles du loisir, selon Dumazedier. Mais Domenach nous fera mieux comprendre ce rapport travail -loisir dans Travail et contribution humaine. Il soutient à ce propos que le loisir se comprend aisément dans l'exploitation dont le travailleur est victime. C'est donc la situation d'aliénation qui fait que le travailleur veuille se retrouver ailleurs, loin de son lieu de travail. C'est tout le sens des congés et de la réglementation des heures de travail. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 49.
Scene 50 (2h 1m 42s)
[Audio] 5. LES PROBLEMES POSES PAR LA TECHNIQUE. Si le travail se définit comme une activité de transformation de la nature par l'intelligence humaine, il faut dire que les conditions de cette transformation ont prodigieusement évolué au cours de l'histoire allant de l'outil le plus rudimentaire à la machine la plus sophistiquée. Georges Friedman souligne dans où va le travail humain ? que « L'outil sert non à supprimer la part de l'homme ; dans la production, mais au contraire à humaniser davantage celle-ci en permettant la confection d'une œuvre où le maitre ouvrier qui l'achève seul, introduit, continuité, réalisation d'un plan, précision accrue, harmonie d'un ensemble. » L'introduction de la machine dans le travail à fortement changé les conditions de celui-ci - Remplacement de l'homme ; -- délai plus court dans le travail ;- Une plus grande précision ; -Augmentation des surfaces cultivables et croissance de la productivité, etc. Cependant les transformations économiques ont donné naissance à : Une servitude ouvrière (l'aliénation) Une mécanisation de plus en plus poussée du travail De nombreux accidents de travail Le grossissement de l'armée des chômeurs. Certes la machine est dangereuse en ce sens qu'elle augmente dans des proportions incontrôlées la puissance de l'homme, mais cela suffit-il pour la condamner ? Ne faut-il pas simplement, comme le réclamait Bergson, " un supplément d'âme" ? Conclusion partielle Une réflexion sur le travail montre l'idée de contrainte et de mépris attachée à toute activité de transformation de la matière. Mais une telle activité étant nécessaire pour la survie des hommes, l'humanité ne s'est empêchée de chanter les valeurs du travail en introduisant en son sein de nombreux aspects pour diminuer la contrainte et faire du travail une source d'épanouissement et de libération. Cependant l'introduction de la technique qui a progressivement supplanté l'outil n'a pas seulement connu que des aspects positifs. En réalité, nous assistons à une déshumanisation de l'homme et à des dangers sans cesse grandissant de voir l'homme ravalé au rang d'automate ou de bête somme. Il est donc aujourd'hui urgent d'humaniser le rapport de l'homme à son travail en gérant judicieusement les effets pervers de la technique. M. DIATTA, Professeur de Philosophie, Lycée El Hadj Mamadou DIOUF de Foundiougne Page 50.