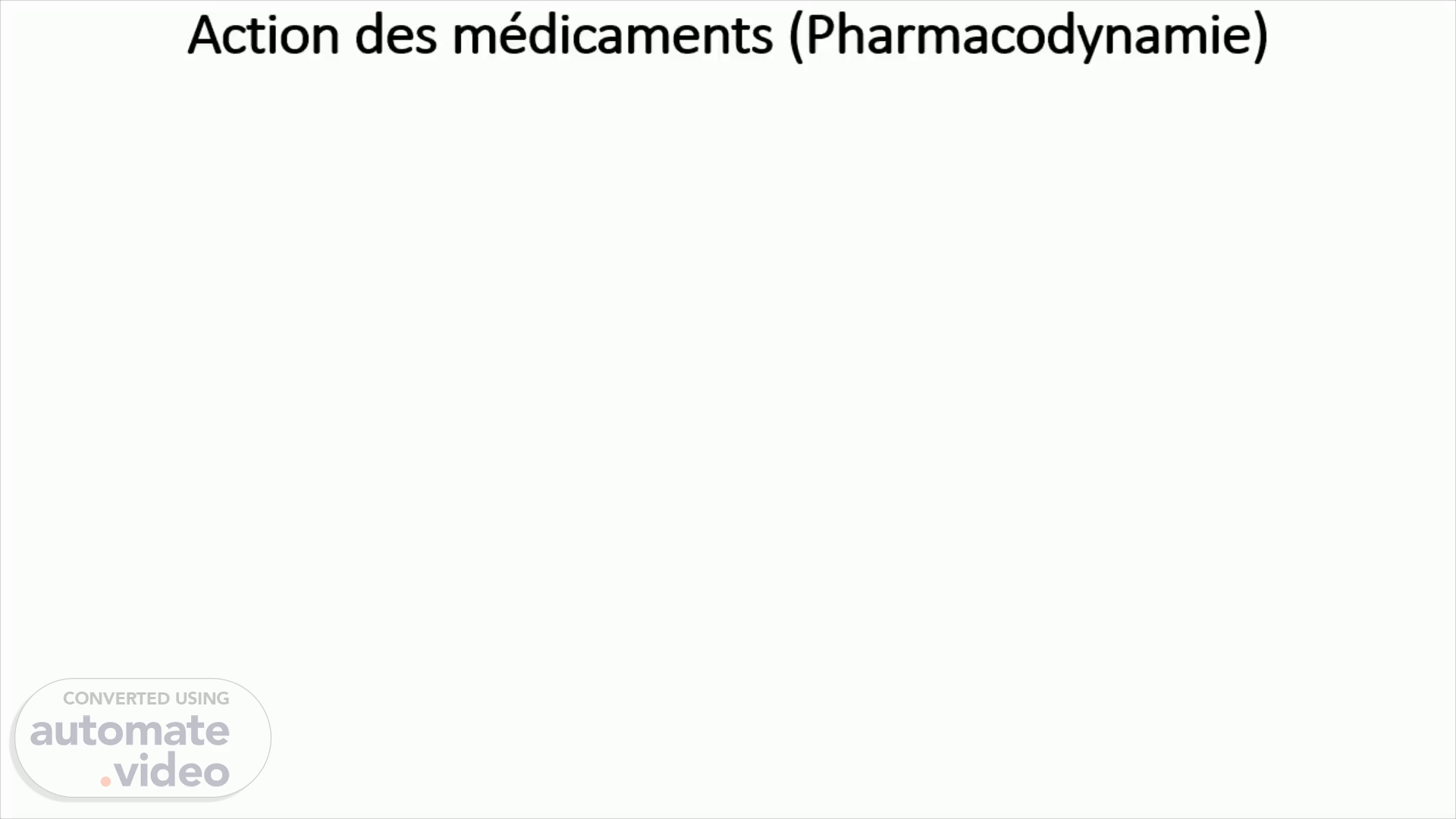
Page 1 (0s)
Action des médicaments ( Pharmacodynamie ). Le but de l’utilisation des medicaments est de régler certains événements biologiques pour diminuer ou éliminer les manifestations de la maladie . L’action des médicaments est souvent liée à un effet sur une fonction cellulaire . Des protéines de transport dans la membrane cellulaire assurent le contrôle des échanges de matière avec le milieu environnant . Ces protéines peuvent être des pompes , systèmes de transport actif , nécessitant de l’énergie ou des canaux ioniques . Les sites actifs des médicaments peuvent être les récepteurs qui captent spécifiquement les signaux ( agonistes ou antagonistes des récepteurs ). La modification de l’activité d’un système de transport peut également contrôler une fonction cellulaire (ex: glycosides cardiaques , diurétiques de l’anse , antagonistes calciques ). Les molécules peuvent également agir directement à l’intérieur des cellules, sur le métabolisme géneral , par exemple en bloquant une enzyme ou en la stimulant..
Page 2 (2m 35s)
Action des médicaments ( pharmacodynamie ). Définition d’agoniste et d’ antogoniste :.
Page 3 (4m 9s)
AGONISTE ÖOÖÖ ÖÖ Seconds messagers Cascade enzymatique - phosphorylations - déphosphorylations Réponse cellulaire - contraction - sécrétion - croissance et division ANTAGONISTE Absence de signal intracellulaire Absence de réponse cellulaire.
Page 4 (6m 6s)
Un médicament peut avoir une ou plusieurs actions, décrites comme : Action substitutive : consiste à apporter à l'organisme l'élément nutritif ou physiologique déficient (par exemple : méthadone ou vitamine C ) Action par reproduction directe ou indirecte des effets d'une substance naturelle : le médicament reproduit ou stimule une fonction cellulaire ou organique, ou encore la transmission d'un influx nerveux au niveau du SNC (système nerveux central ) ou autonome Action par antagonisme direct ou indirect des effets d'une substance naturelle : le médicament exerce un blocage partiel ou complet d'une fonction cellulaire ou organique en fixant sur des récepteurs spécifiques (par exemple : sympatholytique ) Action mécanique (par exemple : huile de paraffine favorisant le transit digestif ) Action sur certains processus métaboliques : action sur la perméabilité cellulaire ou la réactivité de certaines cellules à leur excitant physiologique ou pathologique (par exemple : médicament anticalcique (modifiant la perméabilité des ions calcium))..
Page 5 (8m 43s)
I • Notion de cible 1. Liaison du médicament å sa cible Grandes étapes du mécanisme d'action des médicaments cible (Médiateur endogéne, ex : noradrénaline) Ex : Médicament antagoniste de la cible Mécanisme de signalisation cellulaire cellule Réponse cellulaire 1 Modification du fonctionnement d'un organe 1 Modification d'une fonction de l'organisme Prazosine (Minipress@, Alpress&) = anti-hypertenseur Activation / inhibition de voies enzymatiques, modulation canaux ioniques, . Pas de contraction cellules musculaires lisses Réactivité et 2' diamétre artéres Résistances périphériques pression artérielle.
Page 6 (9m 56s)
Voie orale AVK Rivaroxaban Apixaban Édoxaban Bétrixaban Dabigatran Facteur tissulaire Vila Xa lla IXa Voie parentérale Héparines Fondaparinux Hirudine Bilavirudine Argatroban Fibrine Fibrinogéne A VK : médicaments antagonistes de la vitamine K ; AT : antithrombine..
Page 7 (10m 46s)
Les facteurs qui conditionnent l’action des médicaments.
Page 8 (12m 21s)
I ) FACTEURS INHERENTS AUX MALADES : A ) L'âge : L'enfant : Le rapport poids/cerveau est plus grand que chez l'adulte. Il est particulièrement sensible aux médicaments agissant sur le système nerveux central notamment les opiacées. En général l'enfant tolère mieux les médicaments que l'adulte du fait de son métabolisme plus actif . La personne âgée : elle est plus sensible aux médicaments que l'adulte. Son absorption digestive, sa métabolisation et son élimination rénale diminuent. Il faut donc adapter la posologie en fonction de chaque cas . B ) Le poids et la surface corporelle : Les posologies moyennes conseillées sont calculées pour un adulte idéal dont la masse corporelle est de 70 kg et la surface corporelle de 1,73 m 2 ..
Page 9 (13m 51s)
C ) L'état pathologique : Il peut augmenter ou diminuer les effets du médicament. une lésion étendue de la peau favorise la pénétration du médicament en application cutanée une insuffisance rénale favorise l'accumulation dangereuse de médicament. un foie lésé peut être sensible à l'activité de certaines substances. D ) Les susceptibilités individuelles : Hypersensibilité ou intolérance : Intolérance congénitale / idiosyncrasie : transmission héréditaire d'une susceptibilité de l'organisme vis à vis de tel ou tel produit. On voit par exemple des intolérances à l'aspirine ou à la quinine (traitement du paludisme). Intolérance acquise / sensibilisation : les premières prises d'un médicament sont bien supportées puis on voit apparaître des troubles aux prises suivantes : les manifestations sont de plus en plus violentes et obligent l'arrêt du médicament (antibiotiques, ...)..
Page 10 (15m 5s)
Hyposensibilité ou tolérance : tolérance congénitale : certains individus supportent des doses qui seraient toxiques pour la majorité. Pour eux il faut trouver la dose efficace. tolérance acquise : par la prise répétée d'un médicament. Dépendance / accoutumance : C'est le processus par lequel un organisme devient sensible à l'action d'un médicament par suite d'administration de quantités d'abord faibles puis croissantes. Pour obtenir les mêmes effets il faut donc augmenter les prises. L'organisme arrive à une dépendance psychique mais non physique. Toxicomanie : C'est un processus voisin du précédent mais il y a une dépendance physique donc un état de besoin, de manque..
Page 11 (16m 17s)
II ) FACTEURS DEPENDANTS DU MEDICAMENT : A ) La pureté : plus il est pur plus il est actif B ) L'état physique : forme cristalline, degré de division, solubilité C ) La concentration : plus il est concentré plus il est actif D ) La nature de l'excipient : consistance , ... E ) La vitesse d'administration : La vitesse d'injection en intraveineuse doit être soigneusement contrôlée sous peine de production d'un choc. F ) La voie d'administration : L'action du médicament est plus ou moins rapide selon sa voie d'introduction. Par ordre de rapidité d'action décroissante : IV, IM, SC, rectale, orale. G ) Association avec d'autres médicaments : Il peut y avoir augmentation ou diminution de l'action d'un médicament par un autre : c'est l'important problème des interactions médicamenteuses qui peuvent être recherchées dans certains cas ou au contraire évitées..
Page 12 (17m 59s)
• Interactions Médicamenteuses: Partie de la Iatrogénie Une interaction médicamenteuse est l'administration concomitante de plusieurs spécialités pouvant entrainer des conséquences lors de la prise d'un traitement. Elle reléve de 2 mécanismes principaux: - mécanisme pharmacodynamique (PD)effet divergent(antagoniste)/convergent(additif, synergique). - mécanisme pharmacocinétique å absorber/distribuer/métaboliser/éliminer les substances: perturbation du médic. Pour étre retenue, une interaction doit avoir une traduction clinique significative, décrite ou potentiellement grave, c'est-å- dire susceptible de : - provoquer ou majorer des effets indésirables, et/ou étre létale. - entratner, par réduction de l'activité, une moindre efficacité des traitements..
Page 13 (20m 14s)
Les différents types d’interactions médicamenteuses.
Page 14 (21m 17s)
Mécanismes des interactions médicamenteuses La grande majorité des interactions peuvent étre classées en 2 grandes catégories: ülnteractions pharmacocinétiques (absorption, distribution, métabolisme, élimination) [Dlnteractions pharmacodynamiques.
Page 15 (21m 37s)
MI Competition entre MI et M2 MI Fixation Récepteur Action thérapeutique Récepteur Pas d'action Fixation La fixation du médicament MI entraine une action thérapeutique. Le médicament MI ne pouvant plus se fixer sur le récepteur occupé par le médicament M2, il ney a plus de réoonse théraDeutiaue..
Page 16 (24m 11s)
Synergie additive compléte Médicaments 00002017 1617.36 Synergie Synergie additive partielle Médicaments Pr R.ASAMNDRAKOTROKA Synergie additive potentialisatrice Médicaments.
Page 17 (25m 24s)
Métabolisation • Inducteurs & inhibiteurs enzymatiques : o inducteurs enzymatiques médicaments qui stimulent le métabolisme hépatique d'autres médicaments. Les médicaments qui sont co-administrés avec des inducteurs enzymatiques seront donc moins actifs. Exemple : rifampicine + oestroprogestatifs o inhibiteurs enzymatiques : médicaments qui bloquent le métabolisme hépatique d'autres médicaments. Les médicaments qui sont co-administrés avec des inhibiteurs enzymatiques seront donc plus actifs. Exemple : ciclosporine et antifongique.
Page 18 (27m 45s)
Interactions pharmacocinétiques Métabolisme Les principaux inducteurs enzymatiques Anti-épileptiques : Phénobarbital, PhénytoTne, Carbamazépine.. Antibactériens : Rifampicine Certains antirétroviraux : Efavirenz, Ritonavir... Millepertuis Tabac, Alcool.
Page 19 (29m 6s)
Liste des inhibiteurs enzymatiques Jus de pamplemousse. Amiodarone. Diltiazem/vérapamil. Antirétroviraux : ritonavir, nelfinavir, amprenavir, indinavir, atazanavir... .. Anti infectieux mycine. Anti fongiques itraconazole. • erythromycine, clarithromycine, jasa- kétoconazole, fluconazole, miconazole,.
Page 20 (29m 45s)
La variabilité de la réponse aux médicaments et l’adaptation posologique.